
Pour son premier recueil, Faut-il des murs pour faire une maison ?, Alix Lerasle, jeune poétesse de 24 ans, a remporté le dernier Prix de la vocation Poésie, remis par la Fondation de la vocation. Elle nous raconte l’écriture d’un deuil, entre poésie du silence, désir d’oubli et combat pour la mémoire.
Pouvez-vous d’abord nous parler du Prix de la vocation ?
C’est une amie qui m’a parlé de ce prix, qui récompense chaque année un recueil d’une cinquantaine de pages, ensuite publié dans la collection “Prix de la vocation” des éditions Cheyne. Au départ, j’hésitais à proposer mon texte – je ne voulais pas que l’on soit en compétition –, mais elle m’a convaincue. Finalement, aujourd’hui, je lui dois ce livre ! Ce prix est un vrai tremplin, surtout pour moi qui n’avais jamais rien publié. Et même pour ceux et celles qui auraient déjà publié dans des revues, ce n’est pas évident d’avoir une place chez un éditeur.
Votre recueil peut-il être considéré comme un seul long poème ?
C’est en effet un recueil qui se lit d’une traite, dont des anaphores délimitent les différentes parties, mais qui peut aussi être ouvert à n’importe quelle page. Par ailleurs, il est très court : lors de ma lecture à la Maison de la poésie de Paris, j’ai pu lire le recueil entier. L’idée, c’était de pouvoir se l’approprier de différentes façons, même s’il y a tout de même une trame narrative. Il tourne autour des thèmes du souvenir, de l’oubli, de la filiation, de ce dont on hérite de nos parents.
Le très beau titre du livre pose la question de ce qui constitue un foyer. La maison, censée être un lieu rassurant, prend dans votre texte la forme d’une ruine (objets abandonnés, meubles recouverts, vitres sales).
Je ne sais pas si j’ai choisi l’image de la ruine, mais l’altération de l’espace est symptomatique de ce qui va mal – le lien entre la capacité des personnes à s’occuper du lieu dans lequel elles vivent et leur mal-être me semble assez évident. Il y a des choses qui font que la maison continue d’être une maison, et en même temps elle n’y ressemble plus. Tout est chamboulé, il faut résister à l’idée que l’on est en train de quitter le navire.
À lire aussi
À la mort de mon père, c’est devenu un combat de continuer à penser la maison comme lieu de vie, d’y être bien. C’est intéressant de penser le deuil en fonction d’un lieu et de comment il est investi. Cela permet de faire un “état des lieux” en quelque sorte, physique et mental, d’avoir immédiatement accès au sensible, au concret. Dans ce texte, la maison est un corps, qui pose aussi la question de la filiation, de ce que l’on n’a pas choisi, dans ce corps que l’on doit habiter. C’est toujours un échange entre intérieur et extérieur.
C’est un recueil qui semble fixé dans l’enfance : il fait donc appel à la mémoire, travaille le souvenir. Mais, paradoxalement, sa force est dans les blancs laissés autour de ce qu’on imagine un malheur. Pouvez-vous nous parler de cette écriture du souvenir, cette dichotomie entre le récit et silence ?
Oui, c’est vrai qu’il y a un contraste fort entre souvenir et oubli. Ce sont notamment les espaces blancs de la mise en page, qui ponctuent aussi le texte, qui créent ce silence. Il y a un aspect lapidaire des phrases, qui peuvent arriver au milieu d’une page, au milieu de rien, comme des réminiscences qui se fraient un chemin, qui jaillissent tout à coup. C’est ce que l’on peut ressentir lorsqu’on perd un proche. Des éléments du quotidien font parfois ressurgir des souvenirs, de façon complètement décontextualisée. Ils ne s’inscrivent pas dans la continuité d’une journée, ils ne s’inscrivent pas dans la pensée, mais pointent par associations d’idées. Les silences sont aussi présents pour marquer les ruptures entre les différentes parties, et pour montrer la brutalité avec laquelle ces pensées surgissent.
Il y a aussi comme un combat entre la crainte de la perte de mémoire, et le besoin d’oublier. En quoi le souvenir est-il une violence ?
Il y a un côté injuste dans l’oubli. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu’un, mais moi, quand j’ai perdu mon père, il y a sept ans, j’ignorais qu’on oubliait la voix de la personne perdue, son odeur, le rapport à la taille que l’on avait avec elle, la sensation de son corps. Et l’on n’est pas préparé à devoir se raconter, s’inventer des souvenirs, à avoir des lambeaux de sensations. Ça a été un vrai choc, et j’ai mis longtemps à l’accepter. Le vers “C’était comment ton nom ?” explique par exemple que le mot Papa, dont nous nous servions avec mon frère et ma sœur, a complètement disparu, parce que ma mère l’appelait par son prénom, et les autres par son nom. Ce qui a réellement modifié la mémoire que l’on avait de notre père. Ce n’était plus “Papa”, c’était une personne avec d’autres identités ajoutées, qui nous donnait une sensation d’étrangeté. C’est ce dont j’ai essayé de parler. C’est difficile de se souvenir quand les récits dont on dispose sont si hétérogènes.
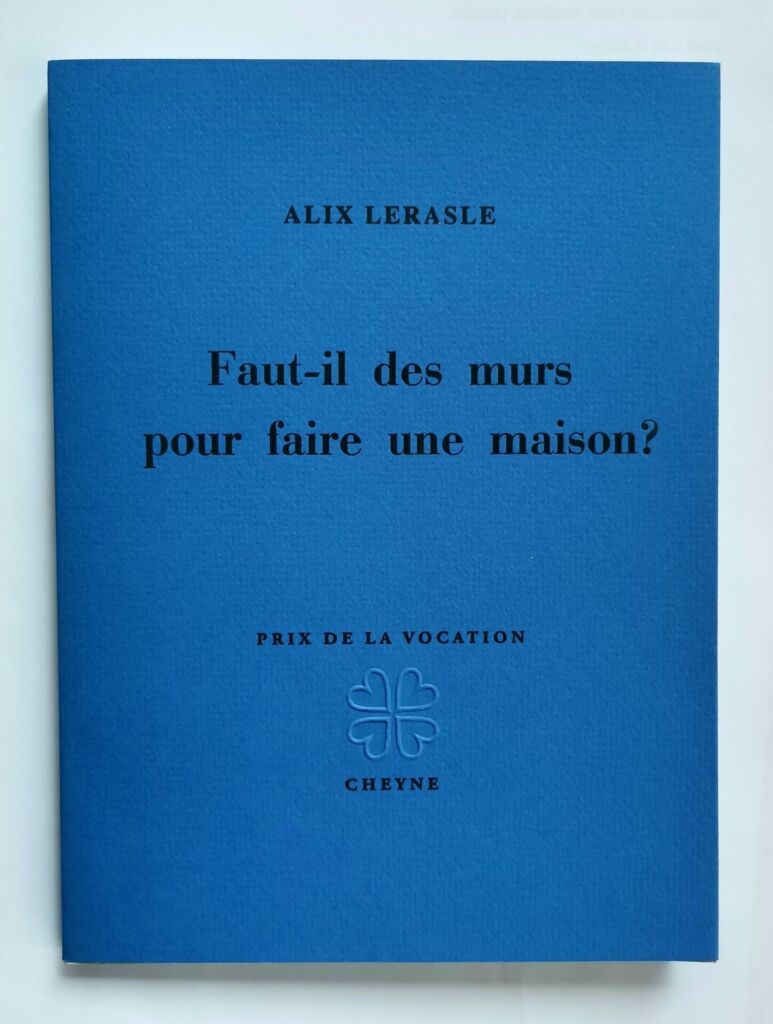
Et, à l’opposé, il y a un autre regard sur le souvenir : la volonté de se débarrasser de choses qu’on ne peut pas oublier, car elles sont transmises, d’une façon imposée. J’ai l’impression d’avoir hérité de la colère notamment, sans y avoir consenti, d’une relation au langage qui passe par la colère.
Le livre parle aussi des choses que l’on récupère sans avoir le choix, et avec lesquelles il faut composer : des dynamiques familiales, des façons d’être, l’influence d’un modèle. La perte d’une personne chère précipite cette prise de conscience. Cela prend sans doute plus de temps lorsque nos parents sont vivants, parce qu’eux aussi s’actualisent ; quand une personne meurt, l’arrêt dans un temps est brutal, on se rend compte de ce à quoi on ne peut que difficilement échapper. C’est l’injustice de ce mécanisme de mémoire qui est une violence. Cette impression de devoir vivre des morceaux de quotidien échappés met en colère.
Il semble y avoir peu de distance entre le “je” poétique, relevant de la fiction, et votre propre identité. Cependant, le “je” n’apparaît que tard dans le poème, l’émotion semble mise à distance. Et les pronoms “nous”, “tu” se multiplient. Pouvez-vous nous parler des différentes figures qui se dessinent peu à peu à travers ces pronoms ?
Ce texte est un montage de fragments – une grosse partie de mon travail consiste à m’y replonger et à assembler mes textes, qui ont des thèmes communs –, ce qui peut expliquer cette voix multiple. Mais le “je” est rarement pour moi un outil d’écriture, là où le “nous” l’est beaucoup plus ; il me permet de ne pas être collée au texte. La première personne du singulier enferme : quand je l’utilise, j’ai l’impression qu’il faut que je sois en adéquation totale avec le discours. C’est un pronom qui marque aussi une rupture avec les autres, qui se dégage d’un ensemble, ce qui ne me parle pas. Dans d’autres textes, je l’utilise, car c’est une façon de se positionner, mais dans cette histoire, que j’ai vécue avec mon frère et ma sœur, le “nous” s’imposait.
Peut-on voir la fin comme une réconciliation avec ses propres souvenirs, comme un compromis entre oublier et se souvenir ? Ou plutôt comme un autre mouvement ?
Je n’ai pas l’impression que la fin soit une résolution, c’est plutôt une porte de sortie qui se dessine. Sortir de ce que l’on nous transmet, sortir d’un foyer est possible, comprendre les choses en étant à l’extérieur est possible, il faut pour cela avoir des yeux, une lucidité nouvelle. Je ne sais pas si je parlerais de réconciliation, mais de l’apparition d’éléments de réponse, d’éléments de vie, qui ont du sens, comme “chercher l’amour dans les rayons des bibliothèques”. Il y a peut-être une forme d’adoucissement, on est moins dans la condamnation et le fatalisme. Ce n’est pas non plus un compromis entre oublier et se souvenir, mais c’est un ailleurs, un en dehors.
Nous allons justement sortir du livre, pour parler de vos inspirations, de votre rapport à la poésie, ainsi qu’à la lecture. Est-ce que le monde expérimental de la poésie contemporaine et des revues est proche de vous ?
J’ai chez moi de nombreuses revues. Même si je n’y écris pas, j’aime beaucoup en lire, les formats et les textes sont très variés, comme dans Niocques ou Rumeurs. Les revues donnent un ensemble cohérent à des auteurs et des autrices qui ne se ressemblent pas, et rendent la poésie vivante. Même si je suis encore en train de découvrir le monde de la poésie contemporaine, j’ai l’impression que les gens qui en écrivent lisent beaucoup de poésie contemporaine, ce qui forme mine de rien un petit cercle. D’autres instances et organisations portent aussi la poésie. À Marseille, il y a beaucoup d’espaces d’échange, qui fonctionnent d’ailleurs avec les revues, qui organisent des rencontres, comme le lieu de création Montevideo, les festivals Oh ma parole !, Actoral, ou le Centre international de poésie, qui organise des expositions sur les poètes et poétesses contemporains reconnus. À Paris, je connais la Maison de la poésie, qui porte beaucoup la poésie contemporaine.
Qu’est-ce qui définit la poésie contemporaine selon vous ? Est-ce un genre qui a tendance à se moderniser par de nouvelles pratiques, de nouvelles formes ? Est-elle plus accessible qu’avant ?
Aujourd’hui, elle est assez libre et désacralisée : pour entrer dans l’écriture, la poésie contemporaine est une porte ouverte, car elle laisse le champ libre à différentes façons de s’exprimer. Elle est aussi très orale, liée à des lectures, des performances, et c’est ce qui la rend vivante et actuelle – c’est ce qui me parle personnellement, car j’écris beaucoup pour lire à haute voix. Avec les lectures publiques, on se rend compte qu’il y a une voix derrière un texte, une façon de lire, une façon de penser les silences, ça la met dans une autre dimension. Ça la rend plus accessible, car écouter un texte et le lire ne suppose pas le même effort – écouter n’est pas forcément plus facile, mais donne une autre façon d’accéder au texte. Il y a des auteurs et autrices que j’aime écouter, mais je ne sais pas si j’aurais envie de passer autant de temps à les lire. L’inverse est vrai aussi, il y a des œuvres que je préfère lire qu’écouter ! D’ailleurs, j’ai l’impression que la pratique du livre audio est aujourd’hui assez répandue, y compris chez des personnes qui ne sont pas forcément de grandes lectrices.
Avez-vous des inspirations artistiques ? Est-ce que le style des poètes et poétesses que vous lisez peut vous influencer, ou est-ce que vous vous séparez, pour l’écriture, de vos références ? Entend-on selon vous davantage de voix de femmes dans la poésie contemporaine aujourd’hui ?
Il n’y a pas forcément de rupture entre ce que je lis et ce que je fais ; mais j’ai de nombreuses inspirations. La musique aussi m’inspire beaucoup. En classique, j’ai beaucoup lu Éluard, et en contemporain, surtout des textes axés sur la mise en voix, l’oralité, comme Laura Vazquez ou des textes de théâtre comme ceux de Falk Richter. J’ai beaucoup lu Bukowski – que j’ai fini par renier – avec sa langue brutale, de forme libre, aux thèmes quotidiens ; j’aimais cette autre façon d’écrire, cette poésie “crade”.
À lire aussi
Mais découvrir des poétesses, qui ont un autre rapport à l’esthétique que celui de Bukowski, ça m’a fait du bien ; aujourd’hui, la poésie laisse en effet davantage de place aux femmes, aux personnes queer, aux personnes racisées. Le versant militant de l’écriture au féminin et des personnes issues des minorités, qui touche à l’hypersensible, qui évoque des lieux de l’intime, m’intéresse énormément ; je pense à Perrine Le Querrec, à la slameuse Lisette Lombet, à Vénus Khoury-Ghata. Parler de sujets difficiles, avec des mots très simples, c’est une esthétique qui me plaît. Ce qui est intéressant, dans la poésie contemporaine, c’est aussi que les poètes et poétesses sont encore en vie, que l’on peut les fréquenter, que leur texte s’accompagne donc d’une façon d’être.
Faut-il des murs pour faire une maison ?, d’Alix Lerasle, Cheyne, coll. « Prix de la vocation », 2022, 64 p., 17 €.





















