
Satire de l’époque, fresque balzacienne, conte philosophique dont le vers de terre est le héros, Humus est un coup de maître et a marqué cette année littéraire. Rencontre avec son auteur, Gaspard Kœnig.
Deux amis étudiants en agronomie du prestigieux plateau de Saclay décident de s’engager pour l’écologie et de faire du ver de terre le héros d’un nouveau monde agricole. En lançant une start-up qui mise sur le compostage des lombrics, Kevin, le fils d’ouvriers, voit les choses en grand, mais est propulsé dans un monde impitoyable où règnent lobbyistes et politiques. Arthur, le petit bourgeois, fantasme, lui, un retour à la terre pour régénérer le champ familial ruiné par les pesticides, mais se prend de plein fouet la violence d’une vie de labeur. Un livre brillant, insolent et follement romanesque.
Dans quel état d’esprit êtes-vous après cette rentrée littéraire très intense ?
D’abord, ce qui me réjouit immensément, c’est qu’aux yeux de tous, je suis redevenu un romancier. Il y a longtemps eu quiproquo sur mon compte. Philosophe, intellectuel, romancier… On ne savait plus où me placer. Cette rentrée littéraire m’a ouvert un chemin merveilleux pour continuer à écrire des romans dans les années à venir. C’est un soulagement. Je sais ce que je vais faire quand je serai plus grand.
Vous n’aviez pas publié de roman depuis Kidnapping en 2016. Pourquoi vous êtes-vous éloigné de la fiction ?
Je viens de passer presque dix ans à écrire des essais, mais je ne vois pas véritablement de rupture fondamentale entre mon œuvre philosophique et mon œuvre romanesque. Mes essais comportent toujours des récits, des voyages, des reportages, des expériences sur moi-même. Ce ne sont jamais des textes théoriques purs. J’essaie aussi de travailler mon écriture, un style, une forme d’humour.

À l’inverse, dans mes fictions, j’essaie de dérouler des idées en toile de fond. Jusqu’à Sartre, personne ne s’offensait que le même écrivain fasse des nouvelles, des pièces de théâtre, des livres métaphysiques, des autobiographies et des essais. Tout cela représente l’écriture, c’est le développement d’une même personnalité. Une fois que j’ai dit ça, il est vrai qu’en refermant cette parenthèse de débat public, j’ai naturellement retrouvé un chemin plus créatif, comme si l’esprit était libéré de beaucoup de contraintes.
Le succès de Humus vous a-t-il surpris ?
C’est mon quinzième livre et, croyez-moi, j’en ai connu des fours ! Je ne boude pas mon plaisir. Le succès d’un livre est tellement hasardeux, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Comme dit Épictète : « Comporte-toi dans la vie comme dans un banquet. » Quand le plat ne passe pas, ne sois pas déçu, quand il est là, mange-le à pleines dents. Ça se traduit par des centaines de rencontres avec les lecteurs que je poursuis avec obstination jusqu’à Noël. Je suis en déplacement presque tous les jours, ça me fait très plaisir !
Est-ce que le fait d’être finaliste malheureux du Goncourt et du Renaudot est une déception ?
J’étais plutôt philosophe vis-à-vis de cela. Le jour de l’annonce, je n’étais pas rivé à mon téléphone ni désintégré après le verdict [rires]. Surtout, j’ai eu énormément de plaisir à recevoir le Giono, parce que c’est un auteur qui m’est très cher, qui, par certains aspects, est une véritable influence pour le livre. J’ai aussi conclu la saison des prix en beauté avec l’Interallié. Je ne repars pas bredouille de la course aux honneurs !
Vous avez abordé beaucoup de sujets dans vos différentes œuvres philosophiques, mais jamais l’écologie. Comment la prise de conscience a-t-elle eu lieu ?
Mon voyage à cheval y est pour beaucoup. Non pas parce qu’il m’a fait voir la nature, mais plutôt parce qu’il m’a transformé à titre personnel, il m’a fait vivre différemment. Naturellement, je me suis tourné vers la question écologique. J’y suis arrivé un peu sur le tard. Ça ne remet pas en cause ce que j’ai fait avant, mais ça lui ajoute une couche beaucoup plus fondamentale.
« Il y a même aujourd’hui une forme de répulsion, un rejet d’une écologie qui s’est banalisée, s’affiche partout, tout le temps, sans pour autant être prise à bras le corps par les autorités publiques. »
Gaspard Koenig
C’est bien gentil de réfléchir à la façon dont les humains s’organisent entre eux, mais ils ne vivent pas dans un univers abstrait, ils vivent dans un environnement. Une fois que l’on pense ça, on se dit qu’on arrive au cœur du sujet et ça change beaucoup de choses.
Pourquoi traiter de la question écologique à travers un roman plutôt qu’un essai philosophique ?
Mes personnages peuvent aller jusqu’au bout, tandis que moi je suis pétri de doutes et d’hésitations. Je peux forcer le trait, aller plus loin, notamment quand j’aborde le sujet de la radicalisation écologique. Dans le roman, je n’ai pas besoin de trancher entre les deux camps. Il n’y a pas de thèse à soutenir.
On me demande souvent de quel personnage je suis le plus proche. Si on me pose la question, c’est que c’est un bon roman. Il vous donne tous les ingrédients pour faire votre choix. Il ne cherche pas à vous “gouroutiser”. C’est aussi en cela que le genre du roman d’apprentissage m’intéressait : il y a un rêve, une ambition, une illusion. À partir de cela, l’idée est de décrire de manière très réaliste et très documentée les obstacles, les défis qui se dressent devant vous. C’est un test. Vous avez une conviction ? Vous pourchassez un rêve ? Voilà ce que vous dit le réel.
En parlant de réel, on a beaucoup qualifié votre roman de balzacien. Balzac a-t-il une influence sur votre travail ?
Quand on cherche des auteurs qui pratiquent une forme de littérature réaliste, on tombe très vite sur Balzac, Zola et Houellebecq. C’est un héritage glorieux. Cependant, cette veine en France est assez réduite. Les réalistes contemporains se font rares. Je pense à Abel Quentin, qui est aux éditions de l’Observatoire avec moi. Au fond, ça me plaît bien de participer au renouveau du genre.
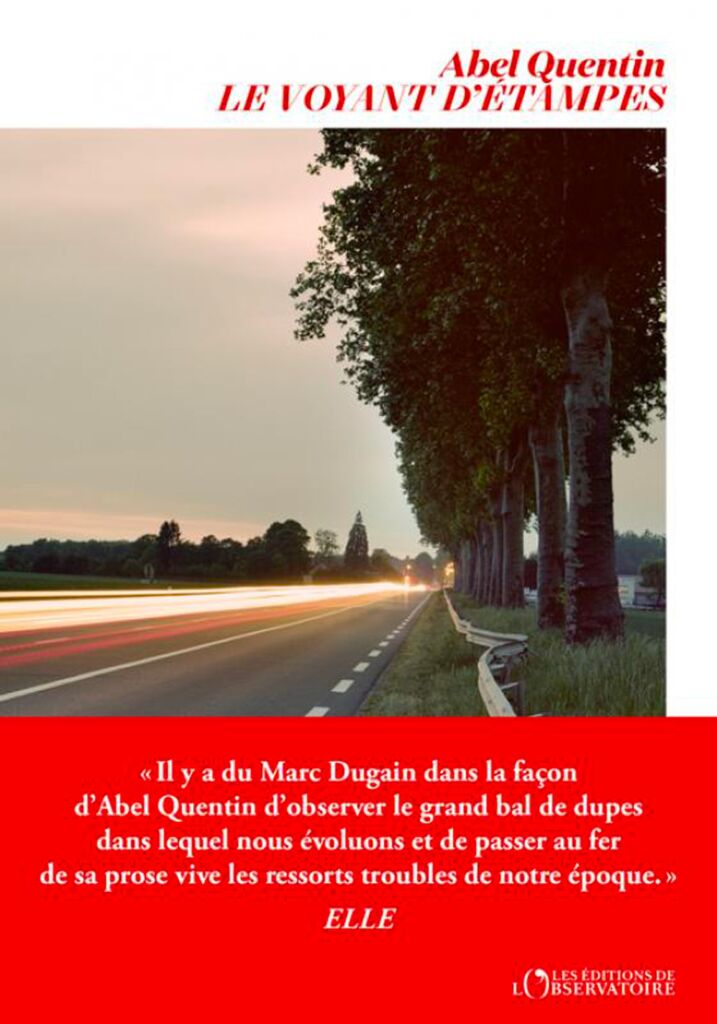
Trouvez-vous que nous soyons à la hauteur de l’enjeu écologique ?
Je vois qu’il y a une avant-garde qui va dans la bonne direction, que ce soit dans le maraîchage, dans l’élevage, dans l’agriculture. C’est même devenu une mode. Ce sont des signaux positifs. Cela étant dit, l’inertie de la société est colossale. Une inertie dans laquelle j’étais avant, je le concède. Il y a même aujourd’hui une forme de répulsion, un rejet d’une écologie qui s’est banalisée, s’affiche partout, tout le temps, sans pour autant être prise à bras le corps par les autorités publiques. C’est un entre-deux dangereux et assez angoissant. D’autant que cette inertie est à l’origine d’une radicalisation écologique que je raconte dans le livre.
Je mets en scène l’avenir de la mobilisation militante écologique sous une forme de plus en plus violente. En tant qu’observateur, il me semble que c’est le développement naturel d’un mouvement qui aujourd’hui est fondé sur la désobéissance civile, mais qui demain sera fondé sur des actions coups de poing. La théorisation de la violence dans la pensée écologique a déjà débuté depuis quelques années avec la publication de Comment saboter un pipeline ? Désormais, elle infuse partout.
Quels sont vos projets pour 2024 ?
Place à la fiction ! Je vous dis ça, mais mon prochain livre est un essai [rires]. Disons que c’est une sorte de digestif ou de post-scriptum philosophique à Humus. Dedans, je m’intéresse aux philosophes et aux penseurs du sol. Je prépare en parallèle un roman sur l’eau. En dix ans, je peux peut-être faire les quatre éléments [rires].
Auriez-vous un conseil de lecture pour cette fin d’année ?
Je conseillerais Et vous passerez comme des vents fous, de Clara Arnaud. Elle a écrit un roman au plus près des ours dans les Pyrénées. C’est un livre très recherché. Elle a passé du temps avec les éthologues. Elle maîtrise ce vocabulaire si particulier de l’estive. On est en immersion, c’est envoûtant.





















