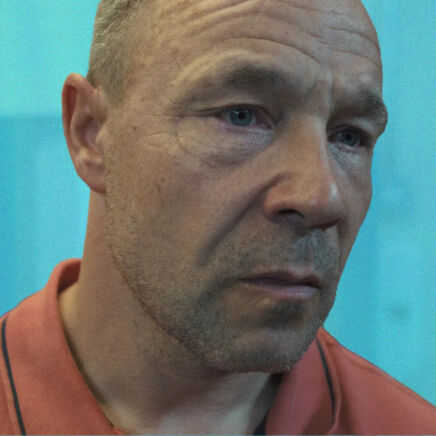Durant le Festival international du film d’animation d’Annecy, L’Éclaireur a rencontré la cinéaste iranienne, Sepideh Farsi, afin de parler de son dernier film, La Sirène, disponible dans les salles obscures françaises depuis le 28 juin, et lauréat du Prix du Jury du meilleur cinéaste français au dernier Champs-Élysées Film Festival.
Comment le projet de La Sirène est-il né ?
Je voulais évoquer ce chapitre de la guerre en Iran-Irak, le siège d’Abadan, parce que j’étais adolescente à cette époque-là. J’avais l’âge d’Omid, le personnage principal, quand la guerre a commencé. Je voulais adopter le point de vue d’un adolescent, en posant la question : comment le quotidien bascule-t-il lorsqu’une guerre commence ? Il y a des choses qui ne sont plus possibles, le danger est réel. C’est aussi un conflit majeur du XXe siècle et je trouve qu’on l’a relégué au second plan de l’histoire alors que c’est très important d’en parler.
Quand on a commencé à développer le film en 2014, on pensait à la guerre, mais, entre-temps, il y a eu le Covid, la guerre d’Ukraine, il y avait le conflit syrien qui est toujours en cours, même si ça s’est enlisé. Il y a la guerre du Yémen et bien sûr la révolte de la liberté en Iran. La résonance du film par rapport à l’actualité mondiale et iranienne aujourd’hui est encore plus forte, et cela même si on a mis des années à le faire. La sortie du film tombe à pic.
À lire aussi
Qu’est-ce que vous attendez justement de cette résonnance avec l’actualité ?
Je n’attends rien de particulier du fait de cette résonnance, mais la réaction des gens le montre. Quand ils viennent me voir en me disant que le film est touchant et que ça leur rappelle les événements actuels, j’imagine qu’ils réagissent différemment aujourd’hui.
Le choix de l’animation dans la représentation de la guerre était-il présent dès le début ? Comment ce genre de cinéma favorise-t-il l’expression de la guerre Iran-Irak ?
Dès le départ, j’ai eu l’idée de faire un film d’animation. Je ne me voyais pas faire un film de guerre avec des effets spéciaux et des d’explosions. Ce n’est pas mon genre de cinéma et rares sont les films et les grosses productions sur la guerre qui me touchent et me bouleversent. Le genre de cinéma que je pratique et dans lequel je me sens à l’aise, là où je voulais mettre le doigt, ce sont des choses qui lient la grande histoire et l’intime.
C’était évident pour moi qu’il fallait que je fasse un film d’animation. Ça m’a permis d’avoir plus de liberté pour lier une espèce de fantastique, comme il y a dans certaines scènes du film, avec un côté très réaliste.

Si les films de guerre en prises de vue réelles ne sont pas votre genre de cinéma, comment définiriez-vous votre univers cinématographique ?
Je dirais que c’est avant tout un cinéma de l’intime et un cinéma du détail. Ce que j’aime beaucoup, c’est de passer du micro au macro, c’est exactement ce que l’on fait avec La Sirène. L’animation permet ce rapport de taille encore mieux que le cinéma en prises de vue réelles.
En quoi consiste le travail d’une réalisatrice de film d’animation ?
C’est assez large, car ça couvre tous les choix artistiques à partir de l’écriture du scénario. Javad Djavahery a écrit le script, mais cela s’est fait en parfaite harmonie avec mes désirs, sur la base de discussions. Tout le développement du style, à la fois simple, iconique, et très réaliste, s’est fait en harmonie avec ce que je ressentais. J’ai aussi travaillé avec les comédiens pour les voix ; j’ai également dirigé le choix musical. Le choix d’Eric Truffaz pour la musique, c’était le mien. Je lui ai demandé d’intégrer des instruments iraniens et d’articuler toutes les musiques du film.
Le premier montage de l’animatic, c’est moi aussi. J’interviens toujours à plusieurs niveaux dans mes films, bien que ça ne soit pas la règle. Je suis également en charge du storyboard avec les animateurs. Dans un premier temps, je leur transmets mes désirs, donc je fais tout le découpage avec eux, mais je leur transmets aussi une énergie qui leur permet de dessiner les gestes. On a aussi les choix de compositing, c’est-à-dire les effets d’image.

Tous ces choix-là s’accumulent et construisent le film touche par touche. Tous ces choix-là déterminent finalement tout ce que le spectateur reçoit du film. Dans le cinéma en prises de vue réelles, ces rôles-là sont généralement partagés.
Vous situez votre film durant le siège d’Abadan pendant la guerre Iran-Irak : quel travail de recherches La Sirène a-t-il demandé ?
J’ai fait un gros travail d’archiviste et de cheffe décoration. Pour le scénario, fort heureusement, j’ai pu consulter Javad, car par moment j’avais des doutes. Il fallait veiller à ne pas faire d’anachronisme sur tel modèle de moto, d’armes ou de ballons. Sur d’autres choses, j’ai fait énormément de recherches historiques et graphiques pour pouvoir transmettre cela à l’équipe ; à la fois pour que rien ne soit laissé au hasard, mais aussi pour que ça ait une signification et que ça corresponde à la période historique.
Du fait de ces missions multiples et de cette expérience, La Sirène occupe-t-il une place particulière dans votre filmographie ?
Oui, parce que ça fait quand même neuf ans que je suis plongée dans le film, ce qui est énorme. Toute ma famille a vécu avec La Sirène pendant des années [rires]. Tout le monde a subi.
« J’aimerais que la fin du film soit un message à tous ces Iraniens et Iraniennes pour dire que c’est possible, que l’on va y arriver. »
Sepideh Farsi
En même temps, je pense que, dans quelques années, ça aura une place à part, tout en ayant sa propre logique, comme tous mes films, son propre momentum. Je pense que La Sirène a été particulièrement baroque.
Quel message voulez-vous faire passer à travers le personnage d’Omid ?
Omid signifie “espoir”. J’aimerais que la fin du film soit interprétée comme un message d’espoir au peuple iranien. Après, je ne veux pas limiter le film à cela, parce que le film est universel. J’aimerais que ce bateau qui s’en va et qui sort dans les eaux libres soit l’image de l’Iran qui aujourd’hui se bat pour la liberté ; tous ces Iraniens et Iraniennes qui se battent pour leur liberté ; et que la fin du film soit un message pour dire que c’est possible, que l’on va bientôt y arriver. J’espère que ce sera entendu comme cela.
La musique occupe une place importante. À quel moment avez-vous décidé que ce serait un fil rouge tout au long de La Sirène ?
La musique a toujours une part très importante dans mes films, ça a toujours accompagné ma vision. Il y a une partie des musiques qui était déjà liée à certaines scènes afin de donner l’énergie au film. Concernant la musique de Truffaz, je savais aussi que je voulais de la trompette, et je sais que depuis 2015-2016, je vais travailler avec lui.
« L’animation trouvera sa place dans la cinéphilie en général, ce ne sera plus un cinéma de niche pour les aficionados de l’anime. »
Sepideh Farsi
C’était assez clair que la musique allait être le fil rouge. La musique, c’est quelque chose qui m’habite très tôt. Quand je fais des projets, je sens déjà des musiques.
Quelle vision avez-vous du cinéma d’animation et de son avenir ?
Je sens un certain optimisme autour du cinéma d’animation. J’ai grandi avec le cinéma d’animation de l’Europe de l’Est que l’on voyait en Iran, et il y avait un côté marginal. Maintenant, il y a de plus en plus de films pour adultes d’ailleurs, qui traitent de sujets importants, comme des sujets historiques, mais il y a aussi du cinéma de genre. Effectivement, cela prend de plus en plus de place, il y a un public qui a faim et qui veut découvrir de nouvelles choses.
Pour autant, quand on est dans des festivals généralistes, autre qu’Annecy qui est le temple de l’animation, je trouve que l’animation n’a pas encore complètement sa place ; ça reste une exception. C’est rare d’avoir des films d’animation en compétition à Cannes, par exemple. Le jury et le public ne regardent d’ailleurs pas de la même façon le cinéma d’animation. Certes, ça commence à venir, mais il y a du chemin.

Souvent dans l’animation, on met le poids sur l’aspect visuel et sur l’image, mais il faut que l’histoire soit là. Donc plus on pousse cela, plus la barre sera haute, plus le public répondra présent. L’animation trouvera sa place dans la cinéphilie en général, ce ne sera plus un cinéma de niche pour les aficionados de l’anime. Je sens que le marché va s’ouvrir.
Vous parlez justement d’ouverture. Quelle est la place des femmes dans l’animation de votre point de vue de réalisatrice ?
C’est encore loin, mais ça vient. J’ai espoir, mais après je ne me suis pas posée la question quand j’ai voulu faire mon film. J’ai toujours fait ce que je voulais. Je me bats, puis j’obtiens ce que je veux, du moins j’essaie. Il y a quand même de plus en plus de voix qui demandent, qui réclament et qui se battent pour les femmes.
Toutefois, j’ai fait un panel à Rennes et j’ai appris – ce qui m’a d’ailleurs beaucoup interpellée – qu’en moyenne les films faits par les femmes en animation ont seulement entre 40 % et 60 % de budget par rapport aux hommes qui réaliseraient le même film. Du coup, quand on a moins de moyens, on va faire autre chose. C’est quelque chose dont je n’avais pas conscience quand j’ai réalisé mon film. J’ai vu ça autrement de mon point de vue bien sûr, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes réalisatrices ont des soucis pour monter leur projet.
Quel est votre dernier coup de cœur d’animation ?
Paprika (2005), je trouve ça génial, c’est un incontournable. Sinon, plus récemment, je pense au Sommet des dieux (2021), que j’ai trouvé très beau, ça m’a marqué. J’aime aussi beaucoup Miyazaki que j’ai vu et revu avec ma fille, qui a grandi avec ses films. Je crois que c’est pour son imagination foisonnante et ce côté rêve éveillé. Cela m’a toujours beaucoup inspiré.