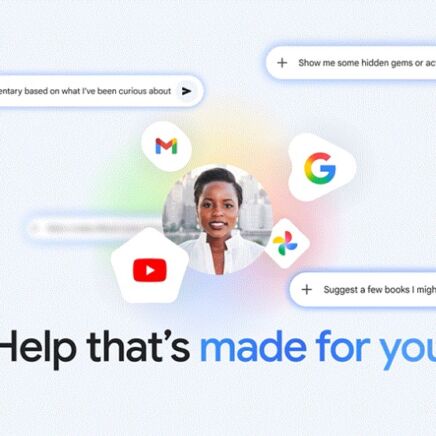Bertrand Naivin est théoricien de l’art et des médias et enseignant. Après avoir travaillé sur le selfie et le pop art américain, il s’est intéressé aux réseaux sociaux et à la part du numérique présente dans notre vie de tous les jours. Il est notamment coauteur du livre Monstres 2.0 – L’autre visage des réseaux sociaux. Rencontre, dans le contexte des Facebook Files.
Peut-on parler d’une coresponsabilité de Facebook et de ses utilisateurs concernant la propagation des propos haineux et des fake news sur Facebook ?
Facebook est présenté comme un réseau social qui aurait tendance à pouvoir améliorer la socialité entre générations, entre personnes éloignées, etc. On a angélisé Mark Zuckerberg : on le présente comme une sorte de messie venant apporter la bonne parole, aider les hommes à échanger entre eux, ce que j’explique dans le livre Tous en ligne !. Mais il ne faut pas oublier que c’est un entrepreneur, une personne obsédée par les chiffres, par l’envie que son entreprise perdure et se développe. Il va donc forcément devoir gérer les mauvais penchants des utilisateurs, que cette nouvelle forme de média numérique ne peut que développer.
Les réseaux sociaux, qui sont parfois même des réseaux asociaux, d’ailleurs, poussent l’individu à assumer et à normaliser des penchants qui étaient cachés avant, c’est-à-dire le voyeurisme, l’exhibitionnisme, le fait de noter les gens, de se moquer des personnes. Ce sont des choses qui étaient considérées comme négatives. Aujourd’hui, elles sont totalement démocratisées, assumées. En 2018, des haters interrogés par le magazine Society se dévoilaient au grand jour comme si, finalement, le fait de critiquer, de publier ce genre de posts sur Twitter était quelque chose de totalement normal. Pour moi, ce n’est pas une coresponsabilité, mais quelque chose de normal, qui était inévitable.
Qu’en est-il de la responsabilité de Facebook par rapport à ses algorithmes et ses problèmes de modération ?
Le problème, encore une fois, c’est qu’on oublie qu’il s’agit d’une entreprise dirigée par un entrepreneur, qui a une culture, un pays, une subjectivité. Il fait donc des choix subjectifs, plus centrés sur certaines populations et pays que sur d’autres. Ces choix sont liés au commerce, au marché, à des pays présentés plus ou moins comme sensibles. Au Kenya, il n’y a aucune modération, car il ne fait pas partie des plus sensibles par rapport aux fake news, aux propos haineux et discriminants aux yeux de Zuckerberg.
C’est pour cette raison qu’avec Pauline Escande-Gauquié, nous avions titré notre livre Monstres 2.0, avec une partie écrite sur le Golem. Facebook, comme ce monstre, est une création de l’homme. Au début, l’invention de Facebook est une blague pour juger les étudiants de Harvard. Mark Zuckerberg a dû par la suite mettre de l’eau dans son vin et en faire une sorte de réseau social essayant de véhiculer de plus en plus de bons penchants, de devenir plus moral, notamment avec l’intelligence artificielle qui s’autonomise et des algorithmes qui échappent au contrôle de Facebook. Plusieurs anciens ingénieurs ont déclaré qu’ils n’arrivaient plus à contrôler la machine qu’ils avaient mise en place. C’est assez fascinant et un petit peu effrayant, mais je ne trouve pas ça si étonnant que ça.
Par rapport aux contenus haineux, évidemment que Mark Zuckerberg ne va pas dire qu’il les favorise. Il va faire en sorte de mettre des algorithmes pour les gérer. Je pense qu’en tant qu’entrepreneur, il veut que Facebook survive. Il sait qu’il y a des contenus haineux, car c’est ainsi que certaines personnes aiment s’exprimer. C’est ce qu’on appelle la liberté d’expression en France, mais, dans cette liberté, il y a forcément des parts plus ou moins nauséabondes à gérer. Qui dit gestion dit essayer de limiter la casse sans pour autant supprimer totalement les autres contenus. De toute façon, ce n’est humainement pas possible : tellement de gens utilisent ce réseau social et trouvent des moyens de contourner les politiques internes. La première chose à faire, c’est d’arrêter de penser que Facebook est une entreprise purement créée pour le bien de l’humanité.
Plusieurs réseaux sociaux ont annoncé des mesures de contrôle avec une association des parents et des enfants. Est-ce que ce serait un moyen efficace de protéger les plus jeunes ?
C’est bien que les entreprises s’engagent dans ce domaine, car ça montre une prise de conscience. Si elles le font, c’est parce qu’elles pensent que ça va plaire à leurs utilisateurs, mais le vrai secret, ce serait une éducation des enfants et des parents. Il faut que les parents jouent vraiment leur rôle de parents et soient un peu plus soucieux des activités de leurs enfants sur l’écran et du temps qu’ils passent sur YouTube, Snapchat, TikTok, etc. Le fait qu’Instagram ait annulé son projet d’une version pour enfants est un très bon signe.
Dans les discours sur l’écologie par exemple, on a tendance à hyper-responsabiliser le consommateur : « Vous ne triez pas vos déchets, c’est une catastrophe », « Vous oubliez d’éteindre votre lampe pendant une demi-heure, vous êtes le pire des affreux destructeurs de la planète »… En revanche, on considère que tout doit être fait par les entreprises pour le numérique. Je trouve ça dommage. La responsabilité vient des deux camps. Pour revenir à votre question de départ, ces réseaux sociaux ont été créés car une demande a été perçue par leurs créateurs. C’est nous qui leur donnons autant d’importance, autant de pouvoir. C’est nous qui leur donnons ces deux visages : le magnifique réseau social permettant, d’un côté, aux petits-enfants de parler à leur grand-mère et de l’autre, aux gens de menacer des journalistes ou des femmes sur Twitter.
Facebook a-t-il contribué à transformer les relations humaines et la société ou est-ce cette dernière qui a transformé le réseau social ?
Je dirais que c’est un peu des deux. Avec Pauline Escande-Gauquié, on aime à dire que le numérique n’invente rien, mais qu’il décuple les choses déjà existantes. Le problème de harcèlement, par exemple, a toujours existé, mais ça prend des proportions beaucoup plus énormes, oppressantes avec le numérique. Je pense que les réseaux sociaux accentuent la communautarisation de la socialité dans le sens où chacun se rassemble en petits groupes, se referme de plus en plus sur soi. Il y a aussi cette obsession de vouloir être bien noté par les autres : une catastrophe pour les adolescents, avec des jeunes passant leur temps sur les réseaux à vérifier que leur post a été aimé ou à scroller des vidéos parce qu’elles sont populaires. Cela joue beaucoup sur l’individu.
Nous participons à ce qu’est Facebook et c’est ce qui en fait un monstre : il est à la fois vecteur de bonnes choses – cette relation, cette proximité qu’on peut conserver avec des personnes éloignées – mais, en même temps, on en a fait une sorte de tartare numérique où on exprime nos penchants les plus mauvais, car c’est une sorte de défouloir pour des choses qu’on ne pense pas pouvoir faire dans la vie réelle. Facebook change notre socialité, mais nous avons une part de responsabilité sur ce qu’on met en ligne et la façon dont on utilise ces réseaux.
Une autre utilisation des réseaux sociaux plus humaniste et responsable est-elle possible ?
On va dire que oui, même si je m’interroge de plus en plus sur l’utilité d’être obsédé à ce point par l’envie de partager ce qu’on fait. C’est ce que j’ai essayé de dire dans mon dernier bouquin, Vivre à l’heure de l’innocence possible : on a de plus en plus cette propension à ne plus se contenter de ce qu’on vit au moment M et de toujours vouloir l’augmenter par des données, par des commentaires et par des likes d’autres personnes. Je suis de plus en plus sceptique par rapport au bien-fondé dans l’absolu de ce genre de réseau parce qu’un FaceTime, un Zoom ou un appel téléphonique suffisent si on veut vraiment communiquer avec une personne physiquement éloignée. Le réseau social implique ce fait de passer des heures sur sa page Facebook quand on l’ouvre, avec les contenus qui défilent. Il est plutôt un absorbeur de temps et d’attention.
On peut y arriver, mais il faudrait vraiment que les gens prennent conscience qu’il s’agit d’un outil, d’un média, mais qu’il n’est pas absolu. On ne vit pas que pour poster sur Facebook ou Instagram. Je compte avant tout sur une responsabilisation croissante de l’individu et une sorte de sursaut où nous sommes conscients qu’un réseau social est public, avec le même fonctionnement que la vie de tous les jours : si on professe des contenus haineux, c’est aussi passible de représailles.
L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a récemment déclaré qu’un échange entre “personnes technologiques” et personnes comprenant l’humanité était nécessaire pour éviter de faire des erreurs avec le metaverse, à l’image de l’intelligence artificielle et des algorithmes de Facebook. Êtes-vous d’accord avec cette idée ?
Oui, évidemment. Le numérique prend de plus en plus d’ampleur dans notre vie de tous les jours et dans notre psychologie, donc on ne peut plus se permettre de développer des systèmes et des réflexions là-dessus sans mettre en place un garde-fou en face. Par rapport à ce projet de metaverse, on fait beaucoup référence au film Ready Player One de Steven Spielberg. On le cite comme une référence obligatoire, car il met en scène ce monde à part, mais on oublie un peu sa conclusion : les deux héros, qui étaient à fond dedans, se rendent compte que vivre purement dans le numérique est une erreur, une hérésie. Ils en arrivent à mettre en place un système de gestion avec cet univers parallèle qui est fermé deux jours par semaine.
C’est cela qui est dramatique : on ne voit qu’une partie de la pièce, que le côté « ça va être génial, il faut qu’on crée ce nouvel univers ». Le problème, c’est qu’on se jette à fond là-dedans alors que la morale de l’histoire montre qu’un garde-fou est nécessaire, qu’on ne peut pas se livrer comme ça aveuglément et entièrement au numérique. Ce n’est pas possible.