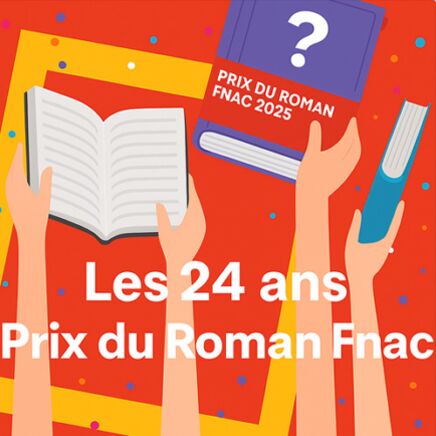Nommé au Prix du roman Fnac pour Les Hommes manquent de courage, Mathieu Palain s’affirme bel et bien comme un écrivain du réel. Rencontre.
Révélé avec son ouvrage Ne t’arrête pas de courir (12 prix littéraires), Mathieu Palain poursuit ses enquêtes au long cours. Dans son nouvel ouvrage poignant, Les Hommes manquent de courage, il se fait la voix d’une femme – Jessie – abîmée par les hommes. Alors que sa vie lui échappe, elle se retrouve à rouler toute une nuit. À ses côtés, son fils, Marco, qui a rejoint le rang de ceux qui l’ont fait souffrir. Est-il possible de réparer ce qui est brisé ?
Journaliste de formation, vous avez quitté le milieu en 2018 pour vous consacrer à l’écriture de romans. Pouvez-vous nous raconter cette transition ?
Je suis journaliste depuis une quinzaine d’années. À ma sortie d’école, j’ai collaboré avec Libération, j’étais en plein cœur de l’actualité. Contrat CDD, puis pigiste permanent… J’aimais beaucoup ce que je faisais, mais ce n’était pas évident. Et puis, j’ai été embauché par la Revue XXI en 2013, pour laquelle j’ai effectué plusieurs grands reportages pendant six ans. En 2018, j’étais comme en crise avec le métier de journaliste et le milieu de la presse en général. L’actualité ne m’intéressait plus, j’ai démissionné. J’avais une enquête en cours que j’ai décidé de poursuivre.
Grâce aux encouragements de la fondatrice et directrice de la maison d’édition L’Iconoclaste, Sophie de Sivry, je me suis essayé à la fiction. C’est en pleine “convalescence” du journalisme que j’ai écrit mon premier roman, Sale Gosse. En parallèle, j’avais envoyé une lettre à l’athlète Toumany Coulibaly, qui a donné lieu à mon deuxième roman, Ne t’arrête pas de courir.
Je suis très content de continuer à faire ce que j’aime, dans un nouveau format. Je me suis essayé au podcast aussi. Pour France Culture, j’ai fait deux séries qui s’intitulent Des hommes violents et La Photo de classe. Pour Louie Média, la minisérie s’appelle Serial Mytho. Tout ça, ce sont des histoires vraies. Je garde un pied dans le monde des médias, mais je consacre 90 % de mon temps à l’écriture désormais.
Quel est le premier roman qui vous a bouleversé ?
Durant mon collège et lycée, j’ai arrêté de lire. J’ai rattrapé mon retard en préparant les concours pour les écoles de journalisme. J’ai notamment enchaîné des lectures géopolitiques. C’est en arrivant à Libération que j’ai découvert L’Attrape-cœur, de J. D. Salinger. Je l’ai d’ailleurs offert à Toumany. C’est un livre dont je n’attendais rien : une couverture rose, un titre marqué… Ces informations me donnaient l’impression qu’il s’agissait d’un livre à l’eau de rose, à destination des adolescents.
« Je cherche à comprendre pourquoi les gens prennent à gauche alors qu’ils auraient pu prendre à droite, pourquoi ils ont l’impression de fuir en permanence leurs démons qui, au final, les rattrapent toujours. Être quelqu’un de bien ou être un méchant, un délinquant ou un modèle pour la société… Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Il est question de transmission. » Mathieu Palain
Puis l’histoire m’a littéralement retourné le cerveau. Je lisais des passages entiers à voix haute, pour moi ou pour des amis, en vacances. C’est un chef-d’œuvre. Tout le monde peut s’identifier au personnage principal, Holden, et ce, quel que soit le bord politique. Il y a peu de livres écrits de cette façon, pour un spectre aussi large de lecteurs.
À l’origine de vos livres, il y a des intuitions et des rencontres. À la genèse de ce nouveau roman, une femme vous contacte sur Facebook après avoir écouté votre podcast Des hommes violents. Savez-vous, aujourd’hui, pourquoi vous avez accepté de la rencontrer ?
J’accepte assez régulièrement de rencontrer des personnes qui font l’effort de me solliciter. Parfois, elles me remercient pour mes écrits qui les ont touchées, et parfois, elles me livrent des récits particulièrement intéressants. Quand j’ai lu le message de cette femme – Jessie, dans le récit –, j’ai eu une intuition, ou plutôt une conscience professionnelle. “Est-ce que c’est vous le Mathieu Palain du podcast ? Ma meilleure amie vient de m’envoyer les six épisodes. C’est étrange, je n’ai pas vécu ces violences, mais ça me parle. Je crois que j’avais enfoui tout ça”. Le “tout ça” implique beaucoup de choses qui ne sont pas des violences conjugales. Cette démarche très sincère, naturelle, m’a poussé à la rencontrer.
Voir cette publication sur Instagram
Au départ, je vais à ce rendez-vous presque à reculons, mais, très vite, la rencontre se révèle étonnante. Je découvre une femme de 45 ans, emmitouflée dans son manteau de fourrure. Assez rapidement – comme je le raconte dans le livre – elle m’annonce qu’elle aimerait qu’on discute un peu plus loin parce qu’elle est prof de maths et que les cafés du coin sont infestés d’élèves et de parents d’élèves. Elle monte dans ma voiture et il se met à pleuvoir – des trombes d’eau.
On se retrouve alors à rouler sans trop savoir où aller. Et puis, elle parle. Je l’enregistre tout en continuant mes tours de quartier. Plus elle se livre, plus ça m’intéresse. Elle déverse tout ce qui pèse sur ses épaules. J’écoute son flot de souvenirs, elle me fait confiance. Elle me raconte qui elle est et d’où elle vient. Et puis, au bout d’une heure et demie – elle n’a bien entendu pas terminé –, je la dépose devant son établissement, car elle a encore un cours à donner. Plus tard, quand j’écoute l’enregistrement, je réalise à quel point son récit est à la fois terrible et fascinant. Nous nous sommes revus pendant un an.
Dans votre avertissement glissé au début de votre roman, vous écrivez être incapable d’inventer une telle histoire, pourquoi ?
Ce que je lis, ce que j’aime, c’est de la fiction à laquelle je crois. J’aime ces récits, car tout me paraît vrai. J’ai peu confiance en ma capacité à inventer et j’ai une grande confiance dans le réel et dans ce qui m’est raconté par celles et ceux que je rencontre. Qui sont-ils ? Par où sont-ils passés ? Je fais confiance à ce travail très journalistique. Je n’aurais jamais été capable d’inventer le personnage de Jessie. “Là, c’est too much, ce n’est pas crédible”, me serai-je dit.

Pourquoi certains s’en sortent-ils et d’autres pas ? Cette question vous obsède. Continuerez-vous d’écrire jusqu’à trouver une réponse ?
Cette question traverse le journalisme. Que l’on écrive un article sur la commerçante du coin ou bien que l’on se lance dans une grande enquête sur l’ascension et la chute d’un athlète, on cherche à raconter une trajectoire. Ces parcours me fascinent. Je cherche à comprendre pourquoi les gens prennent à gauche alors qu’ils auraient pu prendre à droite, pourquoi ils ont l’impression de fuir en permanence leurs démons qui, au final, les rattrapent toujours. Être quelqu’un de bien ou être un méchant, un délinquant ou un modèle pour la société… Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Il est question de transmission…
Nous ne sommes pas libres de mener la vie qu’on veut et on porte le poids de nos origines. Raconter cela nous éloigne des clichés “Si on veut, on peut”, “On est des self made men…”. Nous évoluons dans une démocratie guidée par la méritocratie et, lorsqu’on rentre dans la vie des gens, on réalise que les histoires sont plus complexes.
Romans non fictifs, romans-portraits… Comment qualifiez-vous vos écrits ?
Je lis beaucoup de littérature américaine. Quand j’ai commencé à écrire Sale Gosse, je me questionnais beaucoup sur cette idée d’être un romancier, parce que je me sens profondément journaliste. Les romanciers sont ceux qui inventent des histoires. Pour ma part, je vais sur le terrain et je me baisse pour les ramasser. Mais, en réalité, personne n’invente réellement d’histoire. Même Star Wars, ou Le Seigneur des Anneaux ont été inspirés par la vie d’alors – le chaos de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Je ne fais confiance qu’à mes capacités d’observation et d’écoute pour écrire.
Je dirais que j’écris des romans qui sont vraiment des romans parce qu’il s’agit de fiction. Je ne raconte pas exactement ce qui s’est passé, mais cela reste très inspiré du réel. J’utilise des techniques très journalistiques. Je me sens très proche de cette tradition américaine du nouveau journalisme. Les Hommes manquent de courage mêle fiction et réalité. La fiction se niche dans les interstices – dans les 48 heures que vivent Jessie et Marco par exemple –, dans les détails. C’est une manière de protéger les protagonistes.
Dans ce nouveau roman, vous prenez la voix d’une femme. Était-ce un choix évident ? Comment avez-vous vécu l’expérience ?
J’ai d’abord eu la certitude de ne pas avoir ma place dans le récit, comme ça avait pu être le cas pour Ne t’arrête pas de courir – une histoire d’amitié un peu étrange plus que le récit de vie d’un champion d’athlétisme le jour et cambrioleur la nuit. Le récit de Jessie tient sans moi, je devais être honnête envers le lecteur. Et puis, j’ai eu envie de me mettre dans la tête de Jessie qui raconte ce qui lui est arrivé pendant un week-end.
« Une trajectoire de vie encore. Une vie qui bascule. C’est cela qui m’intéresse. » » Mathieu Palain
C’était justifié : j’avais passé énormément de temps auprès d’elle, à l’écouter. J’avais sa voix, j’avais la musicalité de ses phrases, j’avais sa manière de parler et j’avais son histoire telle qu’elle me l’avait racontée. Écrire, c’est être capable de rentrer dans la tête et dans la vie des autres. J’ai envie de pouvoir offrir au lecteur un récit crédible à tout point de vue. Cela demande du travail et une certaine empathie. Cela implique de partager la vie des autres, de ressentir ce qu’ils ressentent et de vivre ce qu’ils vivent, ce qu’ils ont vécu. Ensuite, il faut être capable de le retranscrire.
Il est question de soumission, d’agressions sexuelles, de viol. Comment retranscrire ces violences ?
La violence sidère et fascine le journaliste et le lecteur, mais je voulais aller au-delà. Quand elle me raconte son viol, il ne s’agit pas de le retranscrire avec détails – c’est indicible –, mais de partager son traumatisme et de montrer comment une fille première de la classe s’est juré de s’arracher à la vie qu’elle menait en tant qu’enfant, de vivre sa vie d’adulte libre, à la force de sa propre réussite.
« Je pense qu’il n’est pas décent de raconter l’histoire d’une femme sans teneur féministe. » Mathieu Palain
Elle avance en suivant les règles qu’on lui a données, en étudiant au lycée Louis Legrand. Et il y a cet événement qui arrive et qu’elle n’a pas choisi. L’injustice de la vie. Cela a des conséquences directes. Une trajectoire de vie encore. Une vie qui bascule. C’est cela qui m’intéresse.
« La haine s’évapore avec le temps. » C’est une phrase que partage Jessie dans le roman, mais que vous auriez pu dire aussi ?
On a tous ressenti la haine, comme on a tous ressenti l’amour, ou encore la jalousie. Des sentiments extrêmement humains. Et heureusement, cette haine, cette envie de casser la gueule de quelqu’un, voire de le tuer… s’évapore le temps passant. C’est une phrase qui est très importante et qui j’espère fera écho aux lecteurs : “Mais oui, c’est vrai. Pour moi aussi, cette haine s’est évaporée avec le temps.”
Bien plus tard, Jessie déclare « Je crois que ça n’existe pas, les mecs bien. » Il s’agit là d’un livre féministe…
Il y a des phrases qui sont des lignes de dialogue. Je comprends pourquoi elle prononce celle-ci, à l’instant T de notre échange. Elle la prononce au regard de sa propre histoire et de celle de son interlocutrice, sa belle-fille. Je n’ai pas fait exprès d’écrire un livre féministe, mais c’est assumé. Je pense qu’il n’est pas décent de raconter l’histoire d’une femme sans teneur féministe.
Voir cette publication sur Instagram
À qui s’adresse cet ouvrage ? Est-ce plutôt aux mères démunies ou bien à leurs adolescents qui se sentent abandonnés ?
À tout le monde. Mes premiers livres m’ont prouvé qu’ils étaient lus par des personnes très différentes. Le lecteur à qui je m’adresse n’a pas de genre, pas de sexe, pas d’âge et pas de visage. Les Hommes manquent de courage doit pouvoir parler à mon grand-père de 97 ans comme à une enfant de 13 ans qui arpente les rayons de la bibliothèque. C’est pourquoi j’écris dans un français que j’espère lisible par toutes et tous.
Quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Le dernier livre qui m’a marqué et que j’ai recommandé et offert, c’est le prix Pulitzer de l’année dernière – je n’ai pas pris beaucoup de risques. On m’appelle Demon Copperhead, publié aux éditions Albin Michel, est l’un des meilleurs livres que j’ai lus ces dernières années. Le procédé utilisé par Barbara Kingsolver est génial : elle se met dans la tête d’un gamin. Un roman social sur le sud des États-Unis à travers lequel un garçon va être confronté à de rudes épreuves. C’est très difficile à résumer, parce que c’est extrêmement riche, mais l’autrice parvient à nous faire pénétrer dans la tête d’un enfant. Le temps de la lecture, il devient un membre de notre famille.
Les Hommes manquent de courage, de Mathieu Palain, L’Iconoclaste, le 22 août en librairie.
À lire aussi
À lire aussi