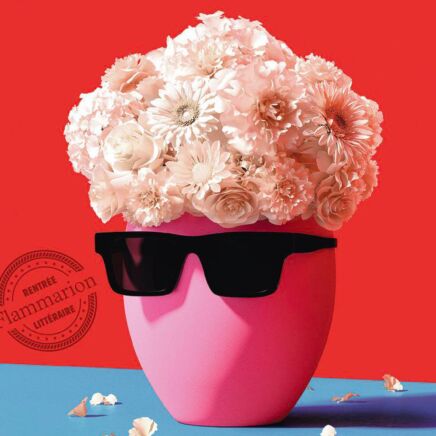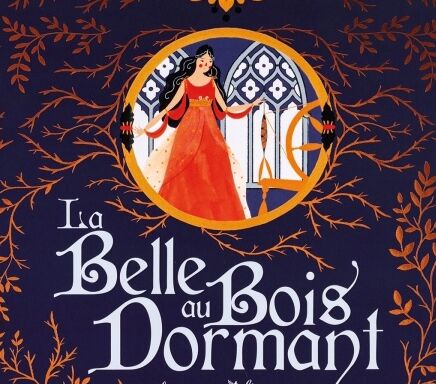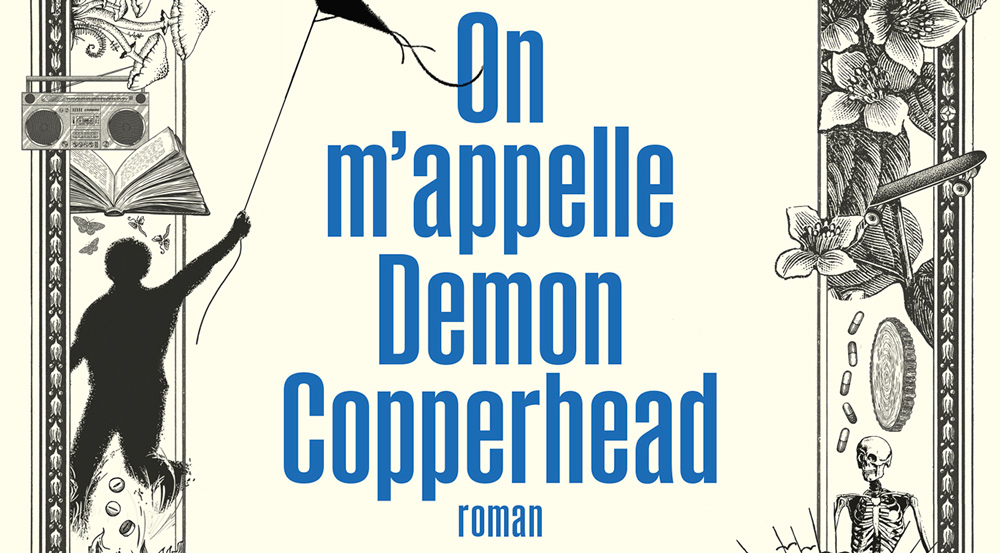
Transposition du David Copperfield de Dickens dans l’Amérique rurale On m’appelle Demon Copperhead (Albin Michel) de Barbara Kingsolver est une fiction monumentale. 600 pages couronnées d’un prix Pulitzer, dans le flux de conscience d’un enfant au bagout détonant, mais auquel rien ne sera épargné de cette Amérique périphérique, celle des ravagés et des laissés-pour-compte, souvent décrite, mais toujours incomprise.
Du père mort avant sa naissance aux familles d’accueil et à l’aide sociale, de la crise des opioïdes aux désenchantements amoureux, le jeune Damon – surnommé Demon du fait de ses cheveux roux – écrit les récits, comme autant de preuves de sa vitalité hors norme : une langue ironique et affectueuse que la traduction rend plus âpre encore.
Noir, c’est noir ?
Son récit est celui d’un jeune addict qui se sèvre et qui, sur le conseil d’une bonne amie, se livre dans un journal. Métis d’un père Marangon, un peuple autochtone, et d’une mère blonde et blanche, le petit Damon est vite livré à la violence d’un beau-père, puis à celle de l’aide sociale à l’enfance. De foyer en foyer, il multiplie les rencontres et les observations. La joie d’une nature offerte aux enfants – topos fréquent de la littérature américaine – se heurte à une adolescence à marche forcée. Mais tout n’est pas noir, ici.
« Déjà je me suis mis au monde tout seul. Ils étaient trois ou quatre à assister à l’événement, et ils m’ont toujours accordé une chose : c’est moi qui ai dû me taper le plus dur, vu que ma mère était, disons, hors du coup. »
On m’appelle Demon Copperhead
Bien que « cassos des mobile homes », Damon constate aussi, dans le tumulte des placements à répétition, la présence de bonnes âmes, mains tendues ici ou là que sa tignasse rousse et ses yeux verts ne manquent pas de susciter. On est tenté d’y croire. Puis, la seconde partie du livre s’ouvre. Une blessure au genou remise les rêves aux oubliettes : il n’y aura pas de carrière dans l’équipe de football de la ville. Damon le coureur boite. La douleur est là et, avec elle, l’addiction aux oxy et autres opiacés qui s’abat sur la ville. Damon coule – ou croit couler –, se relève. Le récit porte, accompagne, ose la fiction au sens complet du terme pour dire le vrai à hauteur de gamin et prendre son lecteur aux tripes.
« J’ai collé mon visage contre la vitre pour que personne voie, si jamais je craquais. Alors j’étais ça maintenant, pour la vie ? À prendre la place là où les gens ne voulaient pas de moi ? À un moment, j’étais quelque chose, et puis soudain j’avais tourné, comme du lait caillé. Le gamin de la junkie morte. Un petit morceau pourri du rêve américain dont le monde aimerait être, enfin vous voyez. Débarrassé. »
On m’appelle Demon Copperhead
Dickens dans les Appalaches
On m’appelle Demon Copperhead ne cède pourtant jamais à la facilité d’une description sinistre et misérabiliste : c’est aussi le livre d’un territoire. Celui des Appalaches où l’autrice s’est installée avec sa famille. Née en 1955 dans une famille de la middle class (père médecin, formation de biologiste), Barbara Kingsolver a une solide carrière d’écrivaine derrière elle depuis son premier livre, L’Arbre aux haricots (Rivages), publié en 1996. Militante pacifiste et féministe dans les années 1970 – l’engagement politique est au centre de Sur les piquets de grève (Les Bons Caractères), paru en 2023 en France –, elle s’attache ici à chercher l’épicentre des ruptures américaines.
Le comté de Lee, du nom du grand général sécessionniste de Virginie, est ainsi un bout de montagne rural, désindustrialisé, une sorte de Creuse américaine où les mines de charbon ont fermé depuis longtemps. Mais, au lieu de l’aborder par le haut, depuis New York, elle décide ici de faire confiance à ses personnages pour le faire exister sans mépris ou condescendance.
Hors de toute approche documentaire, elle parvient à démontrer l’immense sentiment d’humiliation de cette Amérique-là, le racisme mécanique de ceux qui y vivent et qui pensent qu’être « blanc est la dernière chose qui leur reste », mais aussi le véritable torrent de problèmes qui soude, au fond, cette communauté et la force à une intersectionnalité des humiliés, des rednecks autant que des pèquenauds. Kingsolver ne racise pas ses personnages, elle les fait exister en montrant les points communs de leurs humiliations et de leurs drames, l’assise possible des générosités partagées.
« Pèquenaud, c’est comme le mot qui commence par un n. pour les Noirs. Tu dois jamais prononcer ce mot à part si t’es un vrai connard. »
On m’appelle Demon Copperhead
On le comprend, le spectre de Trump, même s’il n’est jamais évoqué, rôde et explique aussi, en contrepoint, le succès d’un livre qui tente la passerelle entre le discours d’une gauche américaine inquiète et urbaine, avec un monde qu’elle connaît mal et dont elle voudrait ignorer l’existence. Or, On m’appelle Demon Copperhead lui rappelle, dans la plus pure tradition steinbeckienne, que c’est aussi de la terre que surgirent ses contestations les plus fertiles.

Nécessités (et limites) des bons sentiments
Dédié aux « enfants qui tous les jours se réveillent la faim au ventre, à qui la pauvreté et les antidouleurs ont volé leur famille, dont les assistantes sociales perdent sans cesse les dossiers, qui se sentent invisibles, ou aimeraient l’être », On m’appelle Demon Copperhead est un livre éprouvant autant qu’animé par une véritable maestria dans l’art du récit. Presque dénué d’ellipse, long, trop riche parfois du fait d’une ambition démesurée, il n’est pas sans défaut, mais saisit néanmoins son lecteur par la vraie grâce des personnages secondaires, femmes essentiellement, déchues, survivantes et militantes.
« Comme dit le proverbe : quand ils ont distribué l’intelligence, il a compris diligence et il a raté la sienne. Ça, c’était Swap-out. Tommy, par contre il était futé comme un diable et trouvait moyen de se sortir de n’importe quelle situation, mais ensuite hop il replongeait aussitôt. On aurait dit qu’il choisissait d’être dans la merde, pour que personne ne lui prenne sa place. C’était pénible à voir. »
On m’appelle Demon Copperhead
Alors que Trump est en passe de remporter la primaire républicaine, les happy ends qu’il envisage peuvent sembler illusoires. Néanmoins, c’est là le message du livre : les récits sauvent, d’autant plus qu’ils sont communs. Miraculeuse, donc, l’immense gouaille du petit Da(e)mon – qui signifie « puissance primordiale » en grec –, dont la seule malédiction est d’être toujours humain, aimé, aimant, lessivé par le sort jusqu’à s’en tirer enfin pour mieux faire à son tour la chronique d’un monde qui n’est pas dit et auquel on a, le livre refermé, l’impression d’appartenir.