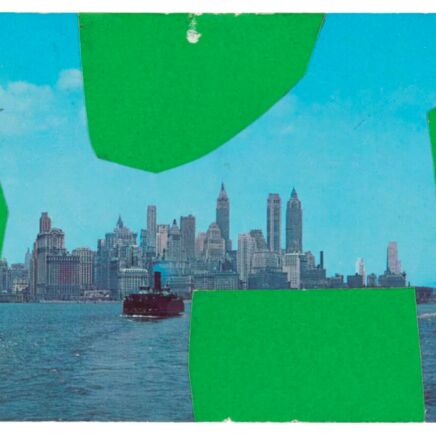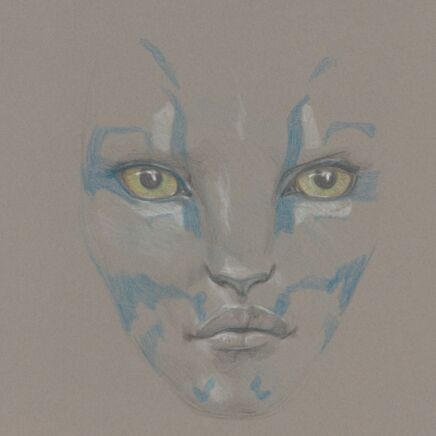Jusqu’au 21 janvier, L’Art dans la nature, parcours en sons et lumières, donne à voir des œuvres originales de l’artiste catalan, au parc de La Villette, à Paris.
D’abord, il y eut André Breton. Ou peut-être Apollinaire. Ou encore Aragon, Buñuel, Kahlo, Picasso. C’était il y a 30 ans ou plus, je découvrais le surréalisme. Sur ma vie intellectuelle naissante, vaste champ jusqu’alors sans repères, le genre issu de dada saupoudrait des idées pailletées par poignées : liberté de création, interaction du réel et de l’imaginaire – mais aussi implication politique, art-révolte émancipateur. Protéiforme et lumineux, il créait du relief dans mon espace jusqu’alors en 2D, distillait de la couleur au sein de ma palette de gris.
Un espace immersif
Protéiforme et lumineux : tel est justement le parcours proposé par le producteur Letsgo, dans une mise en scène, jusqu’au 21 janvier au parc de La Villette à Paris, d’œuvres originales de Salvador Dalí. Au cours de cette balade nocturne de 45 minutes, les créations lumineuses réalisées pour l’occasion, associées à des ambiances sonores planantes, ouvrent un espace immersif pensé pour ravir tous les publics à l’approche de Noël.
Mais alors, qu’a-t-on fait de l’art-révolte ? Dalí ne serait-il plus qu’un prétexte à décliner des objets iconiques – montres molles, éléphants aux pattes fragiles, fourmis grouillantes ?

Je découvrais les travaux des surréalistes en parallèle de mes premières lectures de Sigmund Freud. Les études en sciences humaines, si elles ne vous forment à aucun des impératifs de la vie courante, ont ceci de formidable qu’elles vous ouvrent les portes de réalités alternatives, passées et présentes, et démultiplient vos capacités à vous déployer à titre personnel. Psychanalytique, artistique… Il y avait donc d’autres sens de lecture du monde que ceux donnés par le journal télévisé ou les cours de la Bourse…
Psychanalyse et camembert coulant
À l’heure où d’autres faisaient le pied de grue devant Le Palace ou Les Bains-Douches, je m’entichais des Cinq Leçons sur la psychanalyse ou encore de Sur le rêve. Dans le même temps, et alors qu’un professeur nous encourageait à écrire nos rêves afin de créer une matière à réfléchir, je découvrais les montres molles de Dalí, sa vision d’un temps conçu par l’homme dont il donnait ad nauseam une représentation de camembert coulant.
Entre l’œuvre du neurologue autrichien et celle de l’artiste catalan, j’avais alors le sentiment de débobiner des idées – les leurs – à toute vitesse. Mais il y avait aussi cet autre champ, qu’on m’avait encouragée à ouvrir : le mien propre. Et entre mon espace onirique, la possibilité d’une vie inconsciente et un bouillonnement en lien probable avec la jeunesse, je tombais dans le trou d’Alice. J’étudiais scrupuleusement les textes de l’un, m’absorbais dans les représentations photographiques des œuvres de l’autre. Sans encore le savoir, je me créais une première lecture personnelle de mon lien au monde.

C’est ainsi que Dalí, entre symboles inquiétants et symbolisme religieux, me prit au piège de son œuvre. Je me revendiquais de sa liberté de création, de son audace ; mais je cherchais aussi à comprendre les paradoxes que je croyais voir entre un Christ de Saint-Jean de la Croix (1951) – à la fois classique et tellement moderne – et la nature galopante du Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une grenade, une seconde avant l’éveil (1944).
Ce que je ne savais pas, alors, c’est qu’un être humain, tout Dalí fût-il, est constitué d’une somme de vécus. Qu’il n’est pas un porte-drapeau clamant la tradition ou l’originalité. Et que ses contradictions apparentes se nourrissent de l’agglomérat d’histoires heureuses ou malheureuses, de terreurs, d’émotions, d’errances intellectuelles et personnelles.
Des hommes et une femme
De fait, Salvador Dalí a de quoi faire en matière d’histoire complexe. Il naît en 1904, neuf mois après le décès de son frère, dont il porte le même prénom. « Mon côté loufoque, c’est mon côté le plus tragique, puisqu’il m’a permis de me dégager de mon frère mort », disait-il en 1961. Sa mère adorée décède alors qu’il n’a que 16 ans. Mais celle-ci a eu le temps d’encourager le garçon qui déjà expose dessins et peintures à Figueras ou à Barcelone.
Dalí rencontre Miró, Buñuel, Picasso. Il s’ouvre les portes des surréalistes, pourtant difficiles à convaincre, avec le court-métrage Un chien andalou, dont il cosigne le scénario avec Buñuel. Et puis il rencontre Gala, une femme d’origine russe de dix ans son aînée, qui est alors l’épouse de Paul Éluard et la maîtresse de Max Ernst. Gala est l’autre figure adorée de Dalí. Tantôt en maîtresse de Zeus (Léda atomique – 1949), tantôt en madone (La Madone de Portlligat – 1950), elle incarne l’être aimé, l’amour absolu.
Pour ma part, je la découvrais de dos dans Ma femme, nue, regardant son propre corps devenir escalier, trois vertèbres d’une colonne, ciel et architecture (1945) : une perspective qui questionne, des éléments dérangeants, un délicat travail classique (notamment sur les textures), plusieurs lectures possibles de cette œuvre propice à la rêverie autant qu’au jeu du décryptage.
Mais, au-delà du travail de l’artiste, il y avait le regard de l’homme aimant. De l’amant. Une sensualité délicate, comme un désir murmuré. Tel est l’autre Dalí que j’envisageais alors : un amoureux intrinsèquement passionné, une figure romantique quasi romanesque.

Et puis je lus quelque part que l’artiste catalan avait eu une admiration pour Hitler (un « phénomène surréaliste », selon lui), une sympathie pour Franco. Je découvris le Dalí VRP de lui-même, l’influenceur avant l’heure, le businessman à l’ego surdimensionné dont on se demande s’il est génial ou bon à enfermer. Un jour de 1955, il embarque un millier de choux-fleurs pour les distribuer à l’issue d’une conférence qu’il tient à la Sorbonne. En 1958, il fait fabriquer une baguette de pain (l’une de ses figures rhétoriques) de 12 mètres de long avec laquelle il pose à la Foire de Paris.
Le temps passant, Dalí continue de produire, mais il se régale davantage des scandales dont il se fait l’objet, des commandes vulgaires qu’il honore (cravates, décoration d’une discothèque new-yorkaise, spot télé pour un chocolat). Le surréalisme avait vécu, ses icônes achevaient de se désagréger, l’artiste était plus publicitaire que politique.

“Une perte de raison momentanée”
Le temps a passé. Comme vous le feriez pour un vieil ami qui se serait éloigné, j’ai fait semblant d’oublier, j’ai trié. De l’artiste catalan, je garde un souvenir ému et je lui suis reconnaissante.
Mon quotidien consiste aujourd’hui à enrichir le lien au monde que je découvrais avec Freud et Salvador Dalí. Cette promenade dans le parc de La Villette, parmi les montres molles et les fourmis illuminées et sonorisées à la manière d’un concert de Pink Floyd, m’a finalement transposée dans un espace pas si éloigné de celui où je les découvris – ludique, planant, inquiétant aussi.
Signe des temps, l’art est aujourd’hui moins synonyme de révolte que de spectacle. Plutôt que critique ou politique, on le préfère expérientiel. En cela, montrer des bronzes de Dalí dans un univers féerique entre nuit hivernale, délicatesse de la nature et magie des créations son-lumière est une réussite. On pénètre sans le savoir dans une bulle ; on est bientôt happé par l’émerveillement autant que par un sentiment de paix. Les branches des arbres et les bambous se meuvent délicatement, illuminés de couleurs, tels des danseurs s’invitant en arrière-plan.
Le parc lui-même devient autre, redécoupé par les effets de fumigènes ou de créations vidéo. On a bientôt le sentiment d’évoluer dans un de ces rêves si chers à l’artiste catalan et à ses collègues surréalistes. Un moment de poésie vécu par l’entremise de nos sens, au sein duquel les œuvres de Dalí semblent parfaitement à leur place.
L’Art dans la nature : l’extravagant parcours lumineux de Dalí. Jusqu’au 21 janvier, au parc de La Villette, à Paris. Du lundi au jeudi de 17h à 22h ; vendredi et samedi de 17h à 22h30 ; dimanche de 17h à 22h.