
Les États-Unis inquiètent : entre régression sociétale et effrois post-démocratiques, le pays-continent semble plus que jamais enchevêtré entre cauchemar et rêve. Mais l’énigme de cette Amérique irréconciliable a en réalité toujours existé. La littérature américaine est elle-même l’un de ses noms, la tentative sans fin de sa définition. Comment, par ses romans, comprendre l’Amérique d’aujourd’hui, sans cesse fractionnée, mais plus vivante que jamais ?
De la misère des ouvriers agricoles décrite magistralement par Steinbeck dans Les Raisins de la colère (1939) à Beloved (1987) de Toni Morrison, qui raconte le deuil impossible d’une ancienne esclave après la guerre de Sécession, c’est l’Amérique des villes moyennes et de la ruralité qui a donné naissance aux plus grandes plumes américaines. Une Amérique cruelle, raciste, sans illusion.
De ce pays-là, Carson McCullers fait la synthèse grandiose et sensible. On croise par exemple dans Le Cœur est un chasseur solitaire (1940) les figures inoubliables d’une jeune fille de famille de prolétaires blancs en déréliction, un médecin afro-américain à la révolte silencieuse, un trimardeur révolutionnaire et alcoolique. Autant de fragments d’existence ordonnés avec la délicatesse de vitraux dont surgira une subjectivité unique : le roman choral comme espace possible de coexistence.
Malheureux comme un Américain en France
Pour échapper à cette Amérique, les auteurs et autrices américains sont souvent venus chercher en France une terre curieuse et plus accueillante. D’Ernest Hemingway à Henri Miller, en passant par Fitzgerald, les grands noms de la génération perdue ont ainsi hanté les rues de la capitale. De l’érotisme solaire de Tropique du Cancer (1934) au charme irrésistible de Paris est une fête (1964), ces classiques brulants annonçaient déjà les canicules à venir. Et puis le Sud, celui de la Provence et de la Côte d’Azur, où Fitzgerald écrivit Gatsby le magnifique (1926), cette fable bling bling dont l’exubérance dissimule mal les mélancolies estivales.
C’est le même chemin que James Baldwin emprunte en 1948 ; Paris, d’abord, puis la Provence où il s’installe, espérant échapper à la double malédiction d’une identité afro-américaine et homosexuelle. Harlem Quartet, chef-d’œuvre traduit en 2003, mais publié en 1979, est ainsi l’un de ces romans dont on ne se remet pas – gospel d’une dureté et d’une tendresse infinies, requiem d’une époque qu’on souhaiterait tout à fait révolu.
Il chantait pour Crunch – pour protéger Crunch et le faire revenir, et il chantait pour moi, pour me protéger et me faire revenir : il chantait pour sauvegarder l’univers. Et dans sa voix pénétra alors une douceur solitaire d’une telle puissance d’émotion que les gens en demeuraient pétrifiés, métamorphosés : il chantait leur amour et leur inquiétude, il chantait leur espoir. Avec son chant il se confessait au public au pied du trône de la miséricorde et, tandis que sa voix s’élevait, il se savait racheté, aux mains d’un pouvoir plus grand qu’aucun sur terre. Son amour fut sa confession, son témoignage, son cantique.
James BaldwinHarlem Quartet
Cruelle apothéose
Mais les fractures américaines ne se résument pas seulement à la question raciale. Dans son livre Price (1984), le scénariste et romancier Steve Tesich dresse ainsi le portrait grandiose et vivant d’un premier amour raté à East Chicago, métaphore du rendez-vous manqué entre le personnage principal et sa ville, autrefois fleuron industriel et dont la désindustrialisation signe l’arrêt de mort et les exodes forcées.
La catastrophe n’est toutefois pas sans joie, ni sans la possibilité d’un humour – mauvais. Dans la filiation d’Hubert Selby Junior, Brett Easton Ellis a quant à lui développé une œuvre pop, baroque et souvent sanglante. Au culte American Psycho (1991) on ajoutera le recueil de nouvelles Zombies (1994), qui décrit la jeunesse de Los Angeles dans les années 1990, entre fête, vide existentiel, humour grinçant et snuff movie.
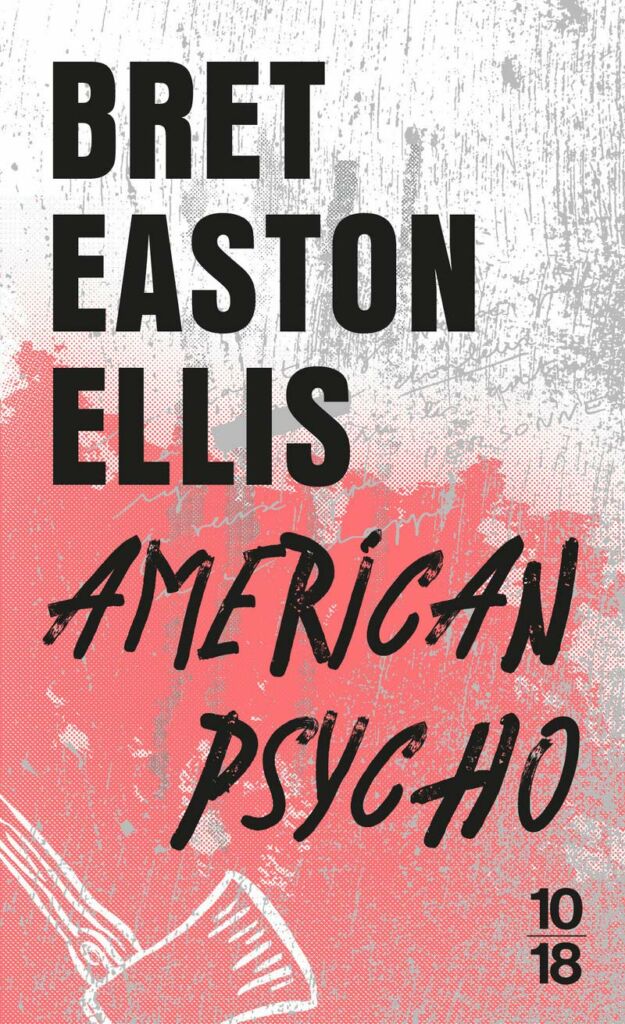
Générations X, Y, Z : (re)dire le vrai
Entre villes et campagnes, noirs et blancs, intellectuels new-yorkais et ouvriers de la Rust Belt, les littératures américaines ont ainsi décrit des réalités qui se recoupent rarement. C’est pourtant dans les espaces interstitiels qu’elles sont en train de se réinventer. Au croisement des thématiques identitaires, qu’elles soient de genre, raciales ou sociales, Un bref instant de splendeur (2021) d’Ocean Vuong s’impose comme le roman ultime d’une nouvelle génération d’autrices et auteurs américains.
Ocean Vuong signe en effet le roman d’un paradoxe : le livre est une longue lettre adressée à sa mère, immigrée vietnamienne qui, ne sachant pas lire l’anglais, n’accédera pas à la langue de son fils. Dernière production du jeune auteur, c’est peut-être la redéfinition la plus contemporaine de l’Amérique par sa littérature – et du même coup par sa jeunesse. Sans surprise, pour échapper à la standardisation du creative writing, elle est celle d’un poète amoureux que ni les opioïdes, ni les suicides, ni l’air irrespirable de l’intérieur des caravanes ne semblent pouvoir abattre.
J’ai 28 ans, je fais 1m63, 51 kg. Je suis beau sous trois angles exactement et sinistre de partout ailleurs. Je t’écris de l’intérieur d’un corps qui autrefois t’appartenait. Autrement dit, je t’écris en tant que fils.
Ocean VuongUn bref instant de splendeur






















