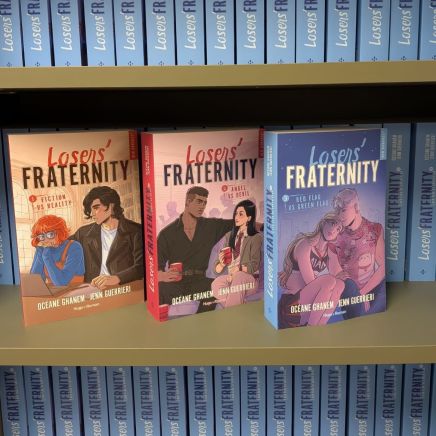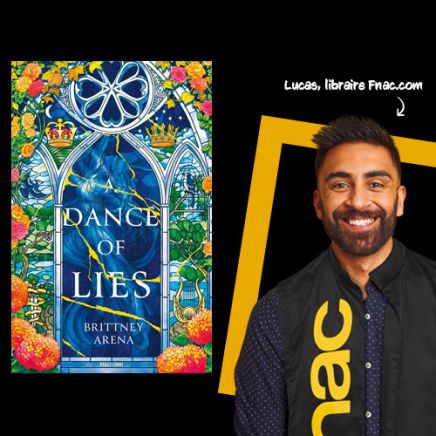Avec Les belles promesses, Pierre Lemaitre clôt le septième volet d’un projet entamé il y a 13 ans avec Au revoir là-haut. Roman historique, drame familial, épopée au long court : pour L’Éclaireur, l’auteur nous parle de sa vision de la France et revient sur son ambition de « feuilleter le siècle ».
Le décor de ce quatrième tome, c’est la France, de septembre 1963 à janvier 1964. À quoi ressemble le pays à cette époque ?
C’est une période assez exceptionnelle. Si vous regardez les chiffres de la société française dans ces années-là, vous vous rendez compte qu’effectivement, ça va plutôt bien. Alors, le fait que ça aille plutôt bien pour tout le monde ne veut pas dire que ça va bien pour tout le monde. Comme dans toutes les sociétés florissantes, il y a beaucoup de gens à la marge. Mais j’ai l’impression que cette époque n’a pas beaucoup d’équivalents dans l’histoire de France.
Les parents sont à peu près certains que leurs enfants auront une meilleure vie qu’eux. On est très très loin de la réalité d’aujourd’hui. Un des marqueurs de ce bien-être, c’est le fait que la confiance dans l’avenir est absolue. D’ailleurs, François le dit dans son épilogue. “Au fond, cette période-là, on dirait presque la dernière page du XIXe siècle.” C’est le dernier moment où le pays à peu près tout entier a une confiance aveugle dans son avenir. Il n’y a pas beaucoup de périodes dans l’histoire de France dont on pourrait dire la même chose.
« Toute la difficulté narrative, c’est effectivement d’avoir autant d’égard pour Hercule Poirot que pour Columbo. » Pierre Lemaitre
Vous parlez des Trente Glorieuses comme de “la dernière page” du XIXe siècle. C’est inattendu, dans la mesure où c’est précisément à ce moment-là que se développent les sociétés de consommation telles qu’on les connaît aujourd’hui…
Oui, vous avez raison. Sauf qu’à l’époque, on ne sait pas. Si, aujourd’hui, on jette un œil historique sur cette période, on voit bien qu’effectivement, on fabrique l’hyperconsommation qui va créer le réchauffement climatique et qui, peut-être, va coûter une partie de son existence à l’humanité dans quelques décennies. C’est une période absolument tragique, mais mettons-nous à la place des gens qui vivent en 1963-1964. Qui, à cette période, va croire René Dumont en 1974, candidat écologiste à la présidentielle, qui boit un verre d’eau devant les caméras de la télévision en disant : “Je bois un verre d’eau à votre santé parce que, dans quelques années, vous n’en aurez plus” ? Tout le monde s’esclaffe. Je répugne beaucoup à avoir des personnages qui seraient plus intelligents que leurs contemporains. Ce serait facile aujourd’hui de fabriquer un personnage qui aurait tout compris, et qui, en 1963, pourrait prédire ce qu’il va se passer 60 ans plus tard. Je trouve que c’est moralement criminel. Je me méfie beaucoup des romanciers qui ont toujours l’air d’être plus intelligents que leur public.
On plonge dans un Paris en plein bouleversement, à l’image du reste de la France. De grands chantiers défigurent la ville. La tour Montparnasse, La Défense… Mais c’est le périphérique qui retient votre attention. Votre personnage, Jean, prend d’ailleurs des parts dans sa construction. Qu’est-ce que ce chantier a de si emblématique ?
Quand je commence ce roman, je cherche un symbole que tout le monde peut comprendre assez vite. J’ai plein d’objets de la consommation courante à l’époque qui s’offrent à moi, mais aucun ne ratisse aussi large que la voiture. La bagnole, c’est le symbole numéro 1 de ces années-là. C’est un objet que finissent par acquérir des gens qui, 30 ans plus tôt, n’auraient même pas pu l’espérer. C’est aussi un symbole de la lutte des classes, parce que vous avez les voitures de riches et les voitures de pauvres. Il suffit de regarder dans la rue pour savoir globalement quels sont les moyens des gens.
Ceux qui roulent en Dauphine ont moins de moyens que ceux qui roulent en Frégate, en Ariane ou en DS 19. C’est aussi un symbole de liberté. C’est l’idée d’un espace qui s’ouvre à nous. On peut aller quasiment sans s’arrêter de Lille à Marseille, en passant par Paris et le boulevard périphérique. J’ai besoin également de quelque chose qui symbolise la ville et la campagne. Le périph’ était pratique parce qu’il a ses exclus. Pour construire le périphérique, il a fallu qu’on mette des gens dehors. À travers le cheminement du personnage de Manuel jusqu’à Paris et au boulevard périphérique, j’avais les exclus de la ville et ceux de la ruralité. Regardez comme, aujourd’hui, avec les manifestations paysannes, ce roman sonne, hélas, relativement juste !
« J’estime que mes personnages doivent faire ce que je leur commande de faire. Il n’y a pas de tribunal des prud’hommes chez Lemaitre. » Pierre Lemaitre
À propos de Manuel, vous dites : “Il ne voulait tuer personne, mais se faire entendre. Sévir sur le monde comme le monde avait sévi sur lui.” En quoi Manuel incarne-t-il la violence de cette époque ?
Je crois qu’il l’incarne doublement. À la fois parce qu’il est paysan et parce que c’est un immigré. En tant que paysan, il subit l’exode rural, auquel vont être condamnées un très grand nombre de familles françaises, qui vont disparaître au profit des industries agroalimentaires modernes que défend aujourd’hui la FNSEA. Et, en même temps, c’est un immigré. Normalement, il devrait avoir sa place. C’est un immigré de la deuxième génération, son père est parfaitement intégré, lui aussi est parfaitement intégré, comme sa sœur. Sauf qu’il ne l’est pas vraiment. Et ça, cette durabilité, en quelque sorte, de la notion d’immigré, de celui qui vient d’ailleurs et qui prend une place qui n’est pas légitime, c’est une chose qui vient de très très loin et qui est encore vivace aujourd’hui.
Voir cette publication sur Instagram
L’intrigue centrale de ce dernier tome, c’est l’enquête de François, qui est journaliste, sur son frère Jean. Il le soupçonne d’être un tueur en série. Et plus François se rapproche de la vérité, plus un dilemme déchirant s’impose. Qu’est-ce qui se joue en lui à ce moment-là ?
L’idée de travailler sur une famille a séduit beaucoup d’écrivains. C’est dans la famille que se nouent naturellement, presque mécaniquement, les liens les plus forts. Là où toutes les passions peuvent être chauffées à blanc. Dans la tragédie grecque, ce ne sont que des histoires de famille. C’est en quelque sorte une miniature de la société. Je ne fais pas différemment. J’ai conduit l’histoire d’une famille pendant quatre volumes ; fondamentalement, il faut que cette histoire se termine par une note de tragédie. Ce que j’essayais de cultiver, c’était l’idée que le lecteur soit en surplomb par rapport à l’histoire. En d’autres termes, le lecteur, lui, sait la vérité. Qu’il ait lu les trois autres volumes ou pas. S’il les a lus, il en est certain dès la première page. S’il ne les a pas lus, très vite, il comprend que, vraisemblablement, Jean est un multirécidiviste du crime.
Le lecteur en sait beaucoup plus que le personnage. Il est donc le seul à comprendre que toute la famille a une épée de Damoclès au-dessus d’elle. Tous les membres de la famille sont menacés, mais quasiment aucun ne le sait, sauf François. Si François lâche cette épée de Damoclès, là, on a une tragédie qui va décimer absolument tout le monde. Je joue sur ce dilemme intérieur de François, qui va tenir le rôle principal dans ce livre. J’essaie de placer le lecteur et la lectrice dans la position suivante : “Qu’est-ce que je ferais dans une pareille situation ?” La situation est d’autant plus tragique que François n’a le choix qu’entre deux mauvaises solutions.
Pourtant, vous ne livrez pas la vérité sur Jean dès le départ. Ceux qui n’ont pas lu les tomes précédents en apprennent plus à son sujet au fur et à mesure que François avance dans son enquête. En revanche, ceux qui sont déjà familiers avec la saga connaissent la vérité. L’expérience de lecture est donc différente si on commence tout juste la tétralogie ou si on la suit depuis le premier tome. Dans un cas, on est dans l’inspecteur Columbo, dans l’autre, c’est un Hercule Poirot !
Tout à fait. Mon rôle, c’est d’écrire une saga, c’est-à-dire quatre volumes qui représentent une suite temporelle, dans l’ordre chronologique de l’histoire de la famille. Mais, en même temps, je veux que chaque volume soit indépendant et que n’importe quel lecteur puisse prendre n’importe lequel de ces quatre volumes et y trouver du plaisir. Je suis donc obligé de maintenir le doute pour ce primolecteur de la saga, tout en ne prenant pas celui qui sait pour un imbécile. Toute la difficulté narrative, c’est d’avoir autant d’égard pour Hercule Poirot que pour Columbo.
Parlons de vos personnages. Il y en a un, en particulier, que j’espère secrètement retrouver au chapitre suivant. C’est Geneviève, une femme profondément méchante et cruelle, qu’on déteste autant qu’elle nous fascine. Cette méchanceté-là, quelle matière littéraire est-ce pour un romancier ?
Vous n’imaginez pas le bonheur que c’est. Dans la vie, ce sont des personnages que vous ne supporteriez pas cinq minutes. Mais, comme c’est un personnage assez drôle, excessif, exorbitant, il est difficile de se débarrasser du plaisir de la détester. Elle n’a aucune limite dans la méchanceté. Nous avons tous connu des gens mauvais. On sait que ces gens-là sont capables d’aller loin. C’est ce qui nous fascine. Rappelez-vous ce que disait Hitchcock : “Meilleur est le méchant, meilleur est le film.” Il ne se trompait pas. S’il n’y avait pas Javert, la destinée de Jean Valjean, on s’en ficherait un peu. Toute l’astuce de Victor Hugo, c’est de placer face à Jean Valjean un antagoniste qui soit un vrai méchant.
Je pense que, dans cette famille, Geneviève attire les regards. Ce que j’aime dans la littérature, c’est de prendre du plaisir par délégation. De pouvoir trucider les méchants. Dans la vie, ce n’est pas possible, les méchants sont souvent au pouvoir. Donald Trump, tout le monde rêve qu’il se fasse crever par un autobus. Mais bon, dans la vie, ce n’est pas ce qu’il se passe. Dans la vie, Trump est réélu Président des États-Unis.
Voir cette publication sur Instagram
On entend fréquemment des écrivains expliquer qu’à un moment donné, leurs personnages leur échappent, qu’ils finissent par dicter eux-mêmes leur propre destin, comme s’ils s’émancipaient de leur créateur. Est-ce que cela vous parle ?
J’ai des confrères qui sont bien généreux. C’est le rare domaine où je suis vraiment un homme de droite. J’estime que mes personnages doivent faire ce que je leur commande de faire. Et s’ils ne sont pas contents, je les fous dehors aussitôt. Il n’y a pas de tribunal des prud’hommes chez Lemaitre. Mes personnages ne m’échappent pas… Je plaisante. Ce que je veux dire, c’est que j’entends rester maître de mes personnages. Je considère le personnage comme un outil de travail. J’ai besoin qu’il incarne ce que je veux dire sur le monde. Pour ça, il faut que je reste le patron de cette histoire et que je ne la laisse pas déborder. C’est la raison pour laquelle j’ai un lien affectif avec chacun des personnages. J’entretiens avec chacun d’eux une relation d’amour paternel. On est bien placé pour savoir que les pères ont toujours leurs enfants préférés, mais, quand ils sont de bons pères, ils ne le disent à personne. C’est pareil pour moi, j’ai mes préférés, mais je ne le dis pas.
Si on s’intéresse à votre saga dans son ensemble, tout commence avec la parution d’Au revoir là-haut, prix Goncourt en 2013. Lorsque sort ce premier tome, aviez-vous déjà en tête l’idée d’une grande traversée du siècle en plusieurs tomes ?
Non, je l’ai construit à la fin d’Au revoir là-haut. J’étais loin de savoir que ce livre aurait une destinée un peu exceptionnelle. Ce dont j’étais certain, c’est que j’avais pris le plus grand plaisir d’écriture de toute ma vie de romancier. C’était un plaisir auquel je n’étais pas du tout prêt à renoncer. La première image qui m’était venue, c’était de me dire, je viens de faire les années 1920, finalement, l’entre-deux-guerres, c’est trois décennies, donc je pourrais peut-être faire une trilogie. Je suis parti sur ce principe-là. Et plus j’avançais dans ce cycle, plus les personnages me plaisaient, plus ce projet me tentait.
J’étais le seul à y croire. Quand je disais, après Au revoir là-haut, en 2014 : “Je vais faire une série romanesque pour couvrir tout le siècle”, tout le monde se marrait. Je me rappelle, j’ai des confrères, de très bons copains, qui me disaient : “Mais arrête avec ça. Ça ne marche jamais. On est tous partis comme ça avec un bel enthousiasme sur des projets pharaoniques. Dans la réalité, tu verras…” Alors, tous ces gens-là, je leur envoie mon livre. Ils doivent commencer secrètement à me haïr, mais je ne vous cache pas que j’ai quand même une certaine satisfaction. Si je regarde le monde éditorial français, on n’est pas très nombreux à avoir eu une grande ambition comme celle-là, en étant un romancier résolument populaire, lu par toutes les catégories de lecteurs.
C’est typique des grandes ambitions romanesques du XIXe. Émile Zola dressait à l’avance des listes qui annonçaient déjà les dix livres qu’il allait écrire.
Vous avez raison sur le plan de l’histoire littéraire, bien évidemment, mais rendez-vous compte que ce qu’on a inventé au XIXe siècle, le feuilleton, est la forme aujourd’hui reconnue comme la plus moderne, parce que c’est le modèle des séries télé. Dans une série télé, chaque épisode doit vous donner envie de voir l’épisode d’après et, à la fin de chaque saison, vous donner envie de regarder la saison d’après. C’est exactement le moteur du feuilleton. Or, c’est nous, les romanciers, qui avons inventé au XIXe siècle cette modalité narrative, qui est aujourd’hui la plus communément admise dans le monde entier. On peut regarder des séries indiennes, des séries chinoises, des séries coréennes.
Alors moi, je ne suis pas tellement d’accord avec le fait qu’on nous dise : “Vous avez prévu des feuilletons, un peu à la manière du XIXe.” Les séries n’arrêtent pas d’écrire à notre manière à nous, et on trouve les séries très modernes. Je suis toujours un peu véhément quand il s’agit de ça. J’ai entendu quelqu’un me dire : “Vous êtes le dernier grand écrivain du XIXe siècle.” Celui-là, je peux vous dire, il a pris une volée de bois vert.
À travers ces livres, vous dites vouloir “feuilleter le XXe siècle”. Qu’est-ce qui vous plaît dans l’idée de feuilleter et non pas de raconter ?
Il faut faire preuve de modestie. Mon rôle n’est pas de fabriquer le grand roman national. C’est une pratique de droite qui ne m’intéresse pas du tout. Je n’ai pas envie non plus de raconter le siècle, comme si un jeune lecteur pouvait, en lisant tous ces romans, avoir une bonne idée de ce qu’a été la France dans le détail. Je n’ai pas cette prétention, parce que je suis un romancier et pas un historien. Je me cantonne à un rôle beaucoup plus modeste, qui est de feuilleter le siècle. Je ne traite pas tous les thèmes. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, je ne l’aborde que par l’exode. Mais je ne parle absolument pas de la Shoah, il y a des pans entiers qui manquent. Je ne fais que proposer une sorte d’instantané de ce qu’est ce siècle avec chaque livre. Avec ces sept premiers tomes, j’ai abordé aussi bien la montée du fascisme que la liberté de la presse ou l’avortement clandestin. Du point de vue de ce qu’est le portrait brossé de ce siècle, je n’ai pas trop démérité.