
Le temps d’un trajet Paris-Arles, dans le train en route pour les Rencontres de la photographie, Juliette Agnel, lauréate du prix Niepce 2023, nous raconte à travers son travail photographique la nature grandiose et fantasmatique rencontrée lors de ses voyages, dans les contrées les plus reculés du globe.
Variant les échelles, d’une dimension cosmique avec ses étendues d’étoiles infinies, à une dimension macroscopique, nous offrant les cristaux d’une géode ou les minuscules feuilles d’une fougère, les photographies de Juliette Agnel donnent une nouvelle définition de l’immensité, pouvant se cacher jusque dans les détails presque invisibles du vivant. L’artiste construit un univers magnétique et sauvage, hors de l’humanité, dont la présence n’est révélée que par quelques ruines qu’elle a laissées. Elle nous fait aujourd’hui le récit de son geste.
Comment êtes-vous venue à la photographie ? Pourquoi ce médium plutôt qu’un autre, comme la peinture, que vous avez également pratiquée ?
Je suis venue à la photographie à travers une matière à la faculté qui s’appelait “Approche sensorielle”, pour laquelle il fallait transformer un objet avec un outil commun, l’appareil photo. On y travaillait durant une année entière, jusqu’à le faire devenir autre, lui donner une nouvelle forme. J’ai choisi le marron, et j’ai adoré ce que j’y ai vu. J’ai dû rentrer dans la matière, dans le cœur du marron, tourner autour, prendre le temps et apprendre à entrer en contact. Depuis, j’ai toujours eu l’envie de réitérer cette expérience, de retrouver cette émotion forte.
Je pense que ce médium, derrière lequel on se cache, me protège. Je me sentais trop exposée, trop “en direct” avec le médium de la peinture, même si j’aimais beaucoup cela. La photographie était plus facile pour moi, me mettait moins en danger ; c’est un outil que j’arrivais mieux à maîtriser, avec lequel j’avais une grande facilité à m’exprimer.
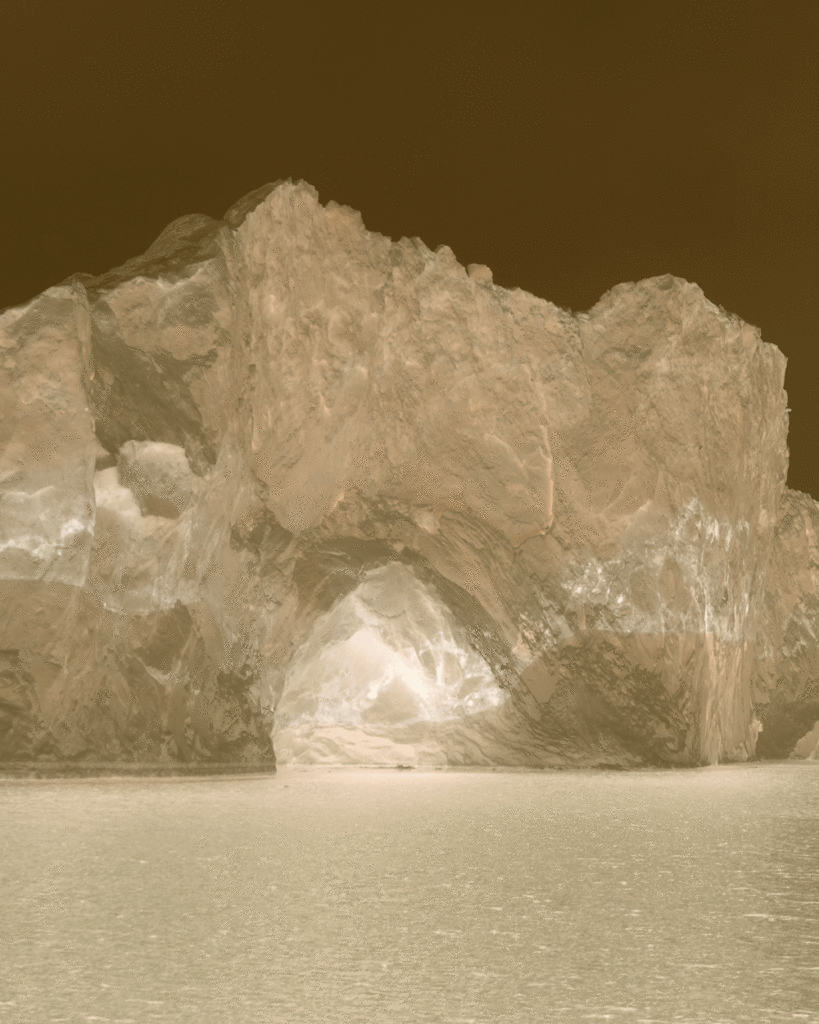
Pouvez-vous nous raconter votre transition de la peinture à la photographie ?
Je me souviens de mes trois dernières peintures, faites au Mali. J’y avais passé trois mois, à photographier, filmer, faire des prises de son, prendre des notes. Mes trois dernières peintures ont été réalisées là-bas, et puis j’ai juste changé de médium, mais la recherche est restée la même. Ce que je faisais en peinture était déjà très organique, semblable à mes photographies.
« Avec l’appareil photo, la matière est dans l’image que l’on va fabriquer, pas dans l’outil. »
Juliette Agnel
Pensez-vous qu’il y ait une ou des spécificités au médium photographique par rapport à d’autres formes d’expression artistique ?
Oui, je pense que chaque outil résonne différemment par rapport à notre propre rapport au corps. Le médium est un prolongement de notre regard, de notre main, de notre geste, il nous aide à sortir nos idées. Il est précisément “médium”, et doit créer le passage concret d’une idée à l’objet. Prendre en main un arbre, un bois pour le sculpter, ce n’est pas le même rapport à la matière ni au corps que de peindre à l’encre ou que de faire travailler le regard. Avec l’appareil photo, la matière est dans l’image que l’on va fabriquer, pas dans l’outil. Il y a une relation indirecte. Avec la peinture, je prends la matière pour la transformer sur le support directement. Avec la photo, c’est mon regard et mon outil qui viennent créer cette matière.

Peut-on parler du rapport au temps dans vos photographies ? Elles ont une certaine fixité, semblent mettre en place un ralentissement du temps. Comme si la contemplation n’était possible que par cet arrêt silencieux, qui se reçoit comme un secret.
C’est ce qui m’intéresse dans l’image, c’est tout ce qu’elle contient et qui ne se voit pas. Lorsqu’on fait de longs temps de pause pour parvenir à une image, le spectateur n’a pas totalement accès à ce laps de temps. Il ne voit que l’image finale. En réalité, pendant la prise de vue, il y a une ou plusieurs personnes devant l’objectif, qui “dansent” avec des lampes à la main pour révéler ce qu’il y a à révéler.
« Je me questionne sur l’humanité, sur notre place dans et face au monde, sur les ressentis qu’on peut avoir, parfois collectivement, sur ce qui point et se diffuse à partir d’une image, sur la relation à l’objet photographié. »
Juliette Agnel
En photographie, on peint avec la lumière et avec le temps, qu’on peut prendre en main, tordre, étirer, condenser. Il s’est donc passé des choses dont les traces ont disparu dans l’image finale. Il se passe aussi d’autres choses dans ce temps de pause, comme le vent qui souffle, les herbes qui bougent, c’est aussi ça qui fait matière dans mes images : vous ne pouvez pas complètement voir ces éléments mouvants, mais il en subsiste tout de même quelque chose.
Ce qui frappe dans votre œuvre, c’est d’une part l’amplitude des espaces, une immensité, quasi mystique (comme dans Taharqa et la nuit, Les Étoiles pures, La Grande Montagne), mais qui côtoie aussi le minuscule (comme avec les focus sur les replis d’une pierre, les feuilles de fougères). Quelle pensée se cache derrière cette vision holistique dans vos photographies ?
Effectivement, une des expériences que j’ai faites et qui m’a fortement imprégnée plus jeune, c’était de me retrouver sur une terrasse en pays dogon, avec une voûte céleste remplissant les yeux à 360 degrés, jusqu’à avoir les étoiles à mes pieds. Dans ce cadre total, on ne sait plus si on est très proche ou très éloigné des étoiles. Cette expérience physique sur le rapport de taille et d’échelle entraîne nécessairement des questionnements sur la relation que l’on entretient avec le monde vivant, de la petite herbe qui pousse aux étoiles les plus lointaines.

Je cherche encore à conscientiser, à sortir cette pensée, qui se construit au fur et à mesure des séries et qui s’affine, qui s’éclaire. Notamment sur cette relation à l’invisible, qui est devenue la matière première de mon travail. Je me questionne sur l’humanité, sur notre place dans et face au monde, sur les ressentis qu’on peut avoir, parfois collectivement, sur ce qui point et se diffuse à partir d’une image, sur la relation à l’objet photographié. Et c’est vrai que, finalement, entre le tout petit et l’immensité, la relation est très étroite.
Une certaine solitude et une grande tranquillité émanent aussi de ces étendues puissantes et sauvages, de ce monde où prend fin le monde, en dehors de l’homme. Donnez-vous un rôle à ce dernier, dans cet univers où le minéral et le végétal prennent toute la place ?
C’est vrai qu’il y a parfois dans mes images une possible trace de l’humain, mais jamais davantage. Comme si l’on était dans un temps après l’humanité, peut-être après une catastrophe, ou dans un monde parallèle, où l’équilibre entre les hommes et la planète ne serait pas le même.
Mais laisser la place au minéral et au végétal, c’est aussi poser les questions des rapports de puissance entre l’humanité et la nature, considérer ce que celle-ci nous donne. Il s’agit de prendre le temps d’observer un espace, de deviner comment il résonne, d’écouter le silence pour sentir monter l’énergie des sols. Les images que je fabrique sont donc tout de même en lien avec l’homme, puisqu’elles s’adressent à lui. En y faisant face, en le regardant, on questionne son propre rapport au monde.
Loin d’une nature objective, vous construisez un monde naturel proche du surnaturel, mais à cette nature fictionnalisée se mêle une réalité plus scientifique. Vos photographies, en se faisant témoin des failles des glaciers du Groenland, ont également une valeur documentaire. Pouvez-vous nous parler de ces multiples aspects, entre fiction, poésie, documentaire, réel ?
Lors d’une conférence chez Gens d’image, Françoise Paviot, qui a été ma galeriste pendant dix ans, m’a signalé : “Quand je t’ai demandé si tu étais plasticienne, photographe, documentariste, ou poète, tu as dit que tout ça ne voulait rien dire, et que tu étais juste une artiste.” À vrai dire, je me sens continuer mon travail de peintre. Je poursuis une même quête intérieure, quel que soit le médium. L’espace de la poésie est aussi l’espace des scientifiques, qui rêvent, qui sont émerveillés, qui « inventent » une grotte, ou un site archéologique. J’ai rencontré beaucoup de scientifiques très habités par la poésie livrée par la nature. C’est parfois cette beauté qui a déclenché leur passion.

Je suis aussi très attachée au genre du documentaire. J’ai quelques films majeurs en tête, comme Nanouk l’esquimau (1922), que l’on présente souvent comme l’un des premiers films documentaires. Pourtant, il est fabriqué de toutes pièces ! Et c’est ce que j’aime particulièrement : on doit traverser la barrière du réel pour avoir plus de force et d’impact dans le réel. Je fais basculer le réel dans l’imaginaire, cherche les points de passages. Même s’il se peut que mon travail témoigne de phénomènes réels, ce qui m’intéresse c’est qu’à partir de cette réalité, on puisse puiser d’autres visions, d’autres mondes. Hubert Reeves disait : “L’espace prend la forme de mon regard.” C’est de cela qu’il s’agit : l’espace réel transvasé dans une fiction plus personnelle.
Mais il est aussi pertinent de parler d’une valeur documentaire, car toute photographie comporte une trace, même si elle tend à s’en éloigner pour s’approcher de l’aura. De toute façon, lorsqu’on se met à observer vraiment la nature, en s’adressant à elle, qu’on commence à appréhender sa puissance, on ne peut que s’en sentir plus proche, et devenir, si ce n’était pas déjà le cas, sensible à l’écologie, à l’harmonie entre l’humain et la nature.






















