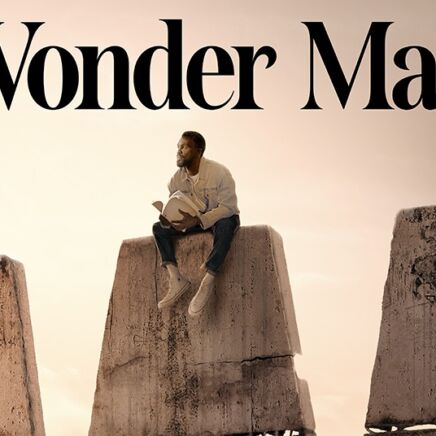The Boys, Umbrella Academy, Extroardinary… L’univers des séries regorge déjà d’une multitude de récits super-héroïques. Alors, que faut-il attendre de cette nouvelle production signée Rapman ?
Une femme noire à bout de souffle, en proie à une angoisse palpable, slalome dans un entrelacs de couloirs de béton. Très vite, l’alarme est donnée et des forces armées (milices privées, soldats, policiers, rien n’est moins sûr) pénètrent dans le labyrinthe pour retrouver cet individu en fuite. À peine le temps de voir étinceler ses pupilles jaune ambre, qui semblent tout droit sorties d’une tour de feu dominant le Mordor, qu’une pluie de munitions s’abat sur elle.
Il pourrait s’agir, à quelques détails près, de l’introduction du film Origin d’Ana Duvernay, qui traite directement du racisme systémique qui habite nos sociétés et qui tue pour une couleur de peau et pourtant… Il s’agit de l’ouverture de la nouvelle série de super-héros portée par Netflix : SupraCell.
Cette intro ne dure pas 8 minutes 46 secondes, comme celle de l’agonie de George Floyd asphyxié par un policier le 25 mai 2020 aux États-Unis, mais elle évoque directement les affaires répétées de violences policières à l’égard des minorités racisées. Le rêve de Martin Luther King qui s’évapore en même temps que la vie qui quitte cette jeune femme.
Tout de suite, la promesse d’une énième production sur les super-héros reprend des couleurs : ici, il s’agira de parler de super-pouvoirs qui ne touchent que les noirs, comme d’une métaphore de la différence. Comme un instrument aussi de lutte contre les inégalités de traitement subies par une population considérée comme marginale. Comme… un nouveau Misfits ?
Entre South London et le futur, le voyage spatio-temporel du héros
Il y a Michael (Tosin Cole), Sabrina (Nadine Mills), Andre (Eric Kofi Abrefa), Rodney (Calvin Demba), mais aussi Tazer (Josh Tedeku). De Southwark à Croydon, comme la grande majorité de la population noire de Londres, ils se cantonnent aux rues malfamées de ces quartiers défavorisés du sud de la ville. Ils cherchent, pour beaucoup, à joindre les deux bouts. À se défaire d’un casier judiciaire injustement rempli. À se marier. À vivre leur vie comme ils rêvent de pouvoir le faire.

Un quotidien déjà pas rose, où la discrimination à l’embauche pousse au deal, à la violence. Où la drépanocytose décime les familles. Et dans lequel viennent s’ajouter des super-pouvoirs. Des pouvoirs qui, si mis en commun, pourraient, semble-t-il, permettre à Michael de ne pas voir les visions de sa compagne morte dans le futur, s’accomplir. Lui permettre de la sauver. Force, super-vitesse, télékinésie, voyage temporel… S’ils ne sont pas révolutionnaires, ils trouvent leur sens dans la situation sociale des différents protagonistes. Dans leur personnalité. Ils sont symboliquement significatifs.
Or, comme dirait l’Homme-Araignée : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » À partir du moment où nos cinq protagonistes découvrent leurs nouveaux dons et apprennent à les maîtriser, les problèmes s’enchaînent. Les ennemis se dressent sur leur route et leurs proches en subissent les conséquences. L’issue ? Les liens. Dans SupraCell, véritable récit choral, les chemins commencent à se croiser de manière anonyme. Au détour d’une rue. D’une barre d’immeubles. D’un cybercafé. Avant de mener les héros à unir leurs forces pour mener à bien leur sauvetage et impacter le futur.

Cette série est un exemple de la parfaite adaptation à l’écran du « Voyage du héros », un concept scénographique établi par Joseph Campbell et décrit dans son livre Le Héros aux mille et un visages, sorti en 1949. Le déroulé de l’intrigue repose sur 12 étapes que l’on peut résumer dans une situation initiale qui va être bouleversée par un élément perturbateur, qui va nécessiter pour le héros de partir à l’aventure. Sur son chemin, il croisera de nombreuses embûches, qui lui permettront de se construire, d’apprendre, d’évoluer et peut-être de vaincre.
Ce type de récit d’apprentissage n’est pas nouveau et se fait même très fréquent dans les œuvres littéraires et cinématographiques, Spider-Man en tête. Si ce modèle est efficace, il semble avoir été plus qu’éprouvé. Mais qu’est-ce qui fait que SupraCell se démarque des autres productions super-héroïques ? Qu’est-ce qui le différencie vraiment d’une autre série britannique qui a révolutionné le genre en proposant une galerie de personnages décalés et marginaux ? De Misfits ?
De Misfits à SupraCell : Black is the new Orange ?
Super-pouvoirs décalés. Humour cynique. Peurs réelles. Histoire d’intime, récits de vie. En 2009, Misfits révolutionnait le monde des super-héros. En cinq saisons, le show se faisait kaléidoscope de personnages blessés et en marge de la société. Affublés de pouvoirs étranges, pour ne pas dire nuls (comme devenir invisible quand personne ne vous regarde… on regrette la cape d’invisibilité), des adolescents drapés dans le textile orange des prisonniers purgent leur peine par des travaux d’intérêt général. Le tout sur fond de l’atmosphère mystérieuse de The Old Smoke.
Le premier point commun entre Misfits et SupraCell réside justement dans l’inscription de l’intrigue dans un imaginaire géographique commun : Londres. Mais sans les coupe-gorges gothiques d’une époque victorienne fantasmée et révolue. Ici, le paysage est vertical, bétonné, labyrinthique. Bref, oppressant.
Ce terrain de jeu n’est pas anodin. Bien loin des dorures et des rouflaquettes de The Crown, ce décor est celui des marges. Des minorités. Noirs de peau ou vêtus d’orange, leurs super-pouvoirs se font l’expression de leur différence. Une différence qui est bien souvent la raison de la mise à distance de l’autre avec lequel on croit n’avoir rien en commun.

Pour rendre palpable cette mise à distance, Misfits peut compter sur un casting cinq étoiles très freaks. De véritables « gueules » de cinéma, entre l’exubérance d’un Robert Sheehan dans le rôle de Nathan (qu’il reprend presque à l’identique dans Umbrella Academy), l’inquiétante étrangeté d’un Iwan Rheon qui deviendra encore plus terrifiant dans Game of Thrones ou encore la vantardise d’un Nathan Stewart-Jarrett déjà aperçu dans Utopia – et la comparaison n’est pas à l’avantage du show de Rapman, car, dans SupraCell, les protagonistes sont étrangement plus stéréotypés, enfermés dans des cases.
Néanmoins, même s’ils se font moins attachants, plus « lambdas », le choix de personnages plus réalistes a beaucoup de sens : ici, on ne parle plus d’un cinéma pop, mais d’une ambiance rap. D’un univers brut de décoffrage, sombre, revendicateur. Finalement, ces héros sont plus sobres parce qu’ils servent un récit plus proche du réel, auquel il peut être plus simple de s’identifier. Quand le jusqu’au-boutisme misfitien, vernis provocateur dissimulant des blessures à vif, s’exprime directement dans un langage cru et vulgaire, dans SupraCell, la blessure et le rejet sont évidemment plus systémiques. L’habitude d’être constamment confronté au rejet érode des réactions qui se font moins explosives.

Cette différence d’atmosphère se ressent aussi dans les ambiances musicales qui habillent les séries : quand Misfits se drape d’une ambiance rock, Umbrella Academy de mélodies pop, SupraCell puise dans l’univers de son créateur, le rap. Enfin, son choix de récit plus réaliste implique de fait des pouvoirs plus concrets.
L’enjeu aussi. Car si les pouvoirs dans Misfits sont avant tout symboliques et funs, ils deviennent instruments de survie dans le nouveau show de Netflix. C’est donc plutôt du côté d’une série comme Heroes qu’il faut, ici, aller chercher l’influence. Confrontés à des problèmes du quotidien, dépourvus de costumes et pourtant impliqués dans une apocalypse imminente, les personnages de Heroes et de SupraCell sont renvoyés dos à dos.
Ici, les propositions créatives sont, à raison, plus nuancées, plus subtiles que dans une série comme Misfits. Mais aussi moins originales, plus molles, moins franches, et donc moins attrayantes, faisant de ce un show mi-sfits, mi-raisin. Pour autant, une proposition loin d’être inintéressante… Faut-il alors aller chercher notre enthousiasme nuancé du côté d’une forme de lassitude par rapport à un genre super-héroïque éculé ?
Des super-héros à bout de souffle ?
« Nous étions là quand le western est mort et il y aura un moment où le film de super-héros suivra le chemin du western, confiait Steven Spielberg à l’Associated Press, en 2015. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres occasions où le western reviendra et où le film de super-héros reviendra un jour. »
Ainsi, le cinéaste prédit la fin des super-héros depuis quelques années. Il faut dire que les chiffres sont loin de lui donner tort (ou Thor ?). Shazam 2, Black Adam, Morbius… Les flops se multiplient au cinéma comme sur le petit écran, à l’image de The Boys et Umbrella Academy, un temps innovantes, qui ont perdu leur mojo. Mais que faut-il faire pour renouveler le genre ?

Si SupraCell essaie d’innover en flirtant avec le méta – des personnages secondaires (et sans pouvoirs) socialisés aux films de super-héros vont jusqu’à citer directement certaines sagas comme Marvel et sont donc moins surpris face à leur apparition dans la vraie vie – pour apporter humour et fraîcheur, ce n’est pas véritablement nouveau. On pense aux films Marvel, justement, ou même à Watchmen, où les super-héros font partie de la société et sont des personnalités publiques.
La production Netflix tente aussi de banaliser ces héros, de les rendre humains, accessibles. Mais un brin trop tard : Extroardinary, qui inverse les codes en proposant justement une héroïne qui serait la seule à ne pas posséder de super-pouvoir, et le film Joker de Todd Philips, normalisant la folie du clown triste, ont préparé le terrain. Marvel, de son côté, s’est même attaqué à leur désacralisation, les rendant souvent ridicules. Et Hero Corp de Simon Astier a proposé une version plus populaire et rurale de ces protagonistes, bien souvent cantonnés aux grandes villes.

Enfin, si SupraCell propose de les utiliser comme métaphore de la différence, en rendant leurs pouvoirs politiques, comme on l’a vu avec Misfits, cela a déjà été plus que fait par le passé. Black Panther, Ms.Marvel ou encore Spider-Man: Into the Spider-Verse évoquaient déjà le racisme. Umbrella Academy s’intéressait aux combats de genre au travers du personnage d’Eliott Page.
Des propositions vues et revues, qui ont le mérite de questionner la pertinence du genre super-héroïque pour faire avancer créativement et politiquement les débats. Pour autant, il ne s’agit pas d’être uniquement critique ici : la voix de Rapman au travers de sa série a du corps. L’artiste a du souffle. Ce qui est extrêmement important ici, puisqu’il s’agit de redonner ce souffle à des personnes qui l’ont perdu pendant au moins 8 minutes et 46 secondes. Essoufflés, asphyxiés par des violences qui n’ont de cesse de les cibler, tout en permettant à des générations d’être aussi représentées dans des séries mettant en scène (enfin) des super-héros noirs.
Cette série n’est donc pas révolutionnaire, mais elle a le mérite de faire siens les codes du genre, pour donner de la force à son message. Un message d’autant plus symbolique qu’il prend place à Londres, première ville à avoir mis en place le Mois de l’histoire des Noirs en 1987.