
Quand le génie de Darren Aronofsky se mêle au jeu de Jared Leto, Ellen Burstyn, Marlon Wayans et Jennifer Connelly, on obtient un drame sur fond de dépendance et de rêves qui saisit ses spectateurs et les marque d’un souvenir indélébile. Sorti en l’an 2000, « Requiem for a Dream », demeure culte. Décryptage.
Requiem for a Dream, c’est avant tout un impact. Le long-métrage sorti courant de l’année 2000 reste l’un des plus marquants de sa génération. Avec ses plans inoubliables, ses thématiques dures et profondes et son propos tristement fataliste, l’adaptation filmique par Darren Aronofsky de Retour à Brooklyn, le roman d’Hubert Selby, s’inscrit dans la liste très sélecte des films immanquables du 20e siècle. Pour son retour en salles, 25 ans après sa sortie, on vous explique pourquoi c’est culte.
Une inévitable fatalité
Dans la ville de Brooklyn, Harry (Jared Leto), sa copine Marion (Jennifer Connelly) et leur ami Tyrone (Marlon Wayans), rêvent d’un avenir meilleur. Entre deux doses de drogues, ils caressent l’illusion d’un futur utopique qui leur permettrait de quitter leurs conditions désastreuses.
Harry et Tyrone s’imaginent les poches pleines d’argent et Marion, elle, espère devenir dessinatrice de mode. En parallèle, Sara (Ellen Burstyn), la mère d’Harry, veuve esseulée – et occupée à racheter le téléviseur que son fils vend tous les quatre matins pour se payer sa consommation -, s’évade grâce à son émission préférée Juice by Tappy (animée par Christopher McDonald). Une émission absurde et cynique qui fait indéniablement écho à La Valse des pantins de Martin Scorcese ou encore à Joker de Todd Phillips. Lorsqu’elle apprend qu’elle va pouvoir y participer, Sara entrevoit une lueur d’espoir dans son quotidien morne, celle d’une existence quelque peu brillante, d’une gloire et d’une attention éphémère.
Dès les premiers instants du long-métrage, une chose est claire : une épée de Damoclès se balance au-dessus de la tête des protagonistes. L’American dream qu’ils espèrent tant n’est qu’une illusion toxique synthétisée dans la beauté et la poésie d’un plan devenu culte : Harry et Marion allongés au sol. Un top shot qui cristallise la tristesse d’un amour condamné.
Tous les personnages tenteront de contrecarrer la fatalité, courant les yeux fermés vers un idéal inatteignable. Dans une longue et tragique descente aux enfers, nous assistons à leur inéluctable perte. Sara prendra des amphétamines pour paraître belle et mince et ainsi rentrer dans sa robe rouge pour le jour de l’émission, Harry et Tyrone dealeront pour financer leur propre consommation et le rêve de Marion, et celle-ci jouera de ses charmes pour obtenir des stupéfiants.
Dans ce ballet macabre, Aronofsky ne leur laisse aucune chance. Tyrone se fait arrêter et incarcérer, Harry est amputé d’un de ses bras (infecté par ses piqûres de drogue), loin de son rêve de retrouvailles sur la jetée, et Marion perd tout autant, si ce n’est plus. Sa liberté, son intégrité, tout lui est pris jusqu’à son corps, qui devient l’objet de désirs malsains contre lesquels elle ne peut lutter. Quant à Sara, elle sombre dans la folie. La mère esseulée est internée et lobotomisée, avalée par son obsession du paraître, s’imaginant sur le devant de la scène avec son fils et sa belle-fille. Dans une hallucination finale, elle entrevoit un bonheur inaccessible. Violent et déchirant.

Ainsi, aucun des personnages n’est épargné. Le long-métrage les suit jusqu’au point de non-retour, comme le laissait pressentir le titre : Requiem for a Dream. Le requiem s’inscrivant dans les cérémonies religieuses chrétiennes comme un chant célébrant le défunt, ici, ce sont les rêves que l’on enterre. Et pour enfoncer le dernier clou de ce cercueil, une série de plans en position fœtale, aveu pur et déchirant d’un échec : celui de l’homme terrassé par la vie.
Voir cette publication sur Instagram
Un opéra visuel et sonore
Si Requiem for a Dream perdure dans la mémoire de ses spectateurs, ce n’est pas uniquement pour son propos, mais aussi pour sa scénographie. En tant qu’objet filmique, le long-métrage de Darren Aronofsky pousse l’expérience cinématographique à l’extrême, nous marquant à jamais.
Assurément, le film fait écho au corps des protagonistes. Aronofsky choisit de mettre en avant l’anatomie. Les images sont à la limite de l’organique, rythmées par des plans sur des peaux, des seringues ou encore des yeux aux pupilles dilatées. Le film fait littéralement corps avec son propos, s’ancrant dans la dépendance, la rythmant jusqu’à l’incarner par la caméra.
Le cinéaste bouscule notre confort de spectateur avec ses jump cuts (saut d’un plan à l’autre), ses gros plans, ses split screens (écrans scindés ayant pour effet de montrer à la fois la simultanéité et l’isolement des personnages), ses accélérations et ses répétitions. Autant d’effets de saturation sensorielle reproduisant celle vécue par nos protagonistes. Seringues, yeux, pupilles… Le montage répétitif, saccadé, produit l’effet cyclique du rendez-vous obsessionnel, miroir de la consommation de drogue.
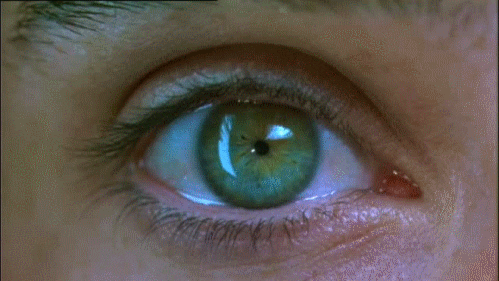
Le malaise visuel culmine lors de la séquence finale. Son rythme épileptique avec ses scènes accélérées, ses ruptures et ses flashs forme une apothéose cauchemardesque. Tout s’entrechoque frénétiquement : le bras gangréné de Harry, l’insoutenable scène d’orgie de Marion, le délire de Sara, l’enfermement de Tyrone.
À cela s’ajoute la musique, véritable fil conducteur de l’horreur. Hypnotique et mémorable, Lux Aeterna de Clint Mansell nous étouffe par ses violons stridents. Cette accumulation nous fait monter crescendo jusqu’à un point de non-retour, nous saisissant au plus profond de notre être, entre urgence et désespoir.
Une œuvre toujours d’actualité
Vingt-cinq ans après sa sortie, le film conserve toujours un propos contemporain. Le long-métrage de Darren Aronofsky va au-delà d’une simple exploration de l’auto-destruction et d’une mise en garde contre les drogues. Il propose un questionnement sur la manière dont nous façonnons nous-mêmes nos propres prisons.
Par son exploration du culte de la jeunesse éternelle et de la minceur, le personnage de Sara, victime d’une société du paraître s’ancrant sur des normes esthétiques, met en lumière les troubles du comportement alimentaire. Encouragée à maigrir par son amie qui lui confie que « les gens minces passent mieux à l’écran », elle incarne les obsessions qui cadenassent le corps des femmes. La scène du frigo carnassier, qui transforme l’objet du quotidien en ennemi, dénonce, par l’horreur, les diktats sociétaux.

La précarité, la course à l’argent facile, ou encore la recherche de liberté par le biais des drogues met en avant un triste tableau qui demeure (malheureusement) contemporain. Cette injonction de réussite, déguisée en American dream, pousse nos protagonistes insatisfaits à trouver des simulacres dans lesquels se murer. Trouver des échappatoires à travers la drogue et autres dépendances, pour pallier l’insipidité de sa vie reste d’actualité. Une façon de fuir et d’exister autrement que par nos difficultés.

En somme, Requiem For a Dream marque, interpelle et dérange. Il nous interroge, nous met à l’épreuve et finit par nous renvoyer à nos propres failles, à notre vulnérabilité. Son premier visionnage nous percute et nous marque à jamais, c’est là que réside sa force, sa pertinence et sa pérennité.



















