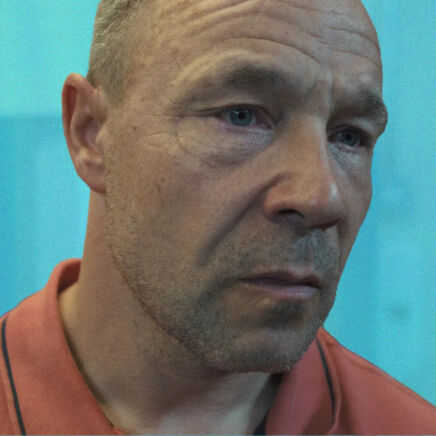Dans son dernier film, Nous (prix du meilleur documentaire à la Berlinale 2021), Alice Diop articule le récit de l’intime au corps social et enregistre, avec le recul nécessaire, les morceaux de vie d’habitants d’un bout à l’autre de la ligne du RER B.
Depuis près de vingt ans, Alice Diop travaille dans ses films à rendre visible des individus marginalisés, invisibilisés, relégués en périphérie des villes, « banlieusards » dont la présence sourde n’a pas voix au chapitre. Son nouveau film, en partie inspiré par Les Passagers du Roissy-Express (Seuil, 1990) de François Maspero et de la photographe Anaïk Frantz, s’ancre ainsi dans cette démarche à la fois artistique et politique qui consiste à (re)donner une épaisseur historique aux habitants des banlieues par le biais de l’image, de la parole, et à condenser dans un seul et même cadre des fragments de vie et la mémoire dont sont empreints les territoires.
La ligne du RER B, symbole de ces lieux de vie que l’on traverse parfois sans s’arrêter, dicte alors les déplacements d’Alice Diop. Après avoir reçu le César du meilleur court métrage en 2016 pour Vers la tendresse, dans lequel la réalisatrice déployait un regard unique sur la masculinité, la cinéaste esquisse avec Nous la possibilité d’une réunification entre la marche de l’Histoire et le destin d’individus qui, tout en s’ignorant mutuellement, font société. Sans discours surplombant et à travers une relative économie formelle, Alice Diop se place au plus près de ses sujets et leur laisse le temps de s’exprimer. Grâce au montage, les individus sont reliés les uns aux autres, comme si la réalisatrice traçait une nouvelle ligne, un tracé reliant non plus des points sur une carte, mais des personnes, à travers un seul et même geste de cinéma.
Quelle a été votre principale source d’inspiration pour ce film ?
Tout est parti d’un livre, Les Passagers du Roissy-Express (Seuil, 1990) de François Maspero, récit d’une randonnée que l’écrivain a faite autour de la ligne B du RER, ligne qui a pour particularité de traverser tous les pans de la société française en même temps que des lieux de mémoire et d’Histoire tels que le Mémorial de la Shoah de Drancy, construit en face de la cité de la Muette – transformée en camp d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale – ou Saint-Denis et sa basilique, où sont enterrés une partie des rois de France. C’est une ligne de train qui, symboliquement et sociologiquement, raconte une société dans toutes ses transformations. C’est la première fois que je voyais la banlieue racontée par la littérature et non enfermée dans un discours stéréotypé. Ce qui intéresse Maspero, ce ne sont pas tellement les problèmes sociaux ou économiques, les violences, le deal, etc., mais le quotidien, la banalité. C’est une approche totalement nouvelle et j’ai nourri pendant des années le désir de l’adapter.
Pourquoi ce titre, Nous ?
Quand sont arrivés les attentats de janvier et novembre 2015, la banlieue était encore une fois convoquée à tout-va à travers des pensées toutes faites et des fantasmes toujours charriés de la même manière. Je n’ai pas voulu répondre à ce discours par un contre-discours, mais par le cinéma. J’ai eu besoin de comprendre ce qui était en train de nous arriver, ce qu’était la société française, la banlieue, et comment l’éprouver de façon sensible et différente. La méthode et le livre de Maspero m’ont montré la voie. Je suis donc partie pendant un mois, sans aucun autre projet que d’aller regarder ces lieux, ces gens, et tenter de comprendre qui on était, qui ils étaient, qu’est-ce que c’était que cette « société ». Au lendemain de la marche du 11 janvier, Libération avait titré « Nous sommes un peuple » : cette Une m’avait interrogée. Au fond, qu’est-ce que ce « nous » ? Avec qui peut-on faire « nous » ? Comment le fabriquer ? De quoi et de qui est-il composé ? Ce mot-là est presque devenu le projet du film. Chacun peut y répondre à sa manière, y voir ce qu’il veut et faire le voyage qu’il a envie de faire. Ce « nous », je le vois à la fois comme une question, comme une affirmation, comme un projet utopique.
Vous laissez beaucoup durer les plans, même quand il ne se passe apparemment rien, par exemple au Mémorial.
Il ne se passe jamais rien. Il se passe ce qu’on est capable et ce qu’on a envie de voir. En l’occurrence, l’apparition de ces visages disparus, c’est faire émerger une Histoire que la France a mis beaucoup de temps à regarder en face. Les faire apparaître, les nommer, les reconnaître, c’est une manière de leur faire une place, de ne pas les oublier. C’est ça que je regarde au Mémorial, ces visages qui apparaissent sur des écrans, dans un lieu vide, très peu fréquenté. Cela m’interroge sur comment on essaye d’ensevelir les pans les plus honteux d’une Histoire qu’on ne veut pas regarder.
Le film fait « nous » avec des gens qui ne font pas forcément « nous » dans le réel, mais c’est un réel qui est déjà là et que l’on ne veut pas voir.
Alice Diop
Au montage, quel principe a présidé à l’agencement des séquences ?
On a commencé le montage à la fin, quand j’avais quasiment toutes les histoires. Le montage a été très long car il était à la fois très intuitif et cérébral, dans la mesure où j’aurais pu faire un film de chacune des histoires – d’Ismaël, le mécanicien, du portrait de ma soeur, du Carnet de Bergounioux, de la chasse à courre, etc. Avec ma monteuse, on s’est beaucoup inspiré des recueils de nouvelles en essayant de décrire le fragment de l’histoire de quelqu’un, de toucher le point nodal qui allait faire de cette histoire quelque chose d’universel et résonner plusieurs séquences plus tard. C’est ce qui a guidé le choix de l’écriture, de rentrer dans chacune des histoires sans en faire un tout, sans tout dire, mais travailler la question du fragment, qui était censé dire suffisamment pour cerner intimement la vie et l’histoire d’une personne et amener le spectateur vers une identification.
L’appel d’Ismaël à sa mère, qu’il n’a pas vu depuis 20 ans, est tellement bouleversant que tout à coup la question de la migration ou de l’exil n’est plus une question de point de vue politique : ça devient quelque chose de complètement incarné. Avoir accès à l’intimité de cette vie ne peut que susciter l’empathie et faire vaciller les certitudes, les idées toutes faites, les lieux communs. C’est ça qui est travaillé intrinsèquement dans chacune des histoires. En juxtaposant cette séquence avec les autres, l’idée était de construire des liens de résonance que chacun peut penser par soi-même.
Était-ce une intention de départ que de les articuler à vos propres archives ?
Le « nous », c’est une addition de singularités. Je suis un « je » parmi les autres et c’était important de me situer là, parce que ça dit de quel endroit et pourquoi je parle. Inscrire ce peu d’archives qu’il me reste de ma mère dans l’histoire de mon film, c’est aussi une manière d’inscrire sa trace, sa vie, son corps, dans une Histoire qui dépasse mon histoire personnelle et familiale, qui complète les lacunes de la représentation que la société française peut avoir d’elle-même. J’appartiens à une catégorie sociale qui n’a pas été suffisamment racontée. Des récits émergent, mais c’est très nouveau. Pendant longtemps, je n’avais aucune représentation de moi-même ni de ce que j’avais vécu. Je suis devenue cinéaste pour combler la frustration de ce manque intime, et plus encore pour inscrire la trace de ces « petites vies » dans une Histoire de France. Mon outil, ce n’est pas la sociologie, c’est le cinéma. Si je filme Ismaël, c’est pour ça. Si je filme ma sœur, c’est pour ça : pour inscrire leurs traces quelque part, pour ne pas qu’ils disparaissent de la même manière que mes parents ont disparu, de la même manière que toute une partie de mon histoire et de mon enfance a disparu faute d’avoir été racontée.
Comment vous êtes-vous retrouvée à filmer ces séquences de chasse à courre ou de la messe consacrée à Louis XIV à la basilique Saint-Denis, qui paraissent venir d’un autre temps ?
Ces séquences sont complètement actuelles. Elles portent la mémoire d’une Histoire qu’on célèbre encore, car des gens ont la légitimité du récit et continuent à la faire vivre. J’avais très envie d’aller observer ces lieux et ces gens que je ne côtoie pas, qui sont idéologiquement très loin de moi, et de les inclure dans mon « nous » : quelle fonction ont-ils dans ce « nous » ? Si je dis « nous » à partir de mon corps, de ma vie, je suis capable d’intégrer des gens qui sont idéologiquement et sociologiquement très différents. Je suis capable de les regarder, de les reconnaître, de les accepter dans mon « nous », même si certaines choses d’eux me resteront opaques, car j’estime qu’ils font partie de mon « nous » au même titre qu’Ismaël, que mes parents ou quelqu’un comme Pierre Bergounioux.
Cette séquence où vous apparaissez brièvement à l’écran au côté de l’écrivain Pierre Bergounioux donne d’ailleurs l’impression que vous exposez les intentions du film.
Je ne la vois pas du tout comme une séquence explicative, même si elle donne sans doute les clés d’un film sans aucun autre commentaire que celui qu’est capable de se formuler le spectateur. C’est un film « incontrôlé » dans le sens où je n’en maîtrise pas la réception, ni ce que chacun des spectateurs est à même de se formuler à partir du voyage que je propose. En effet, le fait de situer qui parle, d’être une femme, noire, d’apparaître face à Bergounioux, dit quelque chose de l’endroit d’où j’ai regardé tout ça. Ça formule à la fois l’idée du film et la démarche de tout mon cinéma. Offrir une trace littéraire à ceux qui n’ont pas été racontés, qui n’ont pas été regardés : c’est parce que je l’ai lu et compris dans ses livres que je me suis rendu compte qu’intuitivement c’est ce que je faisais dans mon cinéma.
Le fait de l’énoncer éclaire tout le projet du film. Lorsque je demande à mon père, dans le peu d’archives que je mets de lui dans le film, quel bilan il tire des quarante années de vie qu’il a passées en France, il me répond que c’est un bilan positif car ses enfants sont nés ici et ont pu faire des études. C’est à la fois très dur de résumer une histoire migratoire et d’exil, qui est forcément douloureuse, et de compenser la douleur de cet arrachement à son pays et à sa culture en pouvant se réjouir de ce à quoi on a fait échapper ses enfants. C’est un legs dur à porter, mais qui est magnifique dans ce que ça dit du sacrifice d’une vie. Quelque part, quand je me retrouve dans ce même film à converser avec Bergounioux, j’ai l’impression qu’au fond je rends à mon père le cadeau qu’il m’a fait de par sa vie. Mais chacun peut voir cette séquence comme il l’entend. En tout cas, c’est pour cela que cette séquence est importante pour moi, au-delà de son caractère didactique.
Du 11 au 14 février, le Centre Pompidou vous a invitée à faire votre autoportrait en douze séances. En quoi cette invitation se relie-t-elle à votre projet de Cinémathèque idéale des banlieues du monde ?
C’est un projet que j’ai initié avec le Centre Pompidou et les Ateliers Médicis l’année dernière. J’ai constitué un collectif de programmateurs qui viennent chacun de champs très différents : il y a la directrice des Labos d’Aubervilliers, il y a Tangui Perron, un historien qui travaille sur l’histoire ouvrière dans le 93, Malika Chaghal, ex-directrice de la cinémathèque de Tanger, qui fut la programmatrice d’un festival très important (Les Pépites du Cinéma) dans l’émergence de cinéastes issus des quartiers populaires qui n’avaient pas encore beaucoup de visibilité, et Claire Diao, programmatrice et critique de cinéma qui a édité l’ouvrage collectif Double vague : le nouveau souffle du cinéma français. J’ai invité tous ces gens à réfléchir avec moi à ce piège, à cette étiquette de « cinéaste de la banlieue » et à réfléchir collectivement au sens de ce mot, à son non-sens aussi.
On a récolté 300 films. Ce sont des films de cinéastes, de voix, d’écritures et de genres complètement différents, des Misérables de Ladj Ly à L’amour existe de Maurice Pialat, en passant par Le Camion de Marguerite Duras, ou encore un film de Jean Vigo. En même temps, ce sont des films qui ont fait patrimoine, qui ont permis d’exhumer une mémoire enfouie de ces territoires et de documenter leur transformation. Cette Cinémathèque idéale des banlieues thématise et problématise ces questions de qui est cinéaste, est-ce que le « banlieue-film » est un genre, un sous-genre, est-ce qu’on arrive à reconnaître parmi les cinéastes qui ont grandi en banlieue des cinéastes en valorisant des gestes, des écritures singulières ou est-ce que ce sont des gens que l’on essentialise là où l’on ne va pas essentialiser d’autres types de cinéastes ?
C’est une interrogation que l’on renvoie aux critiques de cinéma, aux programmateurs, à ceux qui font des films, et en même temps c’est une entreprise qui invite à déciller le regard qu’on peut avoir sur ces territoires. Cette cinémathèque porte en elle tous ces enjeux. Le Centre Pompidou m’a proposé onze séances, qui ne sont pas un « best-of » de ces 300 films, mais une proposition de programmation qui en elle-même dialectise toutes ces questions et fait apparaître des gestes de cinéastes très divers qui remettent en question cette notion de film de banlieue.
Nous de Alice Diop – 1h57 – En salles le 16 février 2022
Autour de Nous – Centre Pompidou, du 11 au 14 février 2022- 5€, Tarif réduit 3€, gratuit pour les adhérents