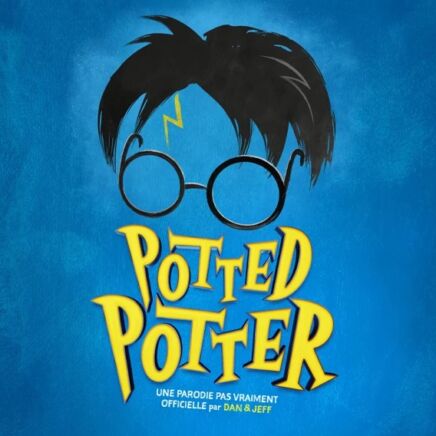Succès en librairie, le livre de Panayotis Pascot est adapté au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu’au 8 mars 2025. Rencontre avec Paul Pascot, metteur en scène de la pièce et auteur de l’adaptation, et Vassili Schneider, pour la première fois au théâtre dans le rôle du Fils.
Comment s’est passée votre rencontre ? Était-ce une évidence ?
Paul Pascot : Je savais que Vassili faisait du doublage, mais je n’avais jamais vu sa tête, surtout qu’il avait l’accent québécois. Si vous tapez son nom sur Internet, il y a une autre personne qui s’appelle comme ça, qui ne lui ressemble pas. Quand j’ai décidé d’adapter La Prochaine Fois que tu mordras la poussière, j’avais cette personne en tête, que je voulais absolument. Alors, quand Vassili est venu passer l’audition, ça n’avait rien à voir, je pensais que c’était un escroc ! Ce qui a révélé sa véritable identité, c’est son désir de travail et le talent qui s’en échappait.
« En faisant en sorte de montrer ce corps, on peut ressentir le texte dans sa chair, et non plus dans les mots. La communication, surtout entre hommes, c’est le thème majeur de cette adaptation. »
Paul Pascot
Vassili, c’est votre première expérience au théâtre, comment l’avez-vous vécue ?
Vassili Schneider : Je n’ai pas fait d’école de théâtre et c’est un petit milieu où on vient prendre les gens qu’on connaît. Ça demande une technique tellement pointue. Les metteurs en scène qui osent se risquer à prendre quelqu’un sans expérience sont rares. J’ai reçu un appel de mon agent qui me disait que Paul souhaitait me rencontrer pour l’adaptation du livre. Je savais que c’était un projet assez excitant. Je voulais absolument décrocher ce rôle, parce que le personnage est passionnant et ce sont des sujets que je n’ai jamais explorés en tant que comédien. Et surtout, je voulais toucher au théâtre. C’est une expérience indispensable pour un acteur, alors il fallait que je saisisse cette opportunité. Le rôle est tellement formidable, c’est un cadeau du ciel !
P. P. : Tu ne savais pas encore ce qu’on allait faire de cette adaptation ?
V. S. : Non, pas du tout. Même une fois que j’avais décroché le rôle, je ne savais pas que ça resterait sur la relation entre le père et le fils, parce que le livre parle d’autres sujets. Je pensais qu’on allait explorer tout ce qu’il y a dans le livre.

P. P. : Ce qui était plaisant avec Vassili, c’est que je ne le connaissais pas. On cherchait des corps jeunes. Comme Panayotis a écrit ce livre après ce qu’il a vécu, j’avais besoin d’un corps qui vit ce qui a été écrit, pas d’un corps qui a le temps de penser à ce qui a été vécu. Vassili est évidemment plus vieux que le personnage, mais, dans sa fougue, il a cette jeunesse. Au casting, ça a été une évidence. Quand j’ai travaillé avec lui, je ne me suis pas demandé s’il serait bon. C’était le Fils. Ce n’est plus Vassili, ce n’est plus Panayotis.
Paul, dans la préface de l’adaptation, vous dites que vous ne vouliez pas lire le livre. Comment avez-vous travaillé l’adaptation ? Avez-vous pu trouver la distance qu’il faut entre le personnage de Panayotis et le personnage du Fils ?
P. P. : Ce qu’il dit dans le livre, je l’ai vécu avec lui. J’étais là pour lui pendant tout ce qu’il a traversé. Alors, au moment où le livre sort, c’est trop proche de moi. Panayotis m’avait demandé d’adapter le livre, il m’avait donné les épreuves pour que je lise, mais je ne l’ai jamais fait. Je lui ai dit : “C’est toi, c’est ton récit, je n’ai pas à regarder s’il y a quelque chose qui ne me plaît pas.” Finalement, au bout de la douzième fois, je l’ai acheté à la gare. En le lisant j’ai compris que le “je” de son écriture se prêtait à un “nous” universel. Mais la seule manière pour que je puisse travailler ce texte, c’était de tâter le terrain autour de la seule chose qui nous rassemble avec Panayotis : le fait qu’on a huit ans d’écart et le même père. En travaillant le texte à ma manière avec Vassili, en l’ajustant, je pense qu’on a fini par trouver la bonne recette.
Avec ce texte, j’ai décidé de montrer ce qui n’est pas dit dans le livre. Et ça passe aussi par le travail de scénographie, qui est très fort, pour pouvoir accompagner Yann et Vassili. Il y a aussi l’importance du corps. L’écriture de Panayotis était déjà une écriture qui se prêtait à la scène. En faisant en sorte de montrer ce corps, on peut ressentir le texte dans sa chair, et non plus dans les mots. La communication, surtout entre hommes, c’est le thème majeur de cette adaptation.
Avez-vous l’impression que cette pièce peut aider à montrer la nécessité des mots ?
V. S. : Oui, ce texte raconte les dégâts que peut causer le manque de communication, envers les autres et soi-même. C’est ça qui est important, c’est le fait d’accepter de ressentir des choses. Parfois, je bloque les sensations. Je n’ose pas me regarder dans le miroir et accepter ce que je suis, accepter ce que je traverse. Je trouve que c’est un texte qui aide à s’accepter, dans tous les sens du terme. Accepter tout ce qui nous traverse, accepter les défauts, les nôtres et ceux des autres, les prendre, les comprendre. Je parlais du fait de bloquer les choses avec ma mère et du fait de croquer la vie à pleines dents. Il y a une phrase où il dit : “Le plaisir de la vie c’est justement de se faire baiser”, de parfois laisser le monde te baiser, dans le bon sens, celui du plaisir. J’en parlais avec ma mère parce qu’on a réalisé que, de temps en temps, on a tendance à vouloir tout contrôler et ça nous empêche de vivre. Forcément, c’est sûr que ça résonne avec le public.

P. P. : Ce qui se démêle dans ce texte-là, c’est aussi quelque chose qui vient de mon premier spectacle et que Panayotis a repris dans son livre : à force de décortiquer la bête, on finit par la tuer. Ce décorticage que Panayotis fait dans son écriture permet de dire : “Si tu veux dire, tu dis”. Ça aide à poser des mots sur ce qui permettra, peut-être, de génération en génération, de changer les choses et d’en régler certaines. Ce qu’a entrepris Panayotis dans notre famille, c’est d’essayer de régler ces choses. Je trouve qu’il le fait merveilleusement bien puisqu’il le fait avec une vraie franchise, il le retraduit de manière artistique et poétique. Notre travail, c’est de partir de son “je” et d’en faire un “nous” pour le transmettre aux spectateurs. Quand j’ai écrit l’adaptation, j’étais juste un fils, et maintenant je suis père d’une petite fille. C’est la même chose pour tout le monde ou presque, les enfants deviennent parents. Finalement, j’ai l’impression que ça parle autant aux pères qu’aux enfants.
Est-ce qu’en tant que fils et en tant que père, travailler sur le texte vous a poussés à réfléchir à vos relations ?
V. S. : Ça m’a fait réfléchir, mais je n’ai pas les mêmes problèmes que le personnage, je n’ai pas de comptes à régler avec mes parents. Ça me fait voir la vie différemment. Aujourd’hui, j’ai tendance peut-être à accepter de m’ouvrir un peu plus alors qu’avant, je ne trouvais pas forcément sain de remuer les choses, à moins qu’elles soient dites avec bienveillance. Des textes comme celui-là, ça te fait prendre conscience de tout ça. Récemment, j’ai eu des discussions avec mes parents, où je sens que je parle avec eux d’adulte à adulte. J’ose peut-être un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet plutôt que de tendre des perches.
P. P. : Dans le travail de l’adaptation, le plus important, c’était de donner la parole au père. Quand Panayotis a vu la première version, il m’a dit : “Ça, tu ne peux pas le faire dire par le Père, […] c’est le Fils qui le disait”, mais, selon moi, il fallait que ce soit le Père qui le dise maintenant, parce que ce n’est pas notre père. Il faut lui redonner la parole, parce que c’est le personnage principal. C’est parce qu’on donne cette force au Père que d’un coup, le Fils a la possibilité de parler. C’est parce que le Père l’écoute, c’est parce que le Père le relance, c’est parce que le Fils a quelque chose à dire au Père, que ça crée du dialogue. Communiquer est un apprentissage. On est dans une société où ce n’est vraiment pas inné.
Vassili, à quel moment avez-vous eu envie de réaliser les dessins qui accompagnent l’adaptation ?
V. S. : Ça s’est fait de manière très organique, pendant les répétitions. J’aimais bien m’isoler au moment du déjeuner et j’en profitais pour dessiner les scènes qu’on venait de travailler. Au bout d’un moment, Paul m’a dit de continuer les dessins.
P. P. : Ce qui rend les dessins de Vassili aussi extraordinaires, c’est qu’il dessine la manière dont on travaille les scènes. C’est comme s’il arrivait à traduire en dessin les intentions données au plateau. Il dessinait l’intention de mise en scène. Je trouvais ça fabuleux, et il en a fait plein !
Est-ce qu’il y a quelque chose que vous n’avez peut-être pas encore dit ou que vous auriez aimé dire à votre père ?
V. S. : Je pense que c’est quelque chose que je ne lui dirai pas parce que je n’ai pas envie de penser à ça, mais c’est quelque chose que je ressens. Je n’ai pas hâte du jour où il va mourir, j’y pense beaucoup. Je me dis : “Comment je vais faire le jour où il va mourir ?” Je ne lui pose pas la question parce qu’il va me répondre de manière très positive, et je vais dire : “Oui, tu as raison”.
P. P. : Ce n’est pas une question, mais une phrase. Je dirais : “Plus je te tue, plus je t’aime.”