
Deux ans après l’agression au couteau qui a failli lui coûter la vie, Salman Rushdie revient sur son voyage au seuil de la mort et s’interroge sur la chance qui lui est offerte : celle de vivre une seconde vie.
Pourquoi maintenant ? C’est la première question qui a traversé l’esprit de Salman Rushdie quand la barbarie s’est abattue sur lui. Le 1er août 2022, à 10h45, 33 ans après la fatwa prononcée à son encontre par l’ayatollah Khomeyni suite à la publication des Versets sataniques (1988), dans l’amphithéâtre de Chatauqua, à la frontière avec le Canada, lors d’une conférence consacrée – ironie tragique du sort – à l’importance de la sécurité des écrivains, Hadi Matar, pur produit de l’embrigadement des réseaux sociaux, l’a poignardé à dix reprises, laissant l’écrivain entre la vie et la mort.
Neuf mois plus tard, il y a presque un an jour pour jour, en mai 2023, Salman Rushdie faisait une apparition surprise lors du gala littéraire Pen America. Boitillant, aminci, la voix plus faible qu’à l’accoutumée, il arborait une paire de lunettes étrange, dont l’un des deux verres était teinté pour cacher un œil rendu aveugle par la barbarie. Un effet de style qui avait marqué les esprits. Ses quelques traits d’humour et la qualité de son discours laissaient présager une reconstruction qui suivait son cours. Elle laissait aussi deviner le sujet de son ouvrage à venir. Le Couteau (Gallimard) est le livre qu’il n’aurait jamais aimé avoir à écrire, mais comment faire autrement ? Après tout, conjurer le mal et la mort grâce aux mots, c’est là le pouvoir magique des écrivains.
Écrire la douleur
La plume et le glaive, une vieille tradition qui hante la littérature. Brandir un livre comme une arme qui défie la tragique condition humaine. C’est exactement l’expérience à laquelle nous convie Salman Rushdie. Avec un mélange de soulagement, d’ironie et de détermination à vivre, il raconte son expérience de mort imminente, ces 27 secondes de violence déchaînée où une lame l’a traversé de part en part. Il s’interroge sur son immobilisme. Pourquoi ne s’est-il pas défendu ?
Tétanisé par un mélange de surprise et de peur, il aurait attendu le châtiment. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les pensées pratiques, parfois même futiles qui le traversent au moment du chaos. De « Cela fait beaucoup de sang » à « Oh, mon beau costume Ralph Lauren », en passant par « Mes cartes de crédits sont dans cette poche », tout se passe comme s’il se raccrochait au réel pour se cramponner à la vie.
Il se remémore ainsi sa rencontre avec celle qui est devenue la femme, la poétesse et romancière Rachel Eliza Griffiths, devenu un phare dans la nuit, qui va le suivre tout au long sa convalescence, caméra au poing comme le plus intime des témoins. Une reconstruction douloureuse, éprouvante, pour une gueule cassée et un visage qui tombe en lambeaux, titre du merveilleux ouvrage de Philippe Lançon, autre survivant de l’horreur : celle des attentats de Charlie Hebdo.
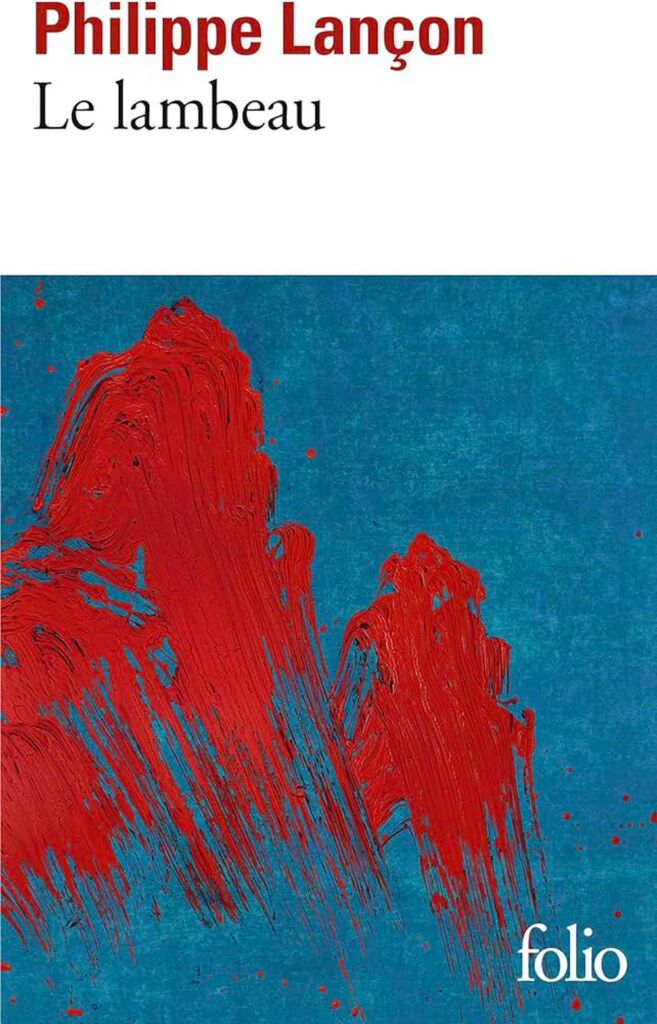
Point d’orgue du récit, cette rencontre imaginaire inventée grâce au pouvoir de la fiction entre la victime et celui qui se voulait être son bourreau. La discussion est animée, les questions de l’auteur se heurtent aux silences de son adversaire de papier. On n’en saura pas beaucoup plus sur ce geste insensé, mais on se confronte à l’émouvante quête de vérité d’une victime qui aurait bien besoin de comprendre pour avancer. Hada Matar restera une énigme, un homme aveuglé, bête et méchant. Tout au long du livre, Salman Rushdie le désignera par une simple lettre, « A ». Parce que ne pas le nommer, c’est un peu se venger.
En pleine lutte pour renaître de ses cendres, Salman Rushdie se confronte en plus à la mort qui rôde parmi ses camarades écrivains. Martin Amis et Milan Kundera tirent leur révérence, Hanif Kureishi s’effondre, son grand ami, Paul Auster, est diagnostiqué d’un cancer du poumon peu de temps après avoir perdu coup sur coup son fils et sa petite-fille. De ces drames successifs, l’auteur de La Trilogie new-yorkaise a d’ailleurs tiré un livre, Baumgartner (Actes Sud), paru il y a quelques semaines et que beaucoup pensent être son dernier. Avec malice et son inusable maestria littéraire, à cheval entre vie inventée, vie rêvée et vie vécue, Paul Auster s’amuse de cet épilogue annoncé et nous offre un envoûtant récit du deuil et de la reconstruction, comme pour conjurer les traumatismes et adresser un ultime pied de nez à la mort.
Ce serait mal connaître Salman Rushdie que d’imaginer un livre qui regarde simplement en arrière. Les ultimes pages embrassent le futur et la déambulation dans les vestiges d’une vie réduite en fumée laisse la place à une réflexion sur l’avenir. Le Couteau prend alors une tournure plus méta, plus philosophique même. Quelle voie emprunter désormais ? Comment et sur quoi écrire ? Comment être au monde ? Beaucoup de questions en suspens pour son œuvre à venir.
Finalement, le livre de Salman Rushdie s’offre à nous comme le point d’exclamation d’une année littéraire placée sous le signe de la guerre intime menée contre les traumatismes enfouis. Écrire pour comprendre, surmonter, conjurer l’inceste qui a ravagé votre enfance comme Neige Sinno dans Triste Tigre (2023, POL), l’un des livres de l’année mêlant récit cru en caméra embarquée et déclaration d’amour aux livres. Écrire pour reconstituer une famille de victimes et réconcilier une nation comme Beata Umubyeyi Mairesse dans Le Convoi (2024, Flammarion) qui se souvient du Génocide du Rwanda. Écrire pour faciliter le dialogue impossible avec l’ennemi intime comme Colum McCann dans American Mother (2024, Belfond) mettant en scène le face à face entre la mère d’un otage américain exécuté et son bourreau djihadiste. Comme toujours, la littérature pour penser, pour panser ses blessures.

















