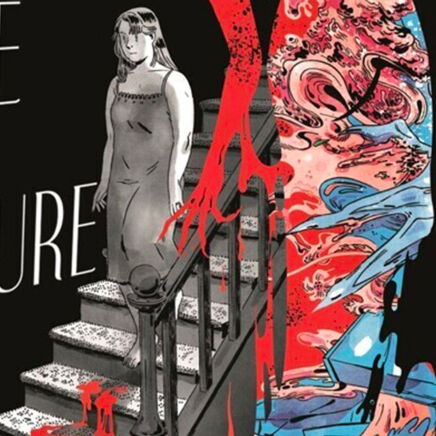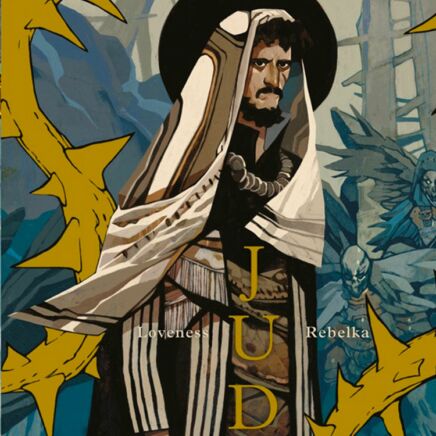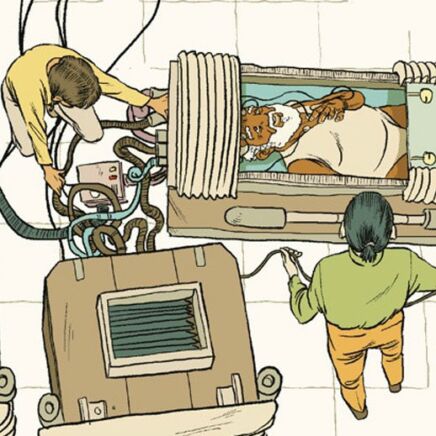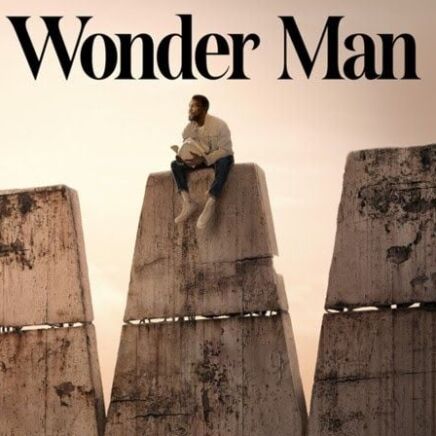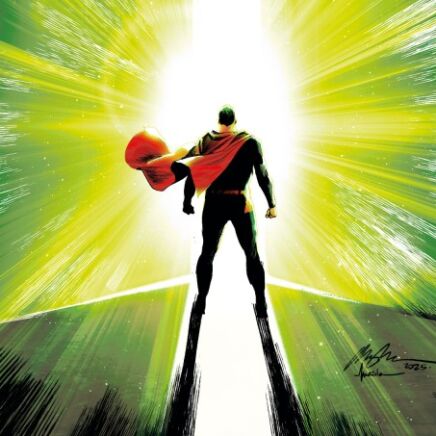Wolverine et sa misogynie, le Punisher et son besoin de violence, Superman et son hypervirilité… Les comportements des super-héros sont de plus en plus pointés du doigt. Mais sont-ils vraiment toxiques ?
Depuis quelques années, l’expression s’est invitée dans les conversations et dans les réflexions. Et la pop culture regorge d’exemples de masculinité toxique : les spectateurs de You sont séduits par Joe, qui est en réalité un tueur en série, ceux de Gossip Girl rêvent d’une romance avec Chuck Bass, violeur et pervers, et ceux de 50 nuances de Grey fantasment la puissance et la domination de Christian Grey. Les films et séries glorifient des comportements nocifs, mais qu’en est-il des comics ? Le sociologue Éric Maigret s’est intéressé à la question dans son article « Strange grandit avec moi » : sentimentalité et masculinité chez les lecteurs de bandes dessinées de super-héros. Nous avons échangé sur le sujet avec lui.
Comment définiriez-vous la masculinité toxique ?
Ce concept vient du champ de la psychologie et des mouvements militants. Il a permis d’identifier et de dénoncer des activités sociales dangereuses et pénalisantes. Pour le résumer simplement, ça renvoie à la violence exprimée par les hommes envers les autres, principalement les femmes, qu’elle soit physique ou verbale. On peut aussi y associer toute une gamme de comportements masculins : l’excellence, la volonté d’être le plus fort, le processus de « carapacisation » (se forger une carapace et réprimer ses émotions)… La violence non physique inclut la misogynie, mais elle peut aussi être à destination d’autres hommes.
Comme le fait d’exclure ceux qui ne correspondent pas à un « idéal » stéréotypé ? Ils ne sont pas considérés comme des hommes s’ils ne sont pas virils, s’ils pleurent, s’ils ne sont pas sportifs…
Exactement. Les normes ont évolué dans le temps, mais la version contemporaine de cette masculinité a été forgée comme un idéal au XIXe siècle. C’est un moment de grands bouleversements sociaux et économiques, et une certaine masculinité va être vantée en réponse aux défis sociaux perçus, notamment l’émancipation féminine, très progressive. Avec la salarisation, le monde du travail devient plus complexe et la promotion d’un idéal de masculinité virile s’impose, faite de domination et de retenue des émotions. Cela, même jusqu’au style vestimentaire. L’invention des costumes a neutralisé les hommes. Avant, ils portaient des vêtements plus colorés, fleuris et qui pouvaient épouser le corps.
Superman correspond à cet idéal d’homme fort qui ne montre pas ses émotions. Peut-on parler de masculinité toxique chez les super-héros ?
Ce sont les limites du concept : il est trop homogénéisant et il y a parfois une confusion entre masculinité traditionnelle, virilité et toxicité. La réalité est plus complexe. Les super-héros américains (DC Comics, Marvel…) naissent en 1938 avec Superman, au moment où le modèle dominant semble en crise. Après la Première Guerre mondiale, les femmes s’émancipent de plus en plus et s’affirment sur le marché du travail. D’un côté, Superman est la virilité traditionnelle du XIXe siècle : c’est la figure rassurante, virile et musclée. Mais il est aussi montré comme menacé dans sa masculinité. Clark Kent est par exemple intimidé par une femme, Lois Lane, dont il est amoureux et qui le tyrannise dans le monde du travail. Pour moi, ce super-héros est au contraire une interrogation sur une masculinité hégémonique. Il ne faut pas oublier non plus que le personnage a été créé dans le cadre du New Deal américain. Il est lié à l’esprit rooseveltien d’ouverture de la société.
En 2010, Sharon Lamb a publié une étude dans laquelle elle évoque une différence entre le super-héros d’antan qui « sous son costume était une vraie personne » et celui d’aujourd’hui, agressif et ultraviolent.
Je suis d’accord, mais il ne faut pas l’étendre à tous les super-héros. À partir des années 1950-1960, l’univers change profondément. Spider-Man est lié à des conceptions de gauche et de mild masculinity, de masculinité douce. Celui de Steve Dikto dans les années 1960 était très peu musclé et beaucoup moins dans cet idéal de masculinité. C’est un adolescent moqué, qui se fait harceler parce que les autres considèrent qu’il n’est pas viril. Il galère avec les filles, a des problèmes d’argent, il ne vit pas dans une banlieue cossue… Même quand il se transforme en Spider-Man, il a des loupés quand il se bat. Il s’en sort beaucoup par l’humour. Il représente un tournant à partir duquel la masculinité traditionnelle va être interrogée.
Pourtant, l’arrivée du Punisher dans les années 1970 correspond clairement à une masculinité toxique…
Dans les années 1970 s’effectue un retour des thématiques conservatrices avec le reaganisme, et les super-héros ne vont pas y échapper. Les personnages construits dans ce contexte, comme le Punisher, ressemblent un peu à Charles Bronson dans Un justicier dans la ville. Le type a perdu sa famille donc il va abattre tout le monde. On est dans une hypermasculinité physique : il est très musclé, il a des armes et il tue délibérément. Ce super-héros apparaît d’ailleurs pour la première fois dans les pages de Spider-Man et l’opposition entre les deux personnages est dramatisée. C’est intéressant, car on voit deux masculinités, mais aussi deux visions politiques. Un autre personnage toxique que l’on peut citer c’est évidemment Wolverine : il est ultraviolent, règle ses problèmes sociaux à travers la bagarre, il est en permanence dans la répression de ses sentiments… Et il sous-entend que les femmes sont moins adaptées que les hommes à la lutte physique et aux conflits interpersonnels. Mais si le Punisher est très premier degré, Wolverine est une mise en abyme de la masculinité toxique.
Comment évoluent les superhéros dans les décennies suivantes ? Ces différentes représentations cohabitent ?
À partir des années 1980-1990, il y a plusieurs phénomènes. D’un côté, la BD américaine va avoir tendance à produire beaucoup de personnages qui correspondent à une masculinité traditionnelle : les hommes sont très musclés, les femmes sont hypersexy et moulées dans leur costume. C’est lié à une certaine idéologie conservatrice et au fait que des productions cinématographiques américaines valorisent l’hypervirilité avec Stallone, Schwarzenegger… D’un autre côté, des auteurs comme Alan Moore vont déconstruire ces figures et la violence qu’elles pourraient représenter. Ils présentent des personnages qui ont encore une influence aujourd’hui.
La série The Boys de Garth Ennis est formidable et met en scène l’hyperviolence de cette masculinité toxique. Elle est assumée par des personnages qu’on déteste et qu’on dénonce. Homelander pousse le spectateur à s’interroger : si une personne avait des pouvoirs comme Superman, il serait nécessairement toxique car il aurait un fantasme de toute-puissance et de violence à l’égard des autres. On a aussi des productions comme Jessica Jones qui présentent un point de vue féminin. Elle est scénarisée par un homme dans les comics et par des femmes dans la série télévisée. Elle met en scène une superhéroïne qui a subi des violences masculinistes, y compris un viol. L’expérience des abus sexuels, de la violence domestique est au cœur du récit. Cette série dénonce ouvertement ces comportements.
Les comics tentent d’être de plus en plus inclusifs, mais, dans les années 1950, il était interdit de représenter la communauté LGBTQIA+. Peut-on dans ce cas parler de masculinité toxique ?
C’est l’affaire Wertham. Au début des années 1950, ce psychologue s’est lancé dans une sorte de chasse aux sorcières. L’ordre moral devait régner et Batman était dans le viseur. Ce personnage est plus sombre que Superman. Il était accompagné d’un jeune acolyte, Robin, et on l’accusait d’avoir des relations amoureuses avec lui. Cette campagne homophobe a abouti et produit une aseptisation des comics et l’évitement de toute représentation sociale diversifiée. D’ailleurs, les BD de super-héros dans les années 1950 étaient très ternes, tristes et stéréotypées. C’est Spider-Man qui a permis de revenir à une certaine inventivité et de s’échapper de ce carcan.
Ces images stéréotypées ont-elles eu des impacts sur les lecteurs et les lectrices ?
Je pense que le public n’est pas fondamentalement changé par ce qu’il lit ou regarde. C’est plutôt les BD et les films qui vont s’adapter à lui. En sociologie, on considère que l’impact premier des médias, c’est de renforcer une opinion qui existe. On va chercher à confirmer ce que l’on est plus qu’autre chose, même si l’on peut considérer que le non-changement est aussi un effet des médias.