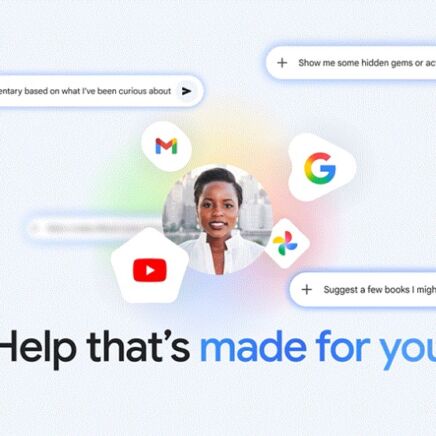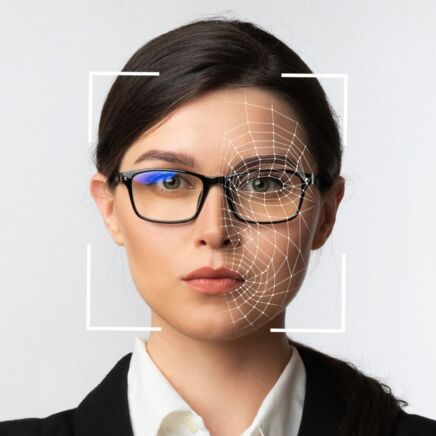Dans Formés à la haine des femmes, la journaliste Pauline Ferrari décortique la propagation de l’idéologie masculiniste sur les réseaux sociaux.
Pauline Ferrari est journaliste indépendante, spécialisée dans les nouvelles technologies ainsi que les questions de société, en particulier liées au genre. Dans Formés à la haine des femmes : comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, elle s’intéresse à ces communautés dont l’inquiétante progression ne fait que s’accélérer sur Internet ces dernières années.
Comment définiriez-vous le masculinisme ?
Je me base sur une définition faite par l’historienne du féminisme Christine Bard et les deux sociologues Francis Dupuis-Déri et Mélissa Blais, qui expliquent que le masculinisme, c’est une branche de la pensée antiféministe. D’après moi, l’antiféminisme c’est la théorie, et le masculinisme, c’est la mise en pratique de cette théorie à travers des actions, des mouvements sociaux, des groupes de parole, etc.
Quel est le profil des personnes qui adhèrent à cette idéologie ?
C’est un peu compliqué de faire un portrait type, parce que ce sont des communautés assez hétérogènes et éclatées. Le dénominateur commun, déjà, c’est que ce sont des hommes en grande majorité blancs et hétérosexuels. Souvent, ils sont en position de déclassement social, ont des difficultés avec le monde du travail ou avec les relations sociales.
Ce sont des personnes assez isolées, je dirais. Mais après, ça traverse vraiment tous les mouvements politiques et toutes les classes sociales. C’est toujours très compliqué de dresser un portrait-robot, mais on peut dire que ce sont de jeunes hommes blancs, hétérosexuels, assez effrayés de perdre leur “place”.
Quel rôle jouent les réseaux sociaux et leurs algorithmes dans la propagation du masculinisme ?
Le masculinisme a toujours existé et a toujours été concomitant au féminisme, mais Internet a donné aux communautés masculinistes un endroit pour se rassembler, pour communiquer entre eux et pour s’organiser. Avant, c’était un peu moins facile dans la “vie réelle”. Là, ça a donné des réseaux transnationaux – majoritairement anglophones – très forts. Internet a donc joué ce rôle d’agrégateur.
De plus, les réseaux sociaux tels qu’ils sont conçus actuellement, notamment de par leurs algorithmes, valorisent extrêmement les contenus polarisés et polarisants, clivants. Les masculinistes ont compris très vite et très bien comment ces algorithmes pouvaient pousser leurs contenus, parce qu’ils provoquent beaucoup de réactions, beaucoup d’engagement, de fait. Les algorithmes poussent donc les contenus masculinistes, parce que ce sont des contenus qui fonctionnent bien sur Internet et qui sont assez populaires, qu’on les aime ou qu’on les déteste.
À lire aussi
Que font les réseaux sociaux face à ça ? Y a-t-il un certain laxisme ou font-ils des efforts pour le combattre ?
Dans les discours officiels, il y a des efforts. C’est particulièrement le cas de la part de plateformes comme TikTok, qui ont un public très jeune. Elles veulent vraiment s’assurer, en tout cas en façade, que les mineurs sont protégés grâce à plein de fonctionnalités. Il n’empêche que quand on regarde les faits, notamment la question de la modération des contenus, les contenus masculinistes ne sont pas du tout modérés, voire ils sont mis en avant.
On a un peu l’impression d’une politique de l’autruche du côté des réseaux sociaux, qu’ils disent : “Non, ça ne nous concerne pas, on n’y peut rien.” Donc je dirais qu’ils sont dans une forme de laxisme, parce qu’en fait ces contenus-là leur rapportent de l’argent. Donc elles ne peuvent pas vraiment s’en passer en ayant des politiques trop dures envers ces communautés.
Le dernier rapport du Haut Conseil de l’Égalité, publié la semaine dernière, montre justement ce biais contre les femmes dans le numérique…
Malheureusement, ça confirme toutes les recherches que je fais depuis quelques années, notamment l’inaction des plateformes. Ce rapport confirme ce qu’on sait déjà, c’est-à-dire que la plupart des personnes qui sont victimes de cyberviolence sont des femmes, des filles, des militantes, particulièrement quand elles sont féministes, racisées ou issues des communautés LGBT. C’est beaucoup plus simple à établir que le profil des cyberharceleurs.
Ça montre aussi que les algorithmes qui gèrent nos vies et nos réseaux sociaux sont faits par et pour des hommes. Isabelle Collet, qui est une chercheuse que j’admire beaucoup, a participé à ce rapport et elle dénonce depuis dix ans maintenant le fait que les algorithmes sont faits par et pour les hommes et que c’est une des grandes problématiques du sexisme en ligne.
Est-ce que ça s’est empiré ces dix dernières années ou voit-on une amélioration de la situation ?
Je ne dirais pas que ça s’améliore. J’aimerais bien trouver un message d’espoir, mais j’ai la sensation que, autant en 2017, quand il y a eu #MeToo, il y avait un peu un consensus tacite, disant que la parole se libérait, qu’on ne pouvait pas “trasher” les femmes qui parlent de leurs agresseurs, etc.
Après 2017, il y a eu un backlash (retour de bâton) qui a été très présent, mais qui est de plus en plus fort, particulièrement depuis 2020, parce qu’on a passé beaucoup de temps sur les écrans avec la pandémie. Ça a été une formidable période pour les influenceurs masculinistes qui ont pu créer plus de contenu et avoir une audience beaucoup plus grande.
C’était aussi une période qui était psychologiquement très compliquée pour beaucoup de gens, particulièrement les jeunes. Les algorithmes leur proposaient des contenus qui leur parlaient, qui parlaient de leurs peurs aussi, donc forcément, ça a créé aussi un effet d’absorption. D’autres événements ont participé à cette accélération très, très forte comme la montée en popularité de l’influenceur Andrew Tate et le procès Johnny Depp/Amber Heard.
Quel impact ces discours et ces cyberviolences ont-ils dans la “vraie vie” ?
J’ai particulièrement constaté cet impact dans les salles de classe quand je faisais de l’éducation aux médias. Des propos que je pouvais lire sur Internet il y a dix ans, des choses très violentes, très sexistes, très homophobes, par exemple, sont devenus complètement décomplexés dans les salles de classe, mais aussi dans les médias et dans la sphère politique. Ce qu’on constate, c’est que ces propos, que l’on considérait extrêmes et marginaux il y a dix ans, sont devenus banals, voire une sorte de norme sur nos plateaux télé, dans nos médias, dans des conversations entre amis, y compris chez les jeunes en salle de classe.
« Il y a un vrai travail à faire sur la question de la santé mentale, en particulier de la santé mentale des garçons et des jeunes hommes, pouvoir créer des espaces “safe” pour eux, pour libérer des émotions négatives sans que ça passe par la haine envers les femmes et envers eux-mêmes. »
Pauline Ferrari
On se retrouve donc avec de la désinformation à un très large niveau, chez des ados, chez des jeunes garçons qui sont, par exemple, persuadés que la plupart des femmes qui portent plainte pour viol ou agression sexuelle mentent. C’est une croyance qui est très ancrée chez certains jeunes garçons.
Que font la France et l’UE contre le masculinisme ? Est-ce considéré comme une menace particulière ou comme un cyberharcèlement comme les autres ?
La question des cyberviolences est très, très mal traitée, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. On a beaucoup de recommandations, mais les plateformes ne sont obligées à rien. La dernière loi européenne, le Digital Service Act, qui est en vigueur depuis fin août, était censée contraindre les plateformes – un peu comme voulait le faire la loi Avia – à des amendes à hauteur de 6% du chiffre d’affaires par an si elles ne respectaient pas les exigences en termes de modération. On se rend compte qu’en fait, elles n’en font rien.
À lire aussi
En France, ce que j’ai constaté dans mes recherches, c’est que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la misogynie n’est pas forcément vue comme un motif légitime d’attaque. Même au niveau européen, le masculinisme est vu comme une espèce de branche de l’extrême droite, comme quelque chose de complémentaire, mais qui n’est pas une fin en soi. Comme s’il ne pouvait pas exister de terrorisme misogyne.
Ce qui fait qu’on laisse de côté énormément d’affaires, y compris dans des cas de féminicide, par exemple, où la misogynie est complètement balayée. On ne considère pas ça comme étant du terrorisme ou des attaques. On a beaucoup de mal à prendre du recul et à peut-être considérer que la misogynie est aussi un mouvement politique, organisé et que le masculinisme est une vraie idéologie qui tue.
Que peut faire chaque personne, à son échelle ?
Je pense qu’il y a plusieurs aspects. J’ai écrit un chapitre sur les solutions, justement, pour essayer de trouver des pistes. Je pense qu’il faut déjà bien comprendre comment fonctionnent les violences, les cyberviolences et les stéréotypes de genre. Comment ils se mettent en place, comment les cyberviolences agissent, qu’elles sont punissables par la loi, par exemple. Ça va avec une bonne éducation aux médias et à l’information, comprendre comment les algorithmes fonctionnent, pourquoi on nous propose un contenu plutôt qu’un autre…
Ça passe aussi par une vraie discussion à avoir avec les jeunes et avec ses amis. Engager des discussions sur l’image qu’on se fait des femmes et des relations hommes-femmes. C’est aussi arriver à identifier ce qu’est le masculinisme, où il se cache dans nos discours quotidiens et dans les contenus qu’on regarde. À partir du moment où on arrive à repérer les contenus masculinistes, ça va beaucoup plus vite. On arrive alors à les déconstruire.
Enfin, je pense qu’il y a un vrai travail à faire sur la question de la santé mentale, en particulier la santé mentale des garçons et des jeunes hommes, pouvoir créer des espaces “safe” pour eux, pour parler de leurs émotions, de ce qu’ils ressentent, libérer des émotions négatives sans que ça passe par la haine envers les femmes et envers eux-mêmes.