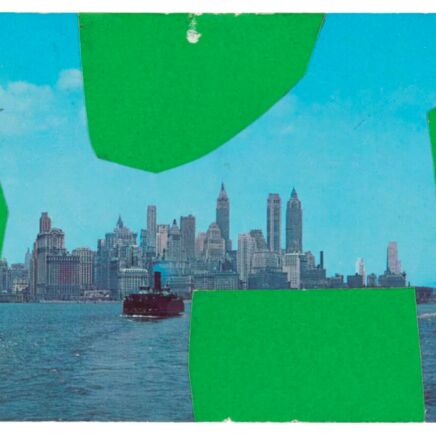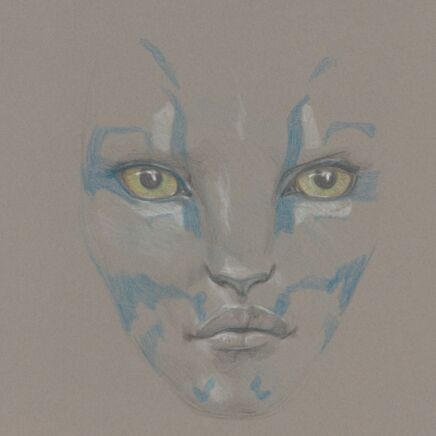Du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023, le musée du Louvre accueille une exposition d’envergure sur la nature morte, genre pictural relativement délaissé, mais qui présente pourtant de nombreuses ramifications jusqu’à aujourd’hui. Parce qu’elle convoque une vision des « choses », la nature morte est en réalité aussi plurielle que les artistes qui interrogent le monde à différentes périodes de l’histoire : ainsi est née cette grande exposition riche de près de 170 œuvres de la préhistoire à nos jours.
C’est non seulement en qualité de commissaire d’exposition, mais également d’autrice, que Laurence Bertrand Dorléac, professeure d’histoire de l’art à Sciences Po, a été conviée par la nouvelle présidente du Musée du Louvre, Laurence des Cars, à concevoir une grande exposition sur l’histoire de la nature morte.
Divisée en 15 séquences thématiques et chronologiques, elle s’inscrit dans le prolongement du livre intitulé Pour en finir avec la nature morte, paru chez Gallimard en 2020, dans lequel Laurence B. Dorléac sondait, à travers l’histoire de l’art, le dialogue intime entre êtres vivants et non vivants, entre « nous » et les objets que l’on appelle plus communément les « choses » ; ce dialogue entre artistes du présent et du passé devrait alors nous renseigner sur ce genre pictural de la « nature morte » qui, à y regarder de plus près – ou de plus loin, selon d’où l’on se place –, se révèle bien plus vivant qu’il n’y paraît.
Les choses de la vie
C’est ce credo que reprend l’exposition, dissipant au passage l’ambiguïté du titre de l’ouvrage, qui visait moins à disqualifier le genre de la nature morte que d’évacuer les lieux communs qui l’entourent. Car, qui dit nature morte, dit peintures de fleurs, de légumes et de fruits, en passant par les « vanités » des écoles flamandes et hollandaises du XVIIe siècle, les bodegones espagnols ou encore les natures mortes du peintre français Chardin, au XVIIIe siècle. Un certain classicisme généralement associé à l’idée que l’on se fait de la nature morte, mais que l’exposition ne rejette aucunement : au contraire, elle le revalorise en le faisant dialoguer avec un ensemble d’œuvres antérieures et postérieures, croisant les aires géographiques et les périodes historiques.
Dans la continuité de son livre, la commissaire d’exposition convoque artistes, poètes, écrivains et philosophes pour souligner cette relation, ce rapport actif entre les êtres qui présiderait en réalité au genre de la nature morte, lequel ne peut définitivement plus se reposer sur la seule observation de choses inanimées.

Une ambition que n’aurait certainement pas reniée le philosophe, anthropologue et sociologue des sciences Bruno Latour, mort dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier à l’âge de 75 ans. « J’ai imaginé cette exposition non pas tellement sur les choses, mais plutôt sur notre dialogue avec les choses », confie Laurence B. Dorléac, proche du philosophe, au moment d’inaugurer son exposition, se réclamant de cette idée typiquement latourienne que « tout fait monde ». Regarder une nature morte pour elle-même ne suffit plus : elle est à prendre comme la partie d’un tout qui nous inclut. Le seul fait d’avoir mis sur pied un programme renversant de la sorte les perspectives et de le proposer dans l’enceinte du Louvre, institution plutôt accoutumée aux grandes expositions thématiques ou monographiques – rarement aura-t-on vu autant d’œuvres contemporaines conviées dans le plus célèbre musée du monde –, mérite que l’on s’y attarde.
C’est donc un regard renouvelé sur la nature morte que cette exposition, aussi déboussolante que foisonnante, tente de mettre au jour. Des œuvres de tout temps s’y bousculent, grâce à des prêts d’institutions du monde entier, rassemblées par cette même idée que les choses agissent sur nous et réciproquement, dévoilant à la fois quelque chose de notre rapport aux biens matériels et de la sensibilité des artistes qui les ont représentés.
Dès la première séquence, les travaux de Christian Boltanski dialoguent avec une série de haches préhistoriques datées de 3500 avant notre ère – ce qui en ferait l’une des toutes premières natures mortes – et des stèles égyptiennes, tandis que La Madeleine à la veilleuse (1640-45) de Georges de La Tour fait écho à la scène de fin de Stalker (1979) d’Andreï Tarkovski. Art préhistorique, peinture, art contemporain, cinéma : d’emblée, l’exposition nous plonge dans ce mélange de formes et de temporalités et installe en quelque sorte son terrain d’enquête. Une fois accepté ce principe d’organisation – cette hypothèse de recherche, en quelque sorte – le parcours gagne nettement en clarté et en fluidité.

Nature pas si morte
L’exposition remonte jusqu’à l’Antiquité avec des fresques retrouvées à Pompéi représentant, déjà au Ier siècle avant notre ère, des marchandises, des xenia (cadeaux aux invités du maître de maison) ou des memento mori dans lesquels on peut déceler une première forme de vanité, allégorie picturale qu’on retrouvera en majesté tout au long de la Renaissance. Tout en élargissant brièvement la focale vers d’autres continents, l’autrice de l’exposition prend acte de l’éclipse de 1000 ans (environ du VIe au XVIe siècle) durant laquelle la représentation des choses fut, en Occident, entièrement mise au service du religieux. La reconsidération de la nature morte au début du XVIe siècle voit fleurir, notamment chez les peintres flamands ici exposés en nombre, les trompe-l’œil, les vanités, étals de bouchers, de marchands et autres représentations de la prospérité matérielle de l’époque, incarnant la place nouvellement occupée par la marchandise dans un monde de plus en plus globalisé.
Certaines séquences de l’exposition, du fait de sa profusion, se révèlent inégales, voire anecdotiques, mais demeurent engageantes par cette discussion permanente entre artistes du passé et du présent, à l’instar de Gilles Barbier revisitant à sa manière Nature morte avec perdrix et gants de fer de Jacopo de Barbari (peint vers 1504 et considéré comme le premier trompe-l’œil depuis l’Antiquité, le tableau est malheureusement absent de l’exposition). La nature morte de Matisse rencontre celle du peintre néerlandais Jan Davidszoon Heem, celle de Dalí (Nature morte vivante, 1956) répond à l’allégorie de Jacques Linard, le photographe américain de Joel-Peter Witkin se mesure à Arcimboldo et ses célèbres portraits brouillant, déjà à la Renaissance, la frontière entre vivant et non-vivant… Les rencontres sont multiples, parfois plus stimulantes que d’autres et les toiles de grands maîtres (Van Gogh, Manet, Cézanne, Gauguin, Léger, Picasso, etc.) ne manquent pas.

La section phare de l’exposition est sans doute celle consacrée au motif de l’animal mort. Dans la pénombre surgissent les visions dérangeantes, révolutionnaires pour leur époque, de José de Ribera, Goya, Rembrandt (Le Bœuf écorché, 1655), Courbet ou Géricault, menant toutes vers la saisissante Cabeza De Vaca (1984) d’Andres Serrano, photographie d’une tête de vache coupée qui, au lieu de simplement chercher notre empathie, en appelle à notre sens moral et nous fige d’un regard accusateur. À mesure qu’elle tend vers notre époque, en passant entre autres par les films de Fernand Léger (Ballet mécanique), Alain Resnais (Le Chant du styrène) ou Jacques Tati (Playtime), l’exposition est logiquement gagnée par une forme d’inquiétude à laquelle fait écho l’œuvre monumentale de Barthélemy Toguo, Le Pilier des migrants disparus, installée pour l’occasion sous la pyramide du Louvre.
En réaction à l’industrialisation et à la consommation de masse, vivants et non-vivants, êtres humains et marchandises ne forment plus qu’une seule et même chair, à l’image de la jambe surmontée d’une bougie conçue par Robert Grober qui s’incruste littéralement dans l’espace d’exposition, à côté d’une toile de René Magritte (Le Modèle rouge, 1935). Pollution, destruction de l’environnement, souffrance animale, déshumanisation : alors que règne l’incertitude, les artistes contemporains (Jean-Jacques Lebel, Philippe Chancel, Felix Gonzalez-Torres et beaucoup d’autres) continuent de s’emparer poétiquement des choses et de refléter l’état du monde.
Le dernier mot de l’exposition est accordé à la photographe américaine Nan Goldin, dont le cliché, pris lors du premier jour du confinement, ouvre une fenêtre sur un avenir incertain et qui aura sans doute beaucoup de choses à dire – du moment que nous restons à l’écoute des choses.
Infos pratiques
Les Choses, une histoire de la nature morte, du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023, Musée du Louvre (Paris 1er). Tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi.
En prolongement de l’exposition, retrouvez un programme de conférences, concerts et films (Buster Keaton, Terry Gilliam, Tim Burton, etc.).