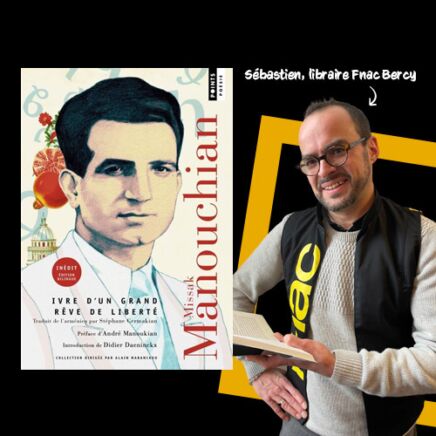Le cinéma, en s’imposant comme l’art grand public majeur, a toujours su s’emparer des sujets les plus complexes. La Shoah ne fait pas exception, à tel point que le nom même de ce fait historique provient d’une œuvre cinématographique. A l’occasion de la sortie de La Zone d’intérêt, nous souhaitions analyser la représentation du génocide du peuple juif commis par l’Allemagne nazie au sein du 7ème art, et des implications éthiques que cela a pu avoir.
« Le cinéma est le dispositif d’apparition des corps réels dans le temps, la machine qui montre les hommes aux hommes en ayant enregistré les traces qu’ils laissent dans les quatre dimensions ; la Shoah fut non seulement une opération d’anéantissement des corps réels, tués puis brûlés, mais une procédure d’effacement du dispositif d’anéantissement lui-même, une machine à supprimer l’humain jusque dans ses traces. La Shoah est une tragédie de l’humanité dans son rapport au visible, c’est à ce titre qu’elle concerne fondamentalement le cinéma. »
Cette citation du critique de cinéma Jean-Michel Frodon, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, illustre parfaitement le rapport entretenu entre deux des phénomènes les plus marquants du 20e siècle, qui ont participé, chacun à leur manière, à la construction d’une identité collective propre au monde occidental.
Le cinéma a accompagné la naissance d’un imaginaire collectif forgé sur les bases de la révolution industrielle de la seconde moitié du 19e siècle qui a ouvert le champ des possibles. D’abord invention technologique pour épater les foules, il s’est peu à peu établi comme une forme nouvelle d’expression artistique. Réceptacle de tous les fantasmes, de l’imagerie du rêve, le « Septième art » est également devenu un reflet des évolutions de notre société et un prisme à travers lequel une certaine forme de la réalité est donnée à voir aux spectateurs.
A l’inverse, la Shoah questionne l’être humain en remettant en cause les fondements sociaux et moraux qui constituent le socle de notre identité. L’entreprise de « destruction des Juifs d’Europe » (selon l’expression qui sert de titre à l’œuvre monumentale de l’historien américain Raul Hilberg) n’est pas le premier massacre de masse de l’Histoire, mais constitue un traumatisme mondial jamais vu auparavant. La mise en place d’une politique d’Etat raciste fondée sur les idéologies antisémites de la fin du 19e siècle, qui a progressivement basculé vers une extermination ethnique et religieuse validée par les dirigeants du Troisième Reich, est la première organisation politique, administrative et industrielle qui a fait en sorte de rendre possible le meurtre de millions de personnes dont le seul tort était d’exister. Ce processus s’est caractérisé par un déni de l’humain qui interroge la possibilité de représentation de l’événement, à tel point qu’il a donné naissance à un nouveau langage de l’horreur.
La remise en cause des fondements mêmes du cinéma
La Shoah remet en cause le cinéma dans ses fondements, en posant la question de l’irreprésentabilité. Le déni de l’image qui a accompagné la disparition des corps prouve la volonté du régime nazi de nier l’existence des populations exterminées, notamment la population juive. Adolf Hitler et ses conseillers politiques employaient une périphrase pour désigner leur action : « la Solution Finale à la question juive ». L’objectif était ainsi de ne pas laisser transparaître la notion d’extermination dans les termes de définition de sa mise en place.
La question de la légitimité de l’art dans l’évocation d’événements historiques existe depuis toujours : l’art cinématographique, par les nombreuses modifications de perception de la réalité que sa naissance a impliquées, est particulièrement représentatif de cette interrogation. En quoi la Shoah est-elle une question de cinéma ? Car elle force l’industrie dans son ensemble à s’interroger sur ce qu’on peut représenter ou non, sur les droits qu’un artiste (ici un cinéaste ou un acteur) peut s’accorder en marge de la réalité historique de faits particulièrement sensibles. Si le cinéma devient un outil de transmission de mémoire, quelles sont les limites à la représentation et à la liberté artistique quand on traite un événement aussi fondamental que la Shoah ?
L’éthique de la représentation au coeur du débat
Dès les premières oeuvres cinématographiques portant sur la Shoah, la question de l’éthique de la représentation s’est imposée. Elle peut revêtir de nombreux aspects et pousse les cinéastes à s’interroger sur la manière de concevoir leur film : faut-il respecter strictement la vérité historique ? Cela n’aurait aucun sens dans le processus de création artistique. La mise en scène est-elle acceptable ? C’est la base même d’une oeuvre de cinéma, la nier serait absurde. Mais quel usage en faire pour qu’elle soit au service du récit historique tout en ne jouant pas avec les sentiments et en gardant un devoir de réserve ?
Le meilleur exemple de cet équilibre délicat à trouver est la polémique qu’avait suscitée une scène dans La liste de Schindler, de Steven Spielberg. On y voit un groupe de femmes juives transportées vers des douches à leur arrivée au camp d’Auschwitz, attendant de longues minutes de savoir si elles s’apprêtent à être gazées ou simplement à se doucher. Les ressorts de mise en scène et le suspense macabre installé par Spielberg avant de découvrir qu’il s’agit de vraies douches avaient provoqué l’émoi dans le milieu de la presse spécialisée, avec notamment une saillie de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qui avait estimé que le cinéaste américain avait dépassé les limites éthiques de sa fonction.
« Spielberg a commis une faute morale en montrant les femmes dans une chambre à gaz reconstituée d’Auschwitz, et en osant créer un suspense cinématographique : sortira-t-il de l’eau ou du gaz des pommeaux ? On ne doit pas toucher à cela, c’est une transgression« , avait déclaré Claude Lanzmann dans un entretien accordé à Elisabeth Schemla dans Le Nouvel Observateur (février 1994).
Certains critiques ont pourtant estimé qu’il s’agissait d’une mise en scène efficace au service de l’identification du spectateur : quel meilleur moyen pour faire ressentir l’angoisse des déportés qu’une scène de ce genre ? Mais se pose alors la question de la pertinence de vouloir faire revivre ce type d’émotions aux spectateurs et de l’indécence que cela peut représenter.

Un autre exemple moins connu mais très emblématique de ce sujet de la morale et son respect induit par la mise en scène avait précédé ce cas plus grand public de La Liste de Schindler. En 1961, le critique (et futur cinéaste) Jacques Rivette avait chargé le réalisateur italien Gillo Pontecorvo dans un article paru dans Les Cahiers du cinéma intitulé « De l’abjection » (ça donne le ton…).
Rivette avait dénoncé vertement la scène finale du film Kapo mettant en scène le suicide d’une déportée juive incarnée par Emmanuelle Riva, lors de laquelle le réalisateur s’était permis un travelling avant et un recadrage artistique en contre-plongée du cadavre pour « embellir » le personnage. Cette affaire avait d’ailleurs mené Jean-Luc Godard à prononcer sa fameuse maxime : « Le travelling est affaire de morale. » Ces différents débats ont en tout cas établi qu’une éthique de la représentation cinématographique était en constante négociation lorsqu’un cinéaste décidait de s’emparer d’un sujet ayant une portée émotionnelle et commémorative.

La question sensible de la comédie
Autre approche sensible et non moins débattue, la comédie a plusieurs fois tenté de s’emparer du sujet de la Shoah. Le meilleur exemple est bien entendu Roberto Benigni et son chef d’oeuvre multi-récompensé La Vie est belle, à la fois encensé pour sa poésie et son humanisme mais aussi critiqué pour son choix de genre et sa volonté de placer le massacre du peuple juif en arrière-plan d’un film poétique sur la relation d’amour entre un père et son fils. C’est pourtant bien l’effet contraire qui se produit, puisque le spectateur n’ignore jamais qu’une tragédie a lieu en arrière-plan et ne s’en trouve que plus horrifié. Les ressorts comiques n’en sont que plus efficaces pour souligner l’absurdité et placer le spectateur dans la peau des déportés, incapables de croire à une horreur aussi énorme. Ce choix de récit fait écho à Primo Levi, auteur rescapé des camps (il faut lire Si c’est un homme si ce n’est pas déjà fait) : « Et si ce n’était qu’une blague ? Tout ça ne peut pas être vrai… »
Bien longtemps avant Benigni, un certain Charlie Chaplin n’avait pas attendu d’apprendre la réalité de l’horreur des camps pour dénoncer l’antisémitisme primaire du régime nazi sous la forme comique avec son Dictateur, meilleure réponse à Adolf Hitler alias Adenoid Hynkel. A la même époque, le génie expatrié Ernst Lubitsch avait lui-même réussi à tourner en dérision le Troisième Reich avec To be or not to be, brillante satire à l’humour noir. Ces deux oeuvres n’ont pas eu à faire face au dilemne de représentation du génocide dans les camps mais ont su poser les jalons d’autres oeuvres cinématographiques capables de toucher les spectateurs avec humour malgré la violence des thématiques abordées. Le cinéma est aussi là pour nous marquer émotionnellement, c’est souvent son effet le plus efficace pour comprendre un événement.

C’est finalement Benigni qui résume le mieux le rôle que peut occuper la comédie dans cette transmission mémorielle essentielle à travers ce média qu’est le cinéma : « Rire nous sauve, voir l’autre côté des choses ou réussir à l’imaginer nous aide à ne pas être réduits en miettes, à ne pas être écrasés comme des brindilles, à résister pour réussir à passer la nuit, même quand elle s’annonce très longue. Dans ce sens, on peut faire rire sans blesser personne : l’humour juif est téméraire. » (Télérama, interview parue en mai 1998).
Les oeuvres cinématographiques fondamentales à propos de la Shoah
Nous souhaitions vous faire une liste (non exhaustive) de plusieurs oeuvres clés dans l’évolution de la représentation cinématographique de la Shoah. Documentaires, fictions, films historiques, productions artistiques, témoignages… Ces créations ont eu le mérite de participer à la transmission mémorielle du génocide des Juifs d’Europe. Tous ces angles de réflexion offrent une vision différente de l’événement le plus marquant du 20e siècle, selon l’origine de la personne qui l’a réalisé, sa proximité avec le génocide ou non, l’époque où l’oeuvre a été produite… Il ne tient ensuite qu’aux spectacteurs qui s’en emparent de suivre leur propre chemin dans l’apprentissage et la compréhension d’un événement historique qui semble souvent indicible.
Le Dictateur, de Charlie Chaplin (1940)
Déclaration de guerre à Hitler par l’autre moustachu le plus célèbre de la planète, cette comédie profondément humaniste montre une compréhension des ressorts génocidaires (pourtant encore en construction en Europe) assez bluffante. Charlot est laissé de côté pour laisser la parole à l’artiste, notamment à travers son monologue final devenu mythique.
Nuit et Brouillard, d’Alain Resnais (1955)
Ce film documentaire créé à la demande du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale présente de nombreuses lacunes historiques, notamment dues aux connaissances incomplètes sur le sujet à l’époque et à l’usage du peu d’images des camps trouvables (une bonne partie étant des reconstitutions ou des archives de propagande), mais il a eu le mérite de retracer le long calvaire des déportés pour la première fois sous forme de documentaire historique. Le commentaire en voix-off très poétique de Jean Cayrol, lu par Michel Bouquet, et la volonté d’Alain Resnais d’évoquer la plupart des camps où il a réussi à se rendre, en font tout de même une oeuvre historique fondamentale dans l’éveil des consciences sur la réalité de la Shoah.
Monsieur Klein, de Joseph Losey (1976)
Ce film crépusculaire de Joseph Losey est l’un des plus beaux rôles d’Alain Delon. Robert Klein, alsacien combinard qui profite de l’Occupation pour racheter des oeuvres d’art expropriées à des Juifs à bas prix, reçoit, réexpédié à son nom, le journal Les Informations juives, et découvre ainsi qu’il possède un homonyme juif. Il décide de remonter la piste et se retrouve plongé au coeur des événements génocidaires. Une recherche d’identité d’une noirceur marquante.
Le Choix de Sophie, d’Alan J. Pakula (1982)
Un écrivain récemment installé à New York se lie d’amitié avec un couple étrange. Il s’agit de Sophie, polonaise récemment installée aux Etats-Unis, et de son amant Nathan, brillant intellectuel juif. Ce rôle mythique de Meryl Streep inspiré du roman de William Styron a connu un énorme succès lors de sa sortie. Si la Shoah ne représente qu’une ombre du passé avant d’être au coeur de la fin du récit et qu’on peut juger un peu trop mélodramatique l’approche de Pakula, l’oeuvre évoque très bien le poids de la culpabilité et l’impact émotionnel que la Shoah a eu sur les rares survivants, mais aussi sur les Juifs qui n’ont pas vécu cet événement.
Shoah, de Claude Lanzmann (1985)
S’il devait rester une oeuvre, ça serait sans hésiter celle-ci, à tel point qu’elle a été inscrite au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Claude Lanzmann fait revivre le voyage des Juifs européens vers la mort au cours de la dernière guerre. Pas une image d’archives, pas une ligne de commentaire : un film d’histoire au présent. Au cours des près de 10 heures de ce film unique à la portée symbolique et philosophique rarement égalée, Lanzmann nous replonge au présent au coeur du processus de mort, en lui donnant une raisonnance émotionnelle qui fait de son oeuvre une expérience profondément marquante. Pour mesurer l’impact de ce chef d’oeuvre, sachez que le terme Shoah s’est imposé pour qualifier la destruction des Juifs d’Europe à la sortie du film.
Pour conclure, laissons le réalisateur expliquer l’objectif qu’il a tenté de remplir au cours des 11 années de production de cette fiction du réel : « Shoah, ce n’est pas un film sur la survie, pas du tout, c’est un film sur la mort, sur la radicalité de la mort dans les chambres à gaz et ces protagonistes-là je ne les appelle pas des survivants, aucun d’eux n’aurait jamais dû survivre. (…) Les survivants ne disent pas “je”, ils disent “nous”, ils sont, à la lettre, les porte-parole des morts. C’est le sens profond du film, et c’est pourquoi j’ai eu tant de problèmes depuis la sortie du film, avec les survivants. Ils ne se retrouvent pas dans Shoah : ce film ne parle pas d’eux. » Claude Lanzmann dans un entretien accordé à Jean-Michel Frodon dans l’ouvrage Le cinéma et la Shoah, un art à l’épreuve de la tragédie du 20e siècle.
Au revoir les enfants, de Louis Malle (1987)
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean, nouveau venu fier et secret. Julien et Jean se prennent peu à peu en amitié. La Gestapo débarque un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu’il avait cachés parmi ses petits catholiques. Inspiré de l’histoire vraie de Jacques de Jésus, un prêtre résistant qui a caché des enfants juifs dans son collège, ce classique du cinéma français réalisé par Louis Malle est d’une sobriété et d’un classicisme parfaitement maîtrisés.
Korczak, d’Andrzej Wajda (1990)
Evocation de la vie et de l’œuvre du docteur Korczak, défenseur des droits de l’enfant. Il entra dans la légende le 6 août 1942 quand les SS l’obligèrent à livrer les deux cents orphelins dont il avait la garde dans le ghetto de Varsovie. Il refusa de sauver sa vie, emmena les enfants en cortège derrière la bannière frappée de l’étoile de David et embarqua avec eux dans le train qui devait les conduire aux chambres de la mort à Treblinka. Cette oeuvre biographique assez méconnue de l’immense réalisateur polonais Andrzej Wajda est pourtant bouleversante.
La Liste de Schindler, de Steven Spielberg (1994)
Evocation des années de guerre d’Oskar Schindler, fils d’industriel d’origine autrichienne rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des Juifs en les faisant travailler dans sa fabrique et sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en 1944.
Le célèbre film de Steven Spielberg est probablement l’oeuvre fictive cinématographique la plus connue sur la Shoah, et a eu le mérite d’universaliser le sujet. Si Spielberg a reçu des critiques (notamment de Lanzmann) en raison de ses nombreux recours à la mise en scène et de ses raccourcis scénaristiques destinés à accélérer le récit, on ne peut pas lui dénier une sensibilité et un talent toujours aussi présents pour toucher les spectateurs. L’une des oeuvres majeures à propos de la Shoah.
La vie est belle, de Roberto Benigni (1997)
Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d’ouvrir une librairie malgré les tracasseries de l’administration fasciste italienne. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial, et l’enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Le père est alors déporté avec sa famille vers les camps de la mort, où il fait tout pour éviter l’horreur à son fils en lui faisant croire qu’il s’agit d’un camp de vacances…
Cette fable à la poésie unique a fait débat lors de sa sortie. Benigni a pourtant trouvé l’équilibre subtil pour évoquer sans montrer (ou seulement sous forme de scènes qu’on croit rêvées) l’horreur de la Shoah. Le succès publique et critique du film a en tout cas confirmé qu’il est possible de traiter poétiquement et avec humour ce sujet.

Drancy Avenir, d’Arnaud des Pallières (1997)
En 1996, à Paris, une étudiante en Histoire enquête sur les traces de la participation française à l’extermination des Juifs d’Europe. Le film est composé de trois récits : celui du dernier survivant de la Solution Finale, d’une historienne qui enquête sur le camp de Drancy, et d’un capitaine sur son bateau. Avec Drancy Avenir, Arnaud des Pallières innove en matière de traitement cinématographique de la Shoah avec un docu-fiction en trois parties qui mêle passé et présent et interroge le rapport d’une époque avec son histoire et sa mémoire.
Train de vie, de Radu Mihaileanu (1998)
1941, dans un village juif d’Europe de l’Est. Schlomo, le fou du village, arrive essoufflé devant le conseil des sages pour leur annoncer une terrible nouvelle : les Allemands tuent et déportent vers des destinations inconnues tous les habitants juifs des shtetls voisins. Le conseil se réunit et, après maintes querelles, une idée jaillit de la bouche même du fou : pour échapper aux nazis, ils organiseront un faux train de déportation.
Un an après Roberto Benigni, le cinéaste franco-roumain Radu Mihaileanu ose aussi s’attaquer à la Shoah sous forme de comédie. Mais son film affronte ce terrible sujet sous un angle original : en se tenant en permanence à la périphérie du génocide. Mihaileanu ne cache jamais l’irréalité de sa fiction, et fait même en sorte qu’elle soit visible. Le shtetl et ses habitants hyper-stéréotypés sortent tout droit d’une époque révolue. Il ne cache pas non plus qu’il a souhaité rendre hommage à ce folklore yiddish disparu, en insistant sur certains clichés. Il en ressort un film déroutant, parfois maladroit, mais drôle jusqu’au plan final, d’une tristesse infinie.
Le Pianiste, de Roman Polanski (2002)
Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s’en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l’aide et lui permet de survivre.
Roman Polanski, survivant de la Shoah après avoir vécu plusieurs mois dans le ghetto de Cracovie dont il a réussi à s’enfuir à huit ans, a attendu de nombreuses années avant d’oser aborder ce passé à travers son oeuvre. Tourné en Pologne (c’était la première fois que Polanski revenait dans son pays d’origine depuis 40 ans), le film impressionne par son réalisme et sa mise en scène toute en sobriété. Polanski a perdu sa mère dans les camps, elle a été exécutée dans les chambres à gaz d’Auschwitz, ce qui explique l’académisme avec lequel il s’applique à raconter l’histoire de Szpilman, brillamment incarné par Adrien Brody. Un film dont on ne ressort pas indemne.
Amen, de Costa-Gavras (2002)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, Ricardo Fontana, tente d’informer le Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs organisé par les nazis dans les camps de concentration. Costa-Gavras est le premier à évoquer ce sujet de la position prise par l’église catholique pendant la Shoah et de la connaissance (plus ou moins prouvée) de la réalité du génocide pendant qu’il se déroulait. Inspiré d’une pièce de Rolf Hochhuth, ce film très efficace de Costa-Gavras est un pamphlet contre la lâcheté et la facilité avec laquelle des institutions (étatiques, religieuses…) ont réussi à fermer les yeux sur ce crime contre l’humanité alors même qu’il se déroulait devant eux.
Elle s’appelait Sarah, de Gilles Paquet-Brenner (2010)
Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l’épisode douloureux du Vel d’Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n’était que le sujet d’un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. Ce film sobre et émouvant illuminé par la performance remarquable de Kristin Scott Thomas est adapté du roman éponyme de Tatiana de Rosnay. Il évoque avec délicatesse le sujet du devoir de mémoire et du poids de la culpabilité française suite aux événements collaborationnistes du Vel d’Hiv.
Le Fils de Saul, de László Nemes (2015)
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, les prisonniers juifs isolés du reste du camp pour assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums quand il croit reconnaître le cadavre de son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide de sauver le corps de l’enfant des flammes pour lui offrir une véritable sépulture.
Le film de Nemes a choqué et été au coeur d’une polémique au moment de sa diffusion au Festival de Cannes en raison de son parti pris radical. Nous plonger au coeur même du processus de mort en ne quittant pas d’une semelle le personnage principal peut être taxé de voyeurisme, le réalisateur (qui a perdu une grande partie de sa famille dans les camps) l’a justifié en expliquant dans Télérama : « On a voulu aller contre la mythification de la Shoah. (…) Les jolis plans ou une lumière sophistiquée étaient à bannir. On voulait éviter toute iconographie, ne surtout pas composer de tableaux. » C’est ce réalisme brut et sans fioriture qui fait de ce film un témoignage sur la Shoah glaçant mais à la puissance rarement égalée.
La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer (2024)
Le commandant d’Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d’une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Une petite vie paisible qu’ils s’efforcent de maintenir au quotidien à deux pas de l’horreur.
Grand Prix du Jury à Cannes en 2023, le film de Jonathan Glazer est aussi glaçant qu’esthétique. Rien n’est jamais montré, l’évocation de la Shoah est principalement faite à travers le son ambiant du camp perçu en toile de fond en permanence et la réalité d’Auschwitz-Birkenau que le spectateur connaît mais qui n’est jamais explicite. Glazer installe un climat pesant où le mal absolu est incarné par une banalité sidérante et un hors-champ assourdissant. On pourra trouver la mise en scène parfois douteuse et taxer Glazer de fautes de goût, son dispositif (parfois bancal) a en tout cas le mérite d’innover en matière de traitement artistique du thème de la Shoah.