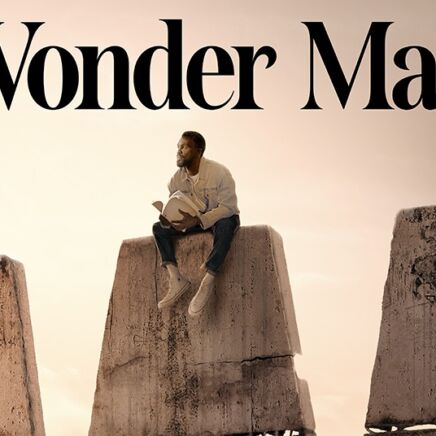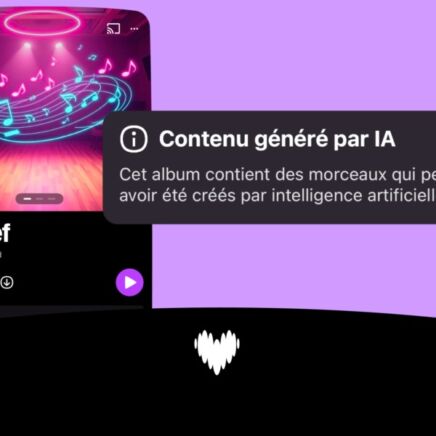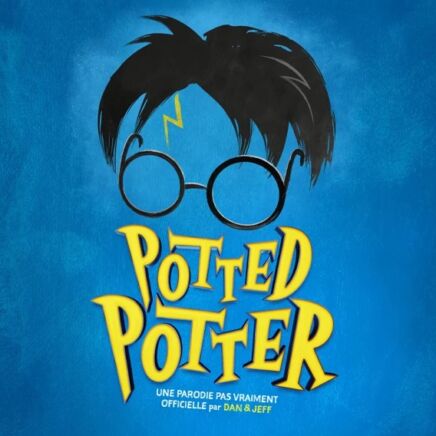L’année 2026 commence sur les chapeaux de roue pour Florence Dupré la Tour, avec deux nouvelles bandes dessinées publiées simultanément : Jeune et fauchée et Les moribonds. Deux albums qui dissèquent habilement la question de la lutte des classes. Rencontre.
Comment sont nés ces deux albums, dont l’un est un récit autobiographique et l’autre une fable politique ?
J’ai commencé par Jeune et fauchée il y a un an et demi. Les aléas éditoriaux ont voulu que le livre soit publié seulement maintenant. Entre-temps, comme je n’allais pas rester les bras ballants sans rien faire, j’ai écrit Les moribonds. Ce deuxième album est à la fois très différent de Jeune et fauchée dans la forme et très proche dans le fond. Il fallait continuer à creuser…

Dans Jeune et fauchée, vous disséquez la question de l’argent et surtout du silence qui l’entoure. Pourquoi ce tabou s’immisce-t-il autant dans notre intimité ?
Il y a une expression qui dit que l’argent n’a pas d’odeur. Je la trouve absolument fausse. L’argent est marqué symboliquement d’affects, notamment d’amour ou de désamour. On n’engage pas son argent dans n’importe quelle cause ; lorsque l’on propose son aide à un ami ou à un parent, ce n’est pas neutre non plus. C’est une manière de prendre soin. Cela peut aussi être symbole de désamour lorsqu’il n’y a pas cette notion de bienveillance. En France, il y a un tabou culturel qui vient d’assez loin et qui infuse aujourd’hui tous les milieux sociaux et culturels. Il y a aussi tout un narratif du pauvre qui est montré comme quelqu’un qui profite. Or, toutes les personnes précaires que j’ai rencontrées étaient de très grands travailleurs, des gens qui voulaient s’en sortir. Les non-dits autour de l’argent sont aussi très présents dans le cercle familial. Dans Jeune et fauchée, je raconte que, chez mes parents, nous n’en parlions pas, mis à part dans un rapport au manque, avec mes parents qui me répétaient qu’il fallait faire attention. Ça se limitait à ça.
Le tabou de l’argent est également présent dans le milieu littéraire. Dans ce récit, vous levez le voile sur vos débuts en tant qu’autrice de bande dessinée, les inégalités salariales et le sentiment de décalage avec certains confrères. Avec cet album, votre ambition est-elle de revendiquer une meilleure reconnaissance des artistes-auteurs ?
Absolument. J’ai même envie d’ajouter que la réalité des artistes femmes est souvent plus dure que celle des artistes hommes. Dans mon métier, j’ai pu constater que les femmes étaient moins payées que leurs confrères, et ce, même à ventes égales. Il y a aussi la configuration des autrices qui élèvent seules leurs enfants, qui s’ajoute à la situation extrêmement précaire du métier d’artiste-auteur. C’est un cumul.
Votre désir de faire de la bande dessinée a-t-il déjà été remis en question en raison de la précarité de cette profession ?
Avant de pouvoir vivre de la bande dessinée, j’ai fait beaucoup de “petits” boulots, j’en raconte une partie dans Jeune et Fauchée. Mais, pour moi, c’était des voies qui manquaient de sens. L’expression artistique, notamment par la bande dessinée, était tellement importante pour moi. J’avais une sorte de feu qui me consumait et je ne pouvais pas y échapper. J’ai persévéré dans cette voie extrêmement complexe financièrement, dangereuse même, envers et contre tout.
Avoir ou non de l’argent pose la question de la domination. Comment Jeune et fauchée et Les moribonds se répondent-ils sur ce sujet ?
Ces albums sont deux récits de chute de classe sociale. Dans Les moribonds, il y a ce personnage de vampire, Le Seigneur, qui représente le bourgeois, un dominant. Dans un monde postapocalyptique, il va se retrouver dans une situation catastrophique : il n’a presque plus rien à manger et doit alors prendre soin des quelques humains vivants restants. Pour cela, il va se confronter pour la première fois au travail. Mais plus il va travailler, plus il va perdre de sa valeur symbolique. Résultat : les humains se rebellent et font grève. Tel est pris qui croyait prendre… Ce qui me faisait beaucoup rire était de montrer un puissant – comme ce vampire, ainsi que moi-même, puisque je suis issue d’une famille bourgeoise – dégringoler et se casser la figure. Je trouve que, d’un point de vue narratif, c’est un bonheur. Il y a des ressorts dramatiques et comiques très forts dans cette chute.
Les moribonds est une fiction. En quoi le champ d’expérimentation du registre de la fable tragi-comique, peuplée de vampires et de morts-vivants, est-il différent de celui de l’autobiographie ?
Je n’aborde pas du tout ce travail de la même façon. L’autobiographie est plus frontale. Je la travaille souvent de manière tragicomique à partir du souvenir des sensations que j’ai pu avoir à l’époque. Par exemple, je me rappelle avoir été très jalouse ou avoir eu le sentiment d’être totalement abandonnée. Ce sont ces émotions très fortes qui guident la narration. Mes personnages sont à la fois proches du réel et éloignés par le dessin, avec un discours qui se veut engagé, sans forcément être politique. Avec la fiction, ce qui est fabuleux, c’est que l’on peut partir dans toutes les directions.