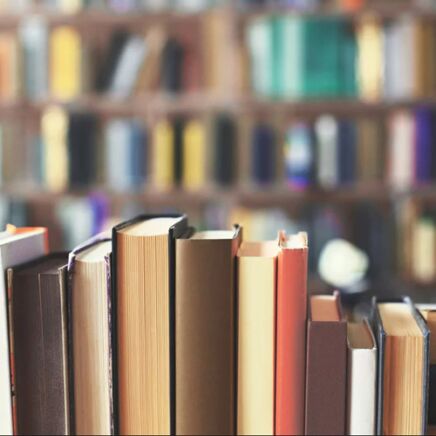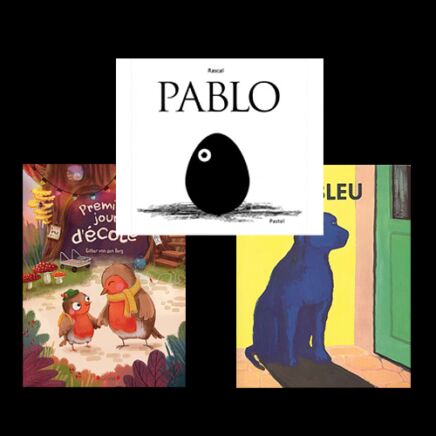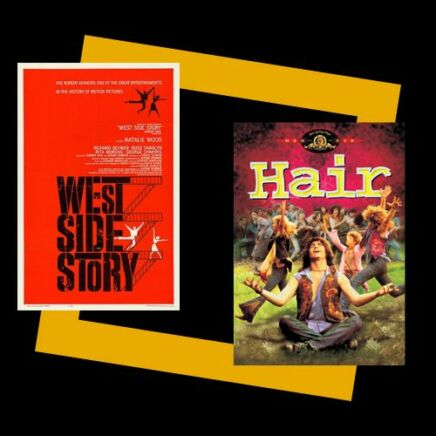Après La Forme de l’Eau (Oscar du meilleur film en 2017), le réalisateur mexicain revient avec un film noir dénué de créatures fantastiques, tourmenté et radicalement pessimiste sur la nature humaine. Nightmare Alley déroule une mécanique assez prévisible, malgré l’acuité visuelle indéniable de son réalisateur.
En mettant un instant de côté la crise sanitaire et l’attrait du public vers un blockbuster comme Spider-Man : No Way Home, il serait tentant de voir dans les résultats catastrophiques de Nightmare Alley au box-office nord-américain (un peu moins de dix millions de dollars de recettes pour un film ayant coûté 60 millions de dollars, hors promotion) une forme de déni, de refoulement de la dimension résolument satirique et pessimiste de cette adaptation du roman de William Lindsay Gresham, paru en 1946, dans sa façon de démonter cruellement le mythe du rêve américain et son idéal du self-made man.
Le public américain serait alors à l’image d’un personnage principal interprété par Bradley Cooper, recouvrant systématiquement d’un voile sa propre vérité. Nightmare Alley, une première fois porté à l’écran en 1947 par Edmund Goulding, suit le personnage énigmatique et peu bavard de Stanton Carlisle qui, découvrant un peu par hasard les dessous d’une fête foraine itinérante, parvient finalement à s’intégrer à la troupe pour gagner quelques sous. Intrigué par la troupe qui l’entoure, Stanton est peu à peu attiré par les dessous du mentalisme, dont il s’enquiert auprès de la voyante Zeena (Toni Colette) et de son mari alcoolique (David Strathairn), qui enseignera à Stanton les ficelles du métier. Guidé par le seul appât du gain, Stanton rêve alors à une grande machinerie qui le tirera hors des bas-fonds de l’Amérique rurale d’avant-guerre pour l’emmener vers les plus hautes sphères de la bourgeoisie new-yorkaise, où il mettra au point une escroquerie d’envergure avec l’aide de la psychiatre Lilith Ritter (Cate Blanchett).
L’Antre de la folie
Scindé en deux parties, le film de Guillermo Del Toro articule, dans son premier mouvement, les dessous de ce carnaval itinérant où se côtoient prestidigitateurs, géants, nains, femme-araignée et monstres de foire. Or le réalisateur du Labyrinthe de Pan (2006) et de La Forme de l’eau (2016) excelle lorsqu’il s’agit de mettre ce monde ambulant sur pied : logé dans le point de vue de Stanton, la caméra mobile de Del Toro se faufile dans les attractions recréées grandeur nature et dévoile les rouages bien huilés de ce freak show. La première partie du film, hommage assez évident à Freaks (1932) de Tod Browning – et pourquoi pas aux Moissons du ciel (1978) de Terrence Malick à l’image de l’un des premiers plans du film – concentre ainsi cette fascination quasi entomologique du cinéaste pour les personnages « monstrueux » qui prennent cette fois-ci forme humaine.
Toutes les scènes se déroulant au sein de la foire dans la première partie du film attestent ainsi du soin de Del Toro accordé aux textures, aux matériaux, aux teintes délavées, aux atmosphères, à l’air qui s’engouffre dans la tente du chapiteau ou à la pluie qui s’infiltre dans les attractions rouillées. Au fond, Del Toro filme cette foire comme un seul et même corps, les mécanismes ne faisant plus qu’un avec l’homme, l’humain ne faisant plus qu’un avec l’inhumain ou avec l’animal ; un tissu d’êtres moralement hétérogènes – voire sans aucune morale – avec ses propres lois, sa hiérarchie, son esthétique. Cet effort confère au film une dimension artisanale et plastique, d’autant plus rare pour une production de cette ampleur, qui atteste du plaisir que Guillermo Del Toro prend à orchestrer cette mise en scène symphonique.
Del Toro, the greatest showman
Visuellement, le réalisateur mexicain déploie allègrement cette caméra dynamique rampant à même le sol, flottant dans l’éther comme une âme en perdition. Le spectre n’est plus face caméra, comme dans Crimson Peak (2015), mais devient plutôt la caméra elle-même. Del Toro, qui refait ici équipe le directeur de la photographie danois Dan Lausten après Mimic (1997), Crimson Peak et La Forme de l’Eau – Lausten est également le chef-opérateur des derniers opus de la saga John Wick – promène sa caméra dans les moindres recoins du cadre, notamment grâce à la technocrane, une grue télescopique dont le cinéaste se dit particulièrement friand, enchaînant les valeurs de plans dans un seul et même mouvement.
Un dispositif loin d’être aléatoire et qui demande notamment une coordination rigoureuse entre les déplacements de la caméra et l’agencement des lumières. Nightmare Alley entasse progressivement ses personnages dans le cadre : filmées généralement en grand angle, les figures humaines revêtent alors cet aspect monstrueux, déformées par les courtes focales, et semblent littéralement écrasées lorsque l’action se déporte dans des espaces plus restreints, comme dans la maison de la voyante Zeena, incarnée par Toni Colette (Hérédité), où Stanton est accueilli chaleureusement. La culpabilité qui ronge tous ces personnages abîmés par le temps semble alors gonflée par cette manière qu’a Del Toro d’emmener ses personnages dans des espaces de plus en plus exigus et de resserrer le cadre sur leurs traits déformés. Le passé mystérieux de Stanton Carlisle, dont on devine assez rapidement la teneur morbide, déteint alors à l’écran, comme si son crâne, plaqué au plafond, allait soudainement imploser et laisser sortir la vérité.
Double sens à double tranchant
Nightmare Alley est assez étonnant de réflexivité ; peut-être même sans s’en rendre tout à fait compte, puisque le film n’en tire pas toujours parti. L’attraction principale de cette fête foraine est un « geek », figure apparue dans les fêtes foraines américaines à la fin du XIXe siècle. En cette période de Grande Dépression, le geek renvoie à ces individus désoeuvrés errant dans les bas-fonds des villes, le plus souvent toxicomanes ou alcooliques, attirés par des forains leur promettant une dose régulière de leur poison en échange d’une performance inhumaine, par ailleurs illégale : en l’occurrence, dévorer un animal vivant, devant un public à la fois horrifié et en transe. Le comble de l’ironie pour un réalisateur qui incarne à lui seul tout un pan de la culture « geek » contemporaine, avec des films comme Blade II (2002), Hellboy (2004) ou Pacific Rim (2013). En filigrane, Del Toro s’amuse peut-être à transposer la critique acerbe de Gresham d’une certaine forme de capitalisme à l’avidité des studios hollywoodiens qui, d’une certaine manière, maîtrisent eux aussi l’art du discours pour attirer les spectateurs dans leurs filets, moyennant une bonne dose de nostalgie et de « fan-service », cela va sans dire.
Au-delà de ce sous-texte croustillant, les scènes les plus décisives du film tournent toutes autour de cette figure du geek, tel un mauvais présage que Stanton refuse de voir. On gardera notamment en mémoire cette scène où le cynique personnage de Clem (Willem Dafoe) dévoile fièrement à Stanton sa parade pour attirer un nouveau geek dans son chapiteau, tout en avalant son repas chaud avec un grand sourire. Toute la trajectoire de Stanton, qui dans la seconde partie du film part à la conquête de l’élite new-yorkaise grâce à une escroquerie finement menée, sera hantée par cette altérité du geek toujours à même de devenir son propre destin. Au final, chacun cherche finalement à enterrer sa culpabilité dans le fond de son inconscient, aussi bien le charlatan qu’est devenu Carlisle, dont le charisme et l’habileté lui permettent de déverrouiller les barrières psychiques de ses « patients », que le riche homme d’affaires (Richard Jenkins) qui l’engagera pour des séances de spiritisme.
Cela étant dit, le film perd assez rapidement de son panache et souffre d’une deuxième partie bien plus convenue. La rencontre de Stanton avec la redoutable Lilith Ritter, incarnée avec allure – mais sans nuance – par Cate Blanchett, gonfle inutilement un récit laborieux, certainement trop soucieux de développer une intrigue obligée par le genre dans lequel s’ancre Nightmare Alley, prenant ici la forme d’un vaste cambriolage psychologique orchestré avec la complicité de Ritter. Mais jamais la relation entre Ritter et Stanton ne devient réellement engageante : sur fond de séances sur le divan débitant une psychanalyse de comptoir, les deux complices se renvoient incessamment la balle et incarnent chacun le reflet de la monstruosité de l’autre. Le personnage de Cate Blanchett restera enfermé dans ce moule de la femme fatale et manipulatrice tandis que Molly (Rooney Mara) n’existe dans le scénario que pour mieux souligner l’orgueil et l’égocentrisme de son partenaire (dans la vie et sur scène). La virtuosité et l’esthétique de Del Toro semblent alors totalement éteintes, du moins en retrait, dans un deuxième acte laborieux – sans doute un mauvais rêve – dont le seul but est d’amorcer un dernier acte sanguinolent et fatidique où le cinéaste retrouve enfin sa palette.
Nightmare Alley de Guillermo Del Toro – avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Colette, Ron Perlman, Richard Jenkins – 2h31 – En salles le 19 janvier 2022