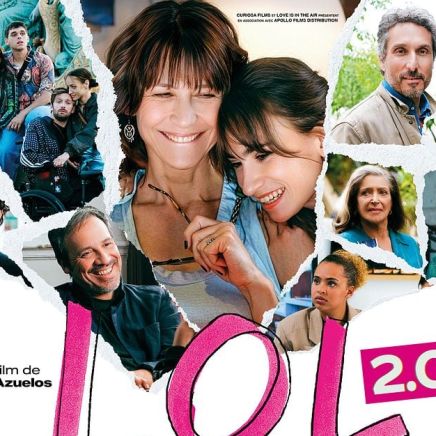À l’occasion de la sortie du film Barbie, ce mercredi 19 juillet, L’Éclaireur revient sur le cinéma de Greta Gerwig, symbole du mumblecore, ainsi que son héritage dans le long-métrage porté par Margot Robbie et Ryan Gosling.
Barbie est définitivement blonde… x2. D’un côté, on retrouve une première blonde à la plastique parfaite et à l’incarnation remarquable. Margot Robbie habite à merveille l’enveloppe de Barbie. De l’autre, une seconde blonde, qui après de nombreuses péripéties dans sa carrière, voit désormais converger vers elle toutes les attentions. Greta Gerwig est la génie derrière cette adaptation fidèle, originale et rosée de la célèbre poupée Mattel sur grand écran.
Tout en paradoxes, mélancolique et délirante, charmante et loin des clichés de beauté, elle a fait ses premières armes dans un courant méconnu en Europe : le mumblecore. Un style, une esthétique et des thématiques qui habillent encore, ça et là, le cinéma de Greta… et d’Hollywood.
Greta Gerwig : figure de proue du mumblecore
Agile avec les outils cinématographiques, un goût pour la technique qu’elle tient de son père informaticien. Habile avec les acteurs qu’elle dirige à la perfection, un rapport aux autres qu’elle tient de sa mère infirmière. Greta Gerwig, née à Sacramento comme son héroïne dans Lady Bird (2017), n’est pas une enfant de la balle. Elle a malgré tout su faire de son héritage sa force pour initier sa trajectoire de transfuge.
C’est à la suite d’une rencontre avec un professeur, lors de ses études d’anglais et de philosophie au Barnard College, qu’elle se met à écrire avant de réaliser. De quoi faire sienne le concept de « caméra-stylo ». Véritable touche-à-tout, elle aime aussi la scène qu’elle pratique via l’improvisation. Bref, le mumblecore n’est déjà pas loin. Mais c’est à New York que tout se concrétise.
À l’époque où les lunettes grillagées de Kanye West sont à la mode, que la tecktonik fait des ravages et que l’on regarde la trilogie du samedi soir à la télé, Greta Gerwig prend son envol. Elle se fait une place de choix dans un petit mouvement qui électrise alors le cinéma indépendant américain : le mumbledore. Selon la légende, le courant est né en 2005 à la suite d’une interview pendant le festival South by Southwest lors de laquelle le mixeur sonore du film Mutual Appreciation (Andrew Bujalski, 2005), Eric Masunaga, a qualifié les dialogues naturalistes du film de « mumble » ou marmonnements.

Depuis, la paternité d’une telle nouvelle vague est attribuée au même Andrew Bujalski, mais pour son film Funny Ha Ha (2002) qui fait la part belle aux acteurs amateurs incarnant des personnages âgés de 20 à 30 ans, dont les relations sentimentales sont évoquées crûment dans un contexte post 11 septembre, au réalisme, à l’improvisation et au low-budget. Impossible de ne pas retrouver non plus dans ces productions, largement inspirées de la vie personnelle de leurs auteurs, la philosophie d’Eric Rohmer, l’énergie de Richard Linklater, la familiarité d’un Judd Apatow, ou bien la sensibilité de John Cassavetes.
Des influences plus ou moins affirmées par les auteurs eux-mêmes, qui par contre rejettent en masse l’étiquette de mumblecore. Malgré eux, comme le précise Théo Ribeton dans son ouvrage consacré au mouvement, des liens existent à la fois entre les acteurs de ce courant, qui passent d’un film à l’autre, formant une véritable troupe théâtrale. Tout autant que dans les caractéristiques des films qui font de la figure du « slacker » de Linklater, et sa « nonchalance sans ambition », un véritable leitmotiv.
Parmi les visages de cet univers cinématographique rutilant et novateur, on retrouve ceux de Joe Swanberg (Nights and Weekends qu’il co-écrit avec Gerwig en 2008), Andrew Bujalski, les frères Mark et Jay Duplass (Baghead, 2008), les frères Safdie (The Pleasure of Being Robbed, 2008), de Lynn Shelton (Humpday, 2009), ou encore de Lena Dunham (Tiny Furniture, 2010).
Mais celle qui devient rapidement la muse de ce courant n’est autre que Greta Gerwig qui s’invente un personnage type : une femme maladroite, en décalage, que l’on suit dans les méandres de la vie en perte de sens des millénials, emplie de relations barbantes et de bore-out. En plus de ces dialogues marmonnés du bout des lèvres, Greta Gerwig fait de son corps étrange une source d’expression. Regards furtifs lourds de sens, expressions faciales, langage corporel et non-dits se font les mots d’une génération perdue.
De Baghead (2008) à Frances Ha (2012), en passant par Hannah Takes the stairs (2007), Nights and Weekends (2008), The House of the Devil (2009), et Damsels in Distress (2011), tous ces rôles permettent à Greta de construire sa vision du cinéma en tant qu’actrice, scénariste et plus tard réalisatrice. C’est surtout au sein de sa relation avec Noah Baumbach, son compagnon avec lequel elle travaille sur Greenberg (2010) en tant qu’actrice aux côtés de Ben Stiller, et Frances Ha (2012) devant la caméra et à l’écriture, qu’elle assoit sa vision : elle aime brosser des portraits décalés de femmes légèrement narcissiques, en quête de leur identité, et de leur féminité.
Cette thématique, ces carcans de personnages et de questionnements, se retrouvent plus tard dans les films de Greta Gerwig. Lady Bird (2017), inspiré de la vie de la réalisatrice, Les Filles du Docteur March (2019) et maintenant Barbie. La nouvelle coqueluche du cinéma indépendant entre alors dans un nouveau monde… celui du blockbuster.
Barbie : du mumblecore au blockbuster
Détaillant l’univers de Mattel à la perfection, mêlant ironie et hommage passionné à la poupée, Greta Gerwig a su rejoindre un club bien particulier avec Barbie : celui des réalisatrices ayant tourné des films avec un budget d’au moins 100 millions de dollars, qui comptait jusqu’alors les visages de Ava DuVernay, Patty Jenkins et Kathryn Bigelow.
Mais cette profusion de dollars, qui de fait standardise en partie ce que l’on peut attendre d’un blockbuster à visée mainstream notamment car les producteurs sont à l’affût, n’a pas empêché Greta Gerwig de marquer à jamais Barbie de son empreinte et de ses origines cinématographiques.
Humour, références, rythme. Tout y est, à commencer par la prégnance de l’âme du cinéma mumblecore : les marmonnements existenciels des personnages là encore dans la fleur de l’âge (la vieillesse n’existe pas dans le monde de Barbie). Barbie(s) et Ken(s) (et Allan bien sûr) se questionnent sur la vie, sur leur place dans ce monde bien huilé rose bonbon et blond. Si les dialogues ne sont plus improvisés, mais parfaitement et subtilement écrits par le duo Gerwig-Baumbach, les difficultés à communiquer au sein d’un couple sont largement traitées. On évoque les inconvenances pour la jeune Sasha et sa mère, bien humaines elles, d’évoluer dans une société patriarcale à souhait où même le conseil d’administration de Mattel est uniquement composé d’hommes. Et tous ces personnages, en plein récit d’apprentissage, sont soumis à des angoisses sur la vie (et la mort), centrales dans le mumblecore.
À y regarder d’encore plus près, on retrouve aussi dans le cinéma de Gerwig une obsession pour la féminité et la domesticité qu’on lui attribue. Cette réflexion initiée dès Lady Bird et Les Filles du Docteur March est omniprésente dans Barbie. Gerwig insuffle à cette production gros budget toute son âme, évoquant avec bienveillance et satire les difficultés d’être une femme aujourd’hui. Sans oublier les excès de la masculinité qui tendent à être toxiques pour plus d’un personnage, les hommes y compris. Les clichés sont ici mis en valeur et démontés un à un, avec intelligence et rires aux éclats.

En découle une ambiance à la fois lumineuse et sombre, une forme de clair-obscur d’une profondeur certaine, qui rappelle l’influence qu’a eue sur Gerwig le livre Reviving Ophelia (1994), de la psychologue clinicienne Mary Pipher. Un ouvrage qui traite des pressions sociétales, notamment psychologiques, auxquelles sont soumises les adolescentes (dans Barbie, tous les personnages sont de grands enfants) dans notre monde moderne. Un monde sur lequel Greta Gerwig a un impact ?
L’héritage de la génération Gerwig : un changement de paradigme de la production hollywoodienne ?
Il n’y a pas que Barbie qui témoigne de l’héritage que Greta Gerwig et le courant mumblecore ont laissé sur le cinéma hollywoodien. Les questions existentielles, la mise en scène de sa vie (les réseaux sociaux en sont les témoins) n’ont jamais autant été au cœur de notre manière de communiquer, et de se raconter. C’est encore plus flagrant avec la génération Z attachée aux questions psychologiques, identitaires, notamment sur tout ce qui touche à l’affirmation d’une féminité forte et à la fluidité des genres. De quoi faciliter la réception de ces films ?
En tout cas, le mumblecore a un héritage flagrant. D’abord du fait de l’émergence d’une grande majorité des cinéastes qui formaient ce « core » qui « mumble ». Ainsi Barry Jenkins (Moonlight, 2016), les frères Safdie (Good Times, 2017 ; Uncut Gems, 2019), les frères Duplass (Cyrus, 2010), Joe Swamberg avec la série Easy, ou encore Lena Dunham dont le chef-d’œuvre Girls n’est plus à présenter, ont tous réussi à se faire une place dans le cinéma plus grand public.
Mais aussi car le mumblecore s’est, comme le précise Théo Ribeton, « dilué dans le mainstream », mais pas sans laisser de traces. Ainsi, des films comme Barbie, mais aussi Sex Friends (2011) d’Ivan Reitman, Eight grade (2018) de Bo Burnham, ou 90’s (2018) de Jonah Hill ont clairement repris des thématiques et le naturalisme propres au courant Gerwigien. La tendance du stand-up qui privilégie la présentation de soi, les anecdotes biographiques, pour perdre le public entre rire et empathie, marque évidemment la montée de ces productions au style « vérité ».
Enfin, plusieurs séries comme l’œuvre d’Aziz Ansari, Master of None (2015-2022), mais aussi Girls (2012-2017), Broad City (2014-2019) et High Maintenance (2016-2020) ont remis au goût du jour ce courant cinématographique. Mais cet héritage va-t-il perdurer ? Si les coutures de Barbie étaient faites pour le style Greta Gerwig, son adaptation du Monde de Narnia pour Netflix confirmera-t-elle la tendance ? À suivre…