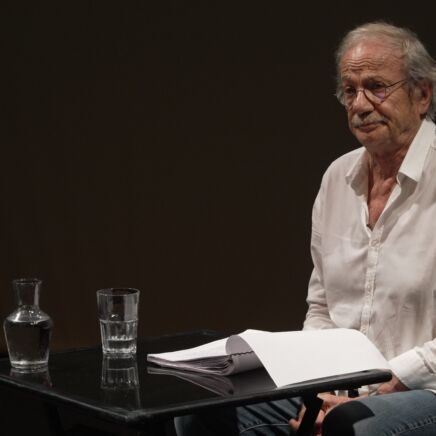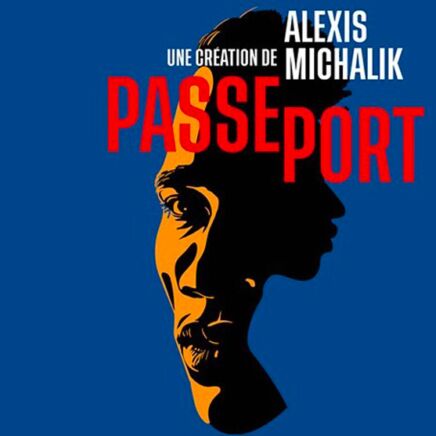Mettre en avant les nouveaux talents de la culture, c’est la mission que s’est donnée L’Éclaireur. Ce mois-ci, coup de projecteur sur François Mallet, jeune humoriste de 28 ans monté à Paris après avoir fait ses gammes sur la scène humoristique lyonnaise. Nous l’avons rencontré pour évoquer son parcours, ses nombreux projets et son spectacle débordant d’énergie à ne surtout pas manquer.
« Bipolaire, gay et patineur artistique » : c’est ainsi qu’est présenté Heureux soient les fêlés, seul en scène rutilant à découvrir jusqu’à fin mai dans l’écrin confidentiel de la Comédie des 3 Bornes, au cœur du 11e arrondissement de Paris. Une petite salle qui ne paie pas de mine, mais tout à fait adaptée à ce spectacle à la fois intimiste et drolatique, ne reculant pas devant les thématiques sensibles à aborder – la bipolarité donc, mais plus largement la santé mentale – et replaçant la performance et le corps de l’artiste au centre de l’attention.
François Mallet n’est à vrai dire pas du genre à se reposer sur ses lauriers. En parallèle de ce spectacle passé l’été dernier par le Off d’Avignon, l’humoriste a également dévoilé Insolents, une série d’autofiction en neuf épisodes sur le quotidien de jeunes humoristes essayant tant bien que mal de faire leur trou dans le petit monde de la comédie lyonnaise. François Mallet, qui continue de pratiquer le patinage artistique et qui publiera un premier roman chez Flammarion l’année prochaine, nous a reçus à la veille de son spectacle.
Qu’est-ce qui vous a amené à la scène ?
J’ai commencé le théâtre en 2017 à la sortie de mes études de journalisme à Sciences Po Lyon. J’avais fait quelques stages au Progrès, le journal local. Ça ne m’a pas déplu, mais je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je voulais faire. J’ai alors commencé à prendre des ateliers de comédie certains soirs au Nombril du monde [café-théâtre emblématique des pentes de la Croix-Rousse, où une certaine Florence Foresti a notamment fait ses premiers pas, ndlr]. On y jouait des sketches déjà écrits et ça m’a beaucoup plu.

J’ai fait ça pendant un an, avant de découvrir le concours d’humour Kandidator, soit cinq minutes de passage sans audition : si jamais ça marche bien à l’applaudimètre, tu peux franchir les étapes supérieures. Il fallait écrire un nouveau sketch tous les mois. Ce sont des choses qui ne sont plus du tout dans le spectacle aujourd’hui, mais ça m’a forcé à écrire des nouveautés assez régulièrement. Ça se jouait beaucoup au Boui-Boui, un café-théâtre très reconnu à Lyon que j’ai finalement intégré en 2019. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à jouer mon premier spectacle professionnel et rémunéré.
Vous souvenez-vous de votre toute première scène ?
Je considère que le patinage était déjà une forme de scène. Se retrouver à huit ans sur une piste de 1 800 m2 devant cinq ou six juges, avec du public dans les tribunes, on peut dire que c’est une première approche ! Une année, au collège, j’avais trouvé un copain avec qui on faisait les 400 coups et, pour nous canaliser, la professeure de français nous avait mis sur la pièce d’une autre classe. J’avais trouvé ça marrant d’amuser la galerie. Ensuite, il n’y a plus eu de théâtre jusqu’au Nombril du monde. On répétait les sketchs pendant six ou sept semaines avant de les jouer en public. Lors des premières représentations, j’ai senti que quelque chose me portait. Même en phase de doute ou de gros changements, le fait de ressentir des émotions a toujours été plus fort que le stress qui peut aller avec.
« Ce qui me fait rire dans l’humour, ce sont les situations. Je préfère parfois essayer de les vivre que de les raconter. »
François Mallet
Les quelques fois où j’ai eu la chance de faire des premières parties (comme celle de Marina Rollman l’année dernière), le stress est démultiplié parce que si tu te plantes, c’est un bide total. En même temps, l’énergie que tu ressens est énorme. C’est dans les grandes salles que j’ai eu l’impression de livrer mes meilleures performances. Il faut être prêt, bien sûr, mais il n’y a rien de comparable et j’ai hâte de continuer le boulot pour aller progressivement vers de plus grandes salles.
Qu’est-ce qui a changé par rapport à la première version du spectacle ?
Il a changé de nom, mais j’ai du mal à dire que c’est véritablement un deuxième spectacle. Je le vois plutôt comme un prolongement sans cesse en évolution. Avant la pandémie, ça parlait beaucoup de sensibilité et d’hypersensibilité. Au retour du premier confinement, j’avais vraiment envie d’aller au fond du sujet. Ça s’appelait toujours Follement sensible, mais ça abordait, cette fois frontalement, la question de la santé mentale et de la bipolarité – au milieu d’autres choses : l’amour de soi, l’homosexualité, etc. Je ne parlais pas encore énormément de mon enfance, c’est venu progressivement. Le spectacle a finalement changé de nom pour le Off d’Avignon.
Pourquoi ce choix ?
Pour plusieurs raisons. Je me suis posé la question d’entrée de jeu à vrai dire. Follement sensible se rapprochait selon moi du côté du “fou fou” dans le sens positif du terme, mais beaucoup de personnes, y compris des professionnels, se sont demandés si ça n’allait pas induire les gens en erreur sur le côté gay et connoté “folle”. J’ai pris le temps d’y réfléchir et je me suis dit que je voulais garder ce brin de folie. Puis, j’ai pensé aux fêlures. Il y avait là quelque chose d’intéressant ; mais avec seulement Les Fêlures, on aurait perdu du monde ! Je me suis alors souvenu de cette citation de Michel Audiard qui gardait ce côté positif et sonnait très bien.
Comment le spectacle a-t-il évolué depuis ?
J’ai commencé à travailler avec mon nouveau metteur en scène – Nicolas Vital – au printemps dernier. Avant cela, il y a eu toute une période où j’avais décidé de travailler seul, car c’était important pour moi de changer beaucoup de choses dans l’écriture, notamment sur cette question très personnelle de la santé mentale. Mais, pour franchir le palier supérieur, j’avais à nouveau besoin de travailler avec quelqu’un. Je ne fais pas du stand-up pur, mais je ne fais pas que du personnage non plus. Je suis allé voir des spectacles qui me parlaient, mêlant plusieurs univers.
J’ai notamment vu Amour de Bérangère Krief. Il y a de l’adresse au public, du personnage – en l’occurrence, elle fait du cerceau aérien, moi c’est le patinage. Je suis également allé voir le super spectacle de Laura Felpin (Ça passe) et le nom de Nicolas Vital, qui travaille aussi avec Bérangère Krief, est ressorti. On a commencé à bosser ensemble en tentant de s’éloigner le plus possible des codes du café-théâtre pour aller vers plus de finesse, aussi bien sur l’écriture que dans le jeu. Depuis que je joue aux 3 Bornes, on reste sur cette dynamique et c’est un sacré challenge.
Aborder la santé mentale dans un spectacle d’humour n’est pas une mince affaire…
On commence de plus en plus à entendre parler de ces sujets dans les médias et sur scène. C’est devenu un sujet un peu à la mode, j’en suis conscient. Mais je suis très content de pouvoir en parler, ça libère une certaine parole. Au sortir du premier confinement, c’était un sacré pari d’aller au fond de ce sujet qui peut être sombre. Mais j’aime l’idée d’arriver à faire rire et réfléchir avec ça, en tout cas semer une petite graine. Il y a de plus en plus de gens curieux et c’est un peu faux de dire qu’ils ne s’attendent qu’à de la vanne pour de la vanne. Si tu présentes quelque chose de sincère et d’intéressant, tu peux toucher des gens de tous âges.
Comment trouver le bon dosage entre humour et sensibilité ?
C’est une question qui est toujours au cœur de ma réflexion dans les phases de réécriture. Ce partage constitue l’identité même du spectacle. Certains jours, je peux être plus inspiré par quelque chose de plus “sensible” et m’y laisser aller, quand d’autres je suis plus d’humeur à rire… La manière dont je vis la bipolarité et dont j’ai suivi des hospitalisations m’est propre et tout le monde n’a pas forcément vécu la même chose. Si j’en ris et que je passe par l’autodérision, c’est que je trouve qu’il y a beaucoup de beauté et d’espoir là-dedans.
À lire aussi
J’essaie de faire passer quelque chose que j’ai vécu personnellement et si ça peut toucher les autres, tant mieux. Je ne me voyais pas faire de généralités. Il faut essayer de faire du beau avec ce que beaucoup considèrent comme moche. C’est parce que j’arrive à raconter ça avec une distance que je peux m’autoriser ces passages où j’en parle sérieusement, raconter qu’il y a des moments plus durs que d’autres et qu’être bipolaire ce n’est pas facile au quotidien. C’est avec cet équilibre qu’on évite de tomber dans le pathos, j’y fais vraiment attention.
Par ailleurs, vous parlez aussi de votre enfance à la campagne, de votre milieu social.
Ce côté autobiographique était présent dès la première version du spectacle, j’y parlais déjà pas mal de ma famille. Très récemment, on a fait le choix d’aller beaucoup plus loin dans la présentation de mes origines, du fait que je viens d’un milieu campagnard, avec un père agriculteur, dans lequel la sensibilité n’était pas forcément une préoccupation du quotidien. Or, je me suis découvert assez rapidement comme étant un enfant sensible et créatif. Aujourd’hui, c’est une force pour le spectacle que d’avoir été cet enfant sensible et danseur sur glace qui grandit à la campagne et se découvre plus tard homosexuel et bipolaire. Plus j’avance dans mon quotidien, plus je le considère comme une chance. En ce moment, ça m’inspire beaucoup.

Que dire des parties dansées du spectacle, qui sont assez inattendues ?
C’était un pari d’avoir des chorégraphies de patinage qui ne soient pas juste une transition, mais un tableau à part entière. En même temps, ça m’est apparu comme une évidence ; c’est quelque chose que je faisais beaucoup quand je patinais, je m’entraînais beaucoup chez moi à répéter mes chorégraphies. Je me suis dit que ça serait beau et peut-être différent. Il y a quand même peu de one-man-shows avec une partie de gymnastique, de danse, en tout cas quelque chose de visuel. Lors de la création du spectacle, c’était presque le premier moment de sensibilité. Les gens pouvaient à la fois entrer dans mon univers et faire une pause, parce que je parle beaucoup – et très vite ! Je me suis dit que si ça marchait, je pourrais l’insérer à d’autres endroits. C’est un moment sur lequel je prends toujours autant de plaisir et qui demande un bon entraînement physique.
Continuez-vous le patinage de compétition ?
J’ai fait de la compétition de mes 8 à 18 ans, puis j’ai arrêté pour mes études. Il fallait faire un choix. Mais j’ai repris l’entraînement pour les Gay Games de Paris en 2018 [la 10e édition des Gay Games, Jeux mondiaux de la diversité, ndlr], au lieu de trouver un travail ! C’était assez intense. Depuis peu, j’ai repris un entraînement plus intensif, car je vais bientôt jouer mon spectacle sur glace dans un festival de théâtre sur glace à Auxerre (-5° C Scène) créé par un ancien patineur de haut niveau devenu comédien, Alexandre Riccitelli.
Une chorégraphie de patinage au milieu d’un spectacle humoristique était déjà un challenge en soi et au final le spectacle va aussi se faire sur glace. Même si la scène reste la priorité, c’est quelque chose qu’on a hâte de développer avec mon metteur en scène et mon chorégraphe. Ça reste ma première passion, ça m’habite tellement que je ne me voyais pas faire un spectacle sans ça. J’y reviens toujours d’une manière ou d’une autre.
Que pouvez-vous nous dire sur votre série, Insolents ?
C’est une série de fiction de neuf épisodes, librement inspirée de faits réels. Quand j’ai commencé le théâtre à Lyon, j’étais en colocation avec une autre humoriste qui s’est lancée à peu près au même moment que moi. J’ai commencé à l’écrire pendant le premier confinement, avant que Drôle ne sorte sur Netflix. À ce moment-là, il se passait beaucoup de choses dans nos vies de jeunes artistes : les débuts sur scène, la difficulté de se faire une place dans le milieu, etc. On a tourné le premier épisode entre les deux confinements. C’était un premier exercice de jeu face caméra, mais aussi dans l’écriture, le relationnel sur les tournages, etc. J’ai vraiment adoré ça. Je ne sais pas encore s’il y aura une deuxième saison. En tout cas, la série accompagne bien mon arrivée à Paris.
Pour conclure, qui sont les artistes qui vous ont le plus inspiré ?
J’aime vraiment les artistes qui ont un univers à part. J’étais assez fan du patineur suisse Stéphane Lambiel, je le trouvais justement très sensible dans son patinage. En humour, j’adore les humoristes de l’ancienne génération, Muriel Robin, Michelle Laroque et tant d’autres. J’aime bien les humoristes qui sont à la fois comédien·ne·s et acteur·rice·s : Valérie Lemercier, Alex Lutz, Audrey Lamy… Dans les sources d’inspiration sur scène, je pense par exemple à Vincent Dedienne ou Julie Ferrier, qui vont faire du seul·e en scène avec des personnages et quelque chose de sensible, c’est bien plus que du stand-up pur et dur. Ce qui me fait rire dans l’humour, ce sont les situations. Je préfère parfois essayer de les vivre que de les raconter.
Heureux soient les fêlés, de François Mallet, à la Comédie des 3 Bornes (Paris 11e) les mardis à 19h30, puis au Théâtre du Marais les samedis de juin à juillet 2023