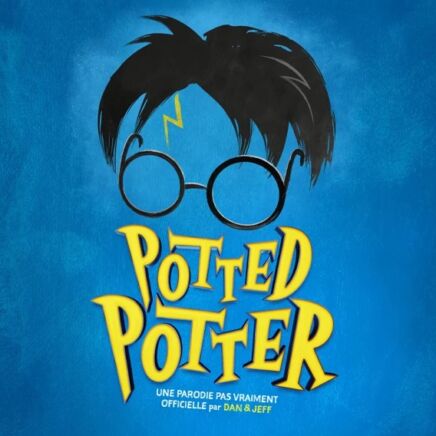Avec BisouBye, Paul Taylor signe son troisième spectacle, le dernier volet d’une trilogie imaginée il y a sept ans avec #Franglais. À l’occasion de ses représentations sur la scène de la Nouvelle Ève, à Paris, L’Éclaireur a rencontré l’humoriste pour parler de son dernier stand-up, de son univers et de sa carrière.
Cela fait plusieurs années que Paul Taylor écume les scènes de stand-up. Après avoir présenté #Franglais, So British ou presque, et après avoir explosé sur Internet grâce à ses vidéos, l’humoriste britannique basé en France présente depuis plusieurs semaines, à Paris, son nouveau spectacle BisouBye.
Dans ce seul en scène, l’artiste fait le bilan et explique qu’il est désormais prêt à dire au revoir à plusieurs choses. Fun, déjanté et tendre, ce one-man-show est à découvrir à la Nouvelle Ève jusqu’au 1er avril 2023. Après quoi, Paul Taylor se lancera dans une tournée hexagonale et internationale. Entre deux représentations, l’humoriste a trouvé le temps de répondre aux questions de L’Éclaireur.
Comment est née l’idée de Bisoubye ?
Le dernier spectacle s’est terminé en juin de l’année dernière, après avoir duré trois ans, alors qu’il était censé durer un an. Pour le troisième, j’avais vraiment envie de revenir à un spectacle qui dure un an pour une fois, comme on le fait dans le monde anglophone. Puis, en pensant à ce que je voulais raconter, je me rendais compte que ça allait peut-être être le dernier spectacle bilingue, parce que c’est le troisième, c’est la fin de la trilogie. D’où le nom de Bisoubye : c’est quelque chose que je dis tout le temps depuis que je suis arrivé en France. Du coup, comme c’est un titre bilingue, je trouvais ça drôle. Tout le reste du spectacle m’est venu une fois que j’avais le thème et le titre. Après, j’ai repensé aux différentes choses auxquelles j’ai dit au revoir. J’avais aussi des blagues qui dataient de plusieurs années que je n’avais pas pu utiliser, mais qui tombaient dans le thème.
Comment s’est déroulé le processus créatif sur ce spectacle ? Avez-vous procédé différemment par rapport aux précédents ?
Je dirais qu’il y a une différence entre le premier spectacle et les deux autres. Comme souvent quand on débute dans l’humour, on commence à faire des plateaux de 10 ou 15 minutes. Au bout du compte, le premier spectacle, c’était une combinaison de toutes les minutes que j’avais faites auparavant, dont certaines qui n’avaient rien à voir avec la France, parce que j’avais pu jouer aux États-Unis pendant que je travaillais chez Apple.

Les deux spectacles suivants, en revanche, j’ai travaillé avec la même méthode, c’est-à-dire que je rodais le spectacle pendant six mois, trois fois par semaine. C’était vraiment une heure en solo pendant lesquelles je testais des blagues. J’essayais de créer un lien entre chaque histoire afin de construire un récit cohérent. J’ai aussi fait quelques comedy clubs, ainsi qu’un gros rodage à La Scala pour tester BisouBye avec le public.
Roder plus en longueur le spectacle, c’est aussi prendre un risque, non ?
Vu comme ça, ça peut représenter un risque, car ça peut remettre en question tout le spectacle. Mais, grâce aux deux précédents, j’avais réussi à réunir une communauté fidèle. Comme je suis un peu écarté de la scène française, je suis un peu différent, j’ai mon propre délire. Il y a cette part de risque avec des gens qui ne me connaissent pas. Je me retrouve souvent à expliquer pourquoi je suis là et le délire avec le fait que je parle bien français. Depuis ces cinq dernières années, comme il y a énormément de gens qui se sont fait connaître soit par les réseaux sociaux, soit par un spectacle, et qu’il y a aussi plus de spectateurs aujourd’hui grâce aux comedy clubs, on ne me connaît pas obligatoirement.
« J’aimerais trouver un moyen de rendre l’anglais moins boring […] Ça donne une autre raison d’être sur scène, plutôt que de simplement raconter des blagues. »
Paul Taylor
BisouBye parle du fait de dire au revoir à certaines choses, donc. Est-ce qu’il y a tout de même des choses auxquelles vous n’êtes pas prêt de dire au revoir ?
Je dirais que c’est le fait d’essayer d’enseigner l’anglais à ma fille, mais aussi d’aider les Français cette langue. J’aimerais trouver un moyen de rendre l’anglais moins boring pour les Français, et la jeune génération de Français qui voit vraiment une valeur ajoutée à être bilingue. Sans presser les choses, évidemment, mais je reçois beaucoup de messages, des gens viennent me voir à la fin du spectacle pour me dire qu’ils aiment ce que je fais, que je les fais progresser avec mes vidéos, ou bien ils se rendent compte que leur niveau n’est pas si nul que ça quand ils me voient en spectacle. Ce genre de retours me fait très plaisir, donc je ne compte pas abandonner cet aspect. Ça donne une autre raison d’être sur scène, plutôt que de simplement raconter des blagues.
Est-ce que vous éprouvez une certaine nostalgie à vous dire que c’est le dernier spectacle bilingue ? Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’idée de dire au revoir à certaines choses ?
Actuellement, je ne ressens pas de mélancolie. On ne ressent pas la nostalgie dans le moment, c’est plus tard. Peut-être que dans dix ans je verrais ça avec nostalgie. Mais j’ai aussi atteint ce que je voulais faire en France, il y a longtemps – c’est ce que je raconte dans le spectacle. Pour moi, c’est la suite qui est plus excitante, de sauter dans l’inconnu. Peut-être faire des comedy clubs en Angleterre en anglais pour les Anglais, pour voir ce que ça donne, et explorer le monde anglophone que je n’ai pas encore vu. La chose qui est géniale et difficile en même temps en France, c’est qu’on peut tourner, on peut faire notre spectacle plusieurs fois par semaine, mais le problème c’est qu’on n’a pas beaucoup de temps à consacrer à d’autres projets. Du coup-là, si j’ai envie de passer du temps dans des pays anglophones, je suis obligé de m’arrêter en France.

Finalement, avec la comédie, on est très rarement dans le présent. On vit dans le passé et le futur. Les blagues, c’est dans le passé, parce qu’on les a. Ce sont généralement des choses qui se sont passées il y a longtemps et, comme on n’a pas envie de les jeter, on continue de les raconter comme si ça s’était passé l’autre jour. On vit aussi dans le futur : là, j’ai ma tournée qui arrive et qui est quasiment faite jusqu’à janvier de l’année prochaine. Je sais que ma vie est planifiée. Du coup, c’est ça qui m’empêche de penser au monde anglophone maintenant.
Dans cette exploration de l’humour anglophone, est-ce que vous comptez vous réinventer et explorer d’autres thématiques que les différences entre Français et Anglais ?
Avec le stand-up, on raconte la vie de notre point de vue. Moi, mon point de vue, ça sera toujours celui d’un Anglais qui habite en France. Il y aura toujours cette partie, mais mon pays a beaucoup changé aussi. Cette partie-là est intéressante à explorer. L’idée, c’est de montrer aux Anglais le point de vue extérieur du pays. Je n’ai pas encore commencé à écrire, mais c’est les premières idées qui rentrent.
Comment définiriez-vous votre univers humoristique ?
C’est compliqué de se définir, c’est plus les autres qui finissent par nous définir, mais, comme à la base je suis linguiste de formation, c’est vers là que je vais, et c’est ce que je trouve marrant, ces différences de langues et de cultures. Ça amène à un point de vue sur le monde que peut-être un Français lambda ou un Anglais lambda n’auraient pas. Après, dans mes spectacles, il y a des parties où je parle de mon couple franco-britannique, où je parle de paternité, des choses de tous les jours, mais de mon point de vue.
En France, on aime bien ranger les gens dans des cases, alors ma case ça serait : un Anglais qui se moque des Français. Et pourtant, comme je le disais, dans le premier spectacle, je parlais beaucoup des États-Unis. Comme le reste du spectacle il y avait cet angle de l’Anglais qui habite en France, c’est rapidement devenu le headline sous lequel il est devenu facile de m’identifier. C’est bien aussi, car il faut se définir dans ses œuvres artistiques sur scène.
« En France, on aime bien ranger les gens dans des cases, alors ma case ça serait : un Anglais qui se moque des Français. »
Paul Taylor
En parlant de l’expérience scénique, comment vous sentez-vous avant de monter sur scène ? Qu’est-ce qu’elle vous procure en tant qu’humoriste ?
Je crois que le jour où on a plus le stress avant de monter, c’est qu’il faut s’arrêter. C’est une phrase clichée [rires]. Ça dépend des moments… Parfois, tu entends le public parler derrière le rideau et tu sens que ça va bien se passer, mais il y a toujours le stress de la première blague. En fait, c’est un baromètre de l’ambiance du spectacle. Si ça rigole, c’est forcément moins stressant, et on prend du kiffe, mais ça arrive parfois que ça soit compliqué. Je pense aux grèves et à ce qu’il se passe à Paris, des fois on se retrouve avec une salle à moitié vide, donc c’est quitte ou double. J’ai autant lutté que j’ai eu de sacrées ambiances. Ce moment-là, avant le lever du rideau, c’est stressant. Quand on teste dans les comedy clubs, le stress est plus important, parce que tu es devant des gens qui ne te connaissent pas et tu ne sais pas si ça va être drôle ou pas.
Dans votre carrière, avez-vous des références qui vous ont inspiré ?
J’avoue que ça change tout le temps et ça dépend de la période. Quand j’ai commencé, la première personne qui m’a inspiré, c’est un comédien anglais qui s’appelle Lee Evans. Comme à l’époque, avant Internet et les réseaux sociaux, les DVD étaient la seule façon de consommer l’humour, c’était des spectacles assez longs qui me faisaient rêver. Lui, ça a été le premier à m’inspirer, il est très énergique sur scène, comme moi. Plus récemment, c’est du côté américain que je trouve des références, car avec Bisoubye j’ai voulu travailler le côté plus émotionnel et le storytelling. Du coup, il y a pas mal d’humoristes en Angleterre et aux États-Unis que j’aime bien, notamment Neal Brennan qui est sur Netflix. Je pense aussi à Hannah Gadsby, une Néo-Zélandaise qui a cartonné avec son spectacle dans lequel elle explique qu’elle en avait marre du métier. Son stand-up est puissant, elle passe des rires aux larmes.
Quel regard portez-vous sur la scène humoristique française aujourd’hui ?
Je trouve qu’on est dans l’enfance de cet art. En vrai, ça existe depuis moins de dix ans : quand j’ai commencé sur scène, il n’y avait pas de comedy club. Ça explose depuis quelques années, à Paris notamment, comme ce qui se fait à Londres. À l’origine, le stand-up a été fondé pour les classes sociales populaires qui travaillaient toute la semaine, qui ne pouvaient pas se payer le théâtre, et qui voulaient rire autour d’une bière. Cette ambiance-là commence à gagner Paris, avec les comedy clubs qui ont ouvert comme le Fridge, le Madame Sarfati, le Barbès et le Paname Art Café.
En France aujourd’hui, on est loin de l’envergure de Londres, mais l’avantage c’est qu’on peut jouer tous les soirs, et ce n’est pas si saturé que ça, ce qui est hyper cool. Ça commence aussi à pousser à Nantes, à Bordeaux, en dehors de Paris. Je crois que dans dix ans, il y aura au moins un comedy club par grande ville, donc c’est excitant et ça ne peut qu’aller dans la bonne direction. On le voit aussi sur l’évolution du spectacle vivant. Aujourd’hui, les villes laissent plus de place au stand-up, notamment grâce aux réseaux sociaux, car on peut montrer notre art tout le temps.
Justement, comment appréhendez-vous l’impact des réseaux sociaux par rapport à votre métier de stand-upper ?
C’est un peu comme notre deuxième travail. J’ai eu beaucoup de chance, car j’étais le premier de cette génération à avoir explosé sur Internet pendant que je faisais de la scène en même temps. J’avais sorti une vidéo, mais ça faisait déjà trois ans que je faisais du stand-up. Ça a bien fonctionné. Ce qui était différent avec mes vidéos, c’est que qu’elles ne montraient pas de stand-up, c’était par exemple la minisérie sur Canal+, What the Fuck France. L’impact des réseaux sociaux a son importance aujourd’hui. Je pense que ça a permis de lancer des humoristes. Les trois derniers que j’ai en tête qui ont percé par exemple, c’est Redouane Bougheraba, Inès Reg, Paul Mirabel… C’est une puissance incroyable, Internet, qui permet de multiplier par 1000 le public, c’est vraiment cool.
Comment appréhendez-vous la tournée de BisouBye ?
Le côté sympa de la tournée, c’est de ne pas jouer régulièrement dans la même salle, ce qui peut devenir usant et routinier. Je trouve que c’est un peu moins créatif, car même si on joue trois fois par semaine, mais que l’on joue dans trois villes différentes, on voyage. C’est excitant, car on retrouve des gens qui aiment ce qu’on fait dans toutes ces villes-là, c’est impressionnant. J’ai hâte, car là j’arrête à Paris le 1er avril et j’enchaîne la tournée à partir du 4 avril. On va passer en France, puis à l’étranger cet été, avant un retour en France en fin d’année, dans d’autres villes, dans des salles plus grandes.
Si vous deviez faire une recommandation humoristique, ça serait laquelle ?
Je pense forcément à Pierre Thevenoux, que je regarde depuis plusieurs années. Quand je le regarde, je me dis qu’il va tout déchirer. Il publie beaucoup de choses sur Internet, j’ai hâte qu’il perce.
Avez-vous regardé le dernier stand-up de Chris Rock, Selective Outrage, disponible sur Netflix ?
Je l’ai vu, il est pas mal. Parmi les derniers stand-up qui sont sortis sur Netflix avec Dave Chappelle, Ricky Gervais et Chris Rock, c’est celui de Chris Rock que j’ai préféré. Ça reste drôle. Mais il y a quelque chose qui s’est passé ces dernières années, ça devient un peu trop politique… Je suis militant sur le fait que quand on est humoriste, notre but principal c’est de faire rire. Parfois, on risque de tomber dans le côté “donneur de leçon”, sans être drôle. J’avoue que je prends un peu moins de plaisir à regarder ces grands noms du stand-up à cause de cet aspect-là. Mais je dois avouer que Chris Rock, comme ça faisait un moment qu’il n’avait rien sorti, j’ai bien aimé son spectacle. Bref, vous l’aurez compris, je pourrais parler de stand-up pendant des heures !
BisouBye, de Paul Taylor, à la Nouvelle Eve (Paris) jusqu’au 1er avril 2023 et en tournée dans toute la France à partir du 4 avril 2023.
À lire aussi