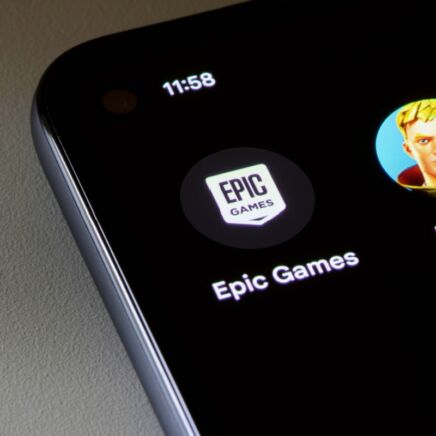L’intérêt du public à l’égard du récent remake de Resident Evil 2 aura permis de mettre en évidence l’attrait toujours irrépressible des joueurs vis-à-vis des jeux vidéo horrifiques. Retour sur l’épanouissement d’un genre qui fascine autant qu’il dérange !
Si le jeu vidéo sait nous donner des sueurs froides, davantage encore que le cinéma, c’est d’abord parce que sa dimension interactive décuple le caractère immersif de l’expérience qu’il procure. Pour une large part, l’efficacité du média réside dans le fait qu’à l’inverse du spectateur, le joueur n’est pas passif devant son écran, mais a au contraire l’obligation de prendre sur lui et de surmonter sa peur s’il souhaite faire avancer l’histoire. Dès lors, le simple fait d’ouvrir une porte ou de poser un pas devant l’autre dans un couloir obscur devient une épreuve en soi. Pas étonnant que tant de joueurs se refusent à affronter le genre ! Car le jeu d’horreur s’apparente bien souvent à une plongée en enfer sans répit dans lequel la pause n’est pas nécessairement une garantie lorsqu’on sait qu’un jump scare est parfois susceptible de venir s’incruster brutalement à l’écran jusque dans les menus…
L’horreur à tout prix
Influencé par le cinéma et la littérature horrifique alors qu’il était encore jeune et immature, le jeu vidéo n’a pas pour autant attendu de grandir pour faire ses premiers pas dans le domaine. Ses balbutiements reposaient alors sur une technologie archaïque ne pouvant lui donner la prétention d’effrayer le joueur. Mais l’intention n’en était pas moins là. Bien que réduit à sa plus simple expression sur le plan graphique, le jeu Haunted House sorti en 1981 sur Atari 2600 reposait ainsi déjà sur le concept d’une traque au cœur d’un manoir hanté aux allures labyrinthiques. Il fallait certes une bonne dose d’imagination pour y ressentir quoi que soit d’oppressant, mais le joueur n’en devait pas moins arpenter les écrans à la hâte s’il voulait espérer échapper à la vigilance d’entités au toucher mortel. La représentation d’un avatar symbolisée par des yeux plongés dans le noir le plus total ne laissait aucun doute sur les intentions de cet ancêtre du jeu d’horreur.
À force de tâtonnements, le jeu vidéo n’aura de cesse, par la suite, d’explorer les mille et une facettes du registre horrifique, compensant les limitations technologiques par une inventivité insatiable. Si le jeu vidéo n’est pas encore en mesure de faire peur, cela n’empêche pas certains titres de s’inspirer du septième art pour inverser parfois les rôles. Dans Splatterhouse (1988), l’un des premiers jeux d »arcade résolument gore, le masque et l’allure générale du protagoniste rappellent fortement le tueur Jason Voorhees du film Vendredi 13. Et ce n’est évidemment pas une coïncidence.
Plus tard, les avancées technologiques inciteront les développeurs à explorer d’autres pistes, tels les films interactifs qui, à l’image de Phantasmagoria (1995), mettront à contribution des acteurs réels afin de rendre le jeu d’aventure plus immersif et donc potentiellement plus effrayant.
Naissance du survival horror
Bien que le terme se prête de moins en moins aux jeux d’horreur les plus récents, le genre ayant considérablement évolué depuis sa création, le concept du survival horror aura permis de définir de manière concrète une catégorie en plein essor dans les années 90. Si l’on considère généralement Alone in the Dark (1992) comme le père de cette catégorie, l’appellation en elle-même a été imaginée par le service marketing de Capcom en 1996 pour accompagner le lancement du premier Resident Evil. Deux mots qui soulignent parfaitement l’idée de survie comme moteur essentiel du genre : le joueur n’est plus le chasseur tout puissant au pied duquel s’amoncellent les cadavres de ses ennemis, c’est lui qui devient la proie de créatures dangereuses. Et toutes les bases du jeu vidéo sont remises en question dès lors que le joueur prend conscience de sa fragilité nouvelle. Le modèle Alone in the Dark du Français Frédérick Raynal se charge ainsi, dès 1992, de mettre en place les éléments indissociables d’un genre qui n’a pas encore de nom.
Reposant essentiellement sur l’absence d’échappatoire offerte par des environnements confinés où la menace survient presque toujours hors champ, le survival horror s’appuie sur des décors pré-calculés et des caméras fixes pour susciter un sentiment de claustrophobie. Inédite à l’époque, la dimension cinématographique qui en résulte se trouve renforcée par l’emploi de sonorités trahissant l’approche de créatures hostiles dont on ne se débarrasse qu’avec difficulté. Le genre se rapproche alors bien davantage du registre de l’aventure que de celui de l’action, la peur découlant précisément de la vulnérabilité extrême du personnage que l’on incarne.
Inspiré des œuvres de H.P.Lovecraft, Alone in the Dark devient le véritable pionnier de cette nouvelle catégorie de jeux, inspirant directement la création du premier Resident Evil comme finira par le reconnaître Shinji Mikami après de longues années de déni. Mais si le titre français impose déjà un standard malgré la rigidité des contrôles encore difficile à contourner à l’époque, c’est bien Resident Evil (1996) qui se charge de populariser le genre en ouvrant une brèche dans laquelle va s’engouffrer toute la concurrence.
Un âge d’or
L’âge d’or du survival horror accueille alors quantité de représentants qui ne se démarquent que lorsqu’ils parviennent à se détacher suffisamment de leur modèle commun. Parasite Eve (1998) ose le pari d’incorporer des notions de RPG dans son gameplay ; Dino Crisis (1999) invite un bestiaire préhistorique pour surfer sur la vague Jurassic Park ; Galerians (1999) emprunte à Akira (manga et film de Katsuhiro Otomo) le maniement de pouvoirs psychiques ; quant à Onimusha (2001), il contribue à faire basculer le genre vers une action plus prononcée qui tend à effacer les racines du jeu d’aventure à énigmes au profit du beat’em all horrifique.
Se distinguant dès son premier volet par ses protagonistes torturés, son ambiance malsaine et sa recherche narrative plus élaborée, Silent Hill (1999) sort très vite du lot au point de faire passer la saga Resident Evil pour une alternative gentillette. La franchise de Konami va se charger d’imposer une approche plus psychologique et mature du survival horror dans laquelle la peur ne résulte plus de simples effets de mise en scène glaçants, mais d’un malaise permanent. Son deuxième volet reste sans doute le plus troublant de par l’intelligence de son propos, les questionnements constants qu’il suscite et sa propension à sortir le joueur de sa zone de confort. Plus qu’aucun autre genre, le survival horror se montre en capacité de marquer durablement son public, quitte à traumatiser les âmes les plus sensibles.
La redéfinition du genre par Capcom en 2005 avec Resident Evil 4 imposera ensuite la caméra à l’épaule pour toujours plus d’immersion, d’action et de tension, malgré une peur sans doute plus relative.
Courez, pauvres fous !
Très vite, l’horreur outrepasse les limites du genre tel qu’il avait été codifié à ses débuts. Survenant dès lors que le joueur perd le contrôle du déroulement du jeu et la maîtrise de son environnement, la peur se montre d’autant plus efficace que l’écart de forces est grand entre le chasseur et sa proie. Ainsi voit le jour toute une vague de titres aux allures de parties de cache-cache dans lesquels le fait d’être découvert s’avère généralement fatal. Ils sont tous les héritiers indirects de Clock Tower, sorti initialement en 1995 sur Super Nintendo. Pourchassée par un tueur psychopathe armé de gigantesques cisailles, l’héroïne n’a pas d’autre choix que de se cacher pour lui échapper, ses chances de survie diminuant drastiquement lorsque son état de stress dépasse un certain seuil.
Dix ans plus tard, Haunting Ground lui rend hommage en réduisant l’aspect aventure/énigme pour mettre l’accent sur la peur d’être confronté à des psychopathes plus nombreux et tenaces. La fragilité du personnage est toujours la composante clé de la réussite du titre qui ne nous laisse comme seul moyen de défense qu’un fidèle compagnon canin. Une ficelle que reprendra d’ailleurs à son compte un certain Rule of Rose, victime en 2006 d’une polémique sournoise et déformée y voyant un appel saugrenu à la violence et au viol qui prouve une méconnaissance totale du jeu. Bien que desservi par un gameplay défaillant, Rule of Rose nous fait partager les réminiscences d’une jeune femme martyrisée dans un pensionnat régi par un groupe de fillettes dérangées.
Toujours plus nombreux, les jeux de survie basés sur la fuite donnent de la consistance au sentiment de peur en promettant une sanction terrible à celui qui ne saura pas se montrer suffisamment furtif pour échapper à ses poursuivants. La vue subjective de Condemned (2005) renforce le sentiment de panique et de paranoïa en confrontant directement le joueur à des tueurs en série mentalement instables. Tout se passe comme si l’angoisse d’être confronté à des êtres humains déséquilibrés était plus oppressante que celle de faire face à des créatures monstrueuses ou surnaturelles, comme le confirme Outlast en 2013. Armé d’un simple caméscope, un journaliste est contraint de se cacher dans un asile, partagé entre son envie d’en savoir plus et celle de fuir le plus loin possible de cet endroit sinistre. Une partie de cache-cache que reprend à son compte Alien : Isolation (2014) où l’on passe davantage de temps recroquevillé dans des placards que debout sur ses deux pieds. Dans Slender: The Arrival (2013), les apparitions brutales de l’antagoniste sont à ce point synonymes de mort que les sons stridents qui les accompagnent suffisent à nous glacer le sang. Et lorsque Shinji Mikami, le père de Resident Evil, revient à l’horreur avec The Evil Within (2014), il pousse le joueur à privilégier la discrétion en veillant à ce que son héros ne dispose pas d’un arsenal trop généreux. Après tout, n’était-ce pas dans ses scènes de poursuite avec le Tyrant-103 et le Némésis que la saga Resident Evil savait le mieux faire grimper la tension ?
Overdose de zombies
Dans les jeux vidéo, comme au cinéma, les zombies ne sont pas tant vecteur d’effroi que de découragement. Si nous les craignons, c’est à cause de leur résistance hors-norme et parce qu’ils sont le reflet de ce que nous serons par-delà la mort. Leur force réside surtout dans leur nombre, mais les hordes de morts-vivants sont-elles encore véritablement en mesure de nous effrayer ? Exploitée à outrance, l’image du zombie s’est ainsi vu progressivement détournée de celle qui était la sienne à l’origine pour servir de prétexte à un revirement vers l’action gore. Dans le rail shooter The House of the Dead (1997) l’horreur n’est déjà plus qu’une donnée esthétique, tandis que Left 4 Dead (2008) sacrifie l’idée de survie en solo pour prôner la coopération entre joueurs et que Dead Rising (2006) s’impose comme un gigantesque défouloir hommage aux films de George Romero.
Je vois des gens qui sont morts
Rejetée dans un premier temps, l’idée de voir l’immatériel susciter la peur dans un jeu vidéo révèle tout son potentiel en 2001 avec la sortie de Project Zero. Si les fantômes ne sont, a priori, pas ce qu’il y a de plus terrifiant sur le plan visuel, leur propension à apparaître et disparaître n’importe où suscite un sentiment de panique permanent. Toute l’efficacité de la série réside dans le fait que le joueur doit prendre sur lui pour laisser les spectres s’approcher au plus près s’il veut pouvoir les capturer à l’aide de son appareil photo. Contraint d’attendre le dernier moment avant d’appuyer sur le déclencheur au risque de se faire toucher, le joueur produit lui-même l’objet de sa peur en multipliant les clichés dérangeants de ces apparitions spectrales. Encore plus sournoisement, Forbidden Siren (2003) nous octroie lui la possibilité de voir à travers les yeux de nos ennemis, tous des morts-vivants aux visages photo-réalistes.
Le paranormal mérite indéniablement sa place au sein du genre horrifique et F.E.A.R. (2005) manie ses rouages avec un talent certain. Tout le déroulement du jeu est littéralement hanté par la présence fantomatique d’une petite fille aux longs cheveux noirs évoquant la sinistre Sadako du film japonais Ring. La personnification de la peur revêt parfois bien des visages et, en matière de surnaturel, Alan Wake (2010) n’est pas en reste non plus. Dans la veine des romans de Stephen King, le jeu fait basculer son écrivain dans un cauchemar en lien avec un scénario qu’il ne se souvient pas d’avoir écrit, le faisceau de sa lampe torche étant son seul allié face aux ténèbres. En faisant de l’élément le plus anecdotique des jeux d’horreur l’arme principale du protagoniste, le titre accentue encore plus sa vulnérabilité.
L’antre de la folie
Dans l’optique d’instaurer une pression nouvelle d’ordre psychologique, un certain nombre de titres vont projeter le joueur dans la peau d’individus fragiles pouvant basculer à tout moment dans la folie. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (2002), qui multiplie les points de vue à travers le prisme d’individus ayant vécu à des époques éloignées, en est l’un des exemples les plus parlants. Son originalité réside dans la nécessité pour le joueur de veiller constamment à préserver la santé mentale de ses personnages en dépit des traumatismes dont ils sont victimes. À chaque fois que l’un d’eux perd le contrôle, le jeu brise le quatrième mur au travers d’effets hallucinatoires conçus précisément pour interpeller le joueur. Difficile en effet de rester stoïque lorsque notre avatar se retourne pour nous tirer dessus ou que le jeu simule des bugs entraînant la suppression de nos fichiers de sauvegarde !
Amnesia : The Dark Descent (2010) prolonge cette idée de folie vue comme une ombre planant en permanence sur le protagoniste, mais y ajoute un paradoxe. Alors que l’obscurité fait inéluctablement sombrer le personnage dans la démence, ce dernier n’a pourtant pas d’autre choix que de s’y cacher s’il veut rester en vie. Dans le dernier Call of Cthulhu (2018) tout comme dans l’épisode de 2005, Dark Corners of the Earth, la folie fait aussi partie intégrante du système de jeu. Du statut psychologique du personnage principal dépend la fréquence des hallucinations dont il est victime, ces dernières pouvant aller jusqu’à entraîner sa mort.
Ambiance et suggestion
Fort de son expérience passée, le jeu d’horreur plonge désormais davantage ses racines dans une angoisse résultant d’une ambiance oppressante, voire malsaine, et d’une force de suggestion déroutante. C’était déjà le cas en 1998 avec Sanitarium, un jeu d’aventure en 3D isométrique qui nous plongeait dans les méandres de l’inconscient d’un personnage amnésique passant d’une identité à l’autre au fil du jeu. Un titre profondément dérangeant au point de se voir interdit à la vente une semaine seulement après sa sortie, ce qui ne l’a pas empêché de devenir culte.
Si la technologie a considérablement évolué depuis, les intentions sont restées les mêmes avec un retour aux origines de la peur primaire au détriment de l’action. En nous conviant à la table d’une famille d’individus dérangés coupables d’actes sordides, Resident Evil VII (2017) a su nous tétaniser bien davantage que tous ses prédécesseurs réunis, quitte à nous faire frôler la crise cardiaque en VR. Difficile d’oublier aussi Dead Space (2008), huis clos spatial à l’atmosphère suffocante où les scènes-chocs se multiplient face à des Nécromorphes qu’il faut démembrer en conservant un maximum de sang-froid. Et que dire de la démo de P.T. qui, en quelques instants seulement, instaure une atmosphère oppressante difficilement soutenable tant ses sonorités nous mettent mal à l’aise ? Preuve que la peur la plus viscérale réside finalement dans ce que l’on imagine, mais que l’on ne voit pas, de ce qui pourrait faire basculer le réel dans une horreur sur laquelle nous n’aurions plus d’emprise.
Soulignons pour finir que le cadre horrifique peut également être employé dans le but de mettre en évidence le prisme des comportements humains, dans ce qu’il a de plus négatif, mais aussi de plus positif. Poussés dans leurs derniers retranchements, les hommes sont souvent prêts à tout pour assurer leur propre survie au détriment des autres, comme le montre assez bien la série de jeux épisodiques The Walking Dead (2012) de Telltale. À l’opposé, le désespoir qui transparaît dans The Last of Us (2013) n’empêche pas son duo insolite de tout mettre en œuvre pour s’en sortir main dans la main.