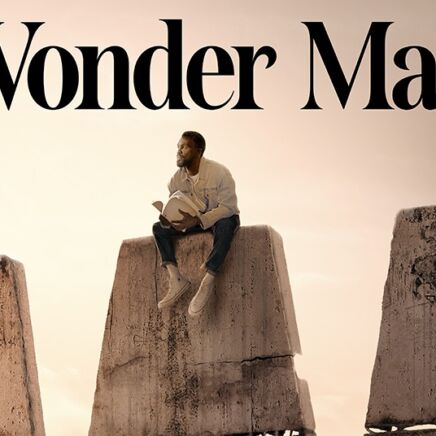Longtemps l’apanage de maîtres masculins comme Cronenberg ou Carpenter, le body horror est aujourd’hui réinventé par une nouvelle vague de réalisatrices audacieuses. De la Palme d’or « Titane » au choc « The Substance », leur cinéma déplace le champ de bataille : la chair n’est plus seulement le miroir des angoisses sociales mais le lieu d’une politique de l’intime. Voici 10 œuvres essentielles pour comprendre la mutation la plus stimulante du cinéma de genre.
Le corps humain, fragile et fascinant, devient ici un terrain de cauchemar. Du frisson viscéral de Cronenberg aux expérimentations chocs de Ducournau, le body horror explore nos peurs les plus intimes : mutations, souffrance, transformations… Du grotesque à l’inoubliable, ces films nous font frissonner, fascinent et questionnent notre rapport au corps. Découvrez notre sélection des meilleurs films du genre.
Les Yeux sans visage, Georges Franju (1960)
Vingt ans avant John Carpenter ou David Cronenberg, le body horror trouvait sa matrice poétique en France avec Les Yeux sans visage de Georges Franju. Le film suit la folie froide du docteur Génessier (Pierre Brasseur), qui enlève de jeunes femmes pour greffer leur visage sur celui de sa fille Christiane (Édith Scob), défigurée et condamnée à porter un masque d’une inquiétante neutralité.
Franju refuse le spectacle du gore au profit d’un lyrisme funèbre, transformant le conte de fées en cauchemar clinique. L’horreur chirurgicale, l’obsession de la greffe, la tragédie du visage volé : tout le body horror moderne est en germe ici.
The Thing, John Carpenter (1982)
Menée par Kurt Russell, une équipe de scientifiques se retrouve isolée en Antarctique face à une entité capable de les imiter à la perfection, faisant ainsi de chaque homme le traître potentiel de l’autre.
Chef-d’œuvre de John Carpenter, The Thing fait du corps un champ de bataille de la paranoïa. Dans le contexte de guerre froide des années 1980, le réalisateur dynamite le mythe de la fraternité virile en faisant du corps masculin un véhicule de contamination. L’alien n’est pas un monstre à combattre mais un virus qui dissout l’identité, incarné par les créatures cauchemardesques de Rob Bottin. L’horreur n’est plus la créature, mais la certitude que l’intégrité de la chair a été violée.
Videodrome, David Cronenberg (1983)
Œuvre prophétique sur notre rapport aux écrans et incontestable manifeste du genre, Videodrome de David Cronenberg suit la descente aux enfers de Max Renn (James Woods), producteur TV cynique qui découvre un signal pirate. Loin de la simple image, celui-ci agit telle une tumeur cérébrale, provoquant hallucinations et mutations : une fente ventrale où s’insèrent des cassettes-organes, un pistolet fusionnant avec la main…
Cronenberg filme la fusion organique du corps et du signal : une humanité dont la chair devient le récepteur direct des images. Une vision radicale qui trouve son slogan dans une devise devenue culte : « Longue vie à la nouvelle chair ! ».
La Mouche, David Cronenberg (1986)
Avec La Mouche, David Cronenberg, encore lui, signe l’opéra tragique du body horror. Le film suit la lente métamorphose du scientifique Seth Brundle (Jeff Goldblum), dont l’ADN fusionne avec celui d’une mouche après une expérience de téléportation. Sous le regard aimant et horrifié de sa compagne Veronica (Geena Davis), sa chair se décompose, se disloque, se délite.
Le véritable drame filmé par Cronenberg est celui du dialogue impossible entre un esprit intact et une chair qui le trahit. Une poignante allégorie de la maladie et du vieillissement où la déchéance physique devient le spectacle insoutenable d’un homme qui assiste, lucide, à sa propre disparition.
Tetsuo, Shinya Tsukamoto (1989)
Fer de lance du cyberpunk japonais, Tetsuo de Shinya Tsukamoto est une expérience esthétique aussi radicale que politique. Tourné dans un noir et blanc granuleux, sur-contrasté, le film suit un salaryman – archétype de l’employé de bureau, symbole de la conformité urbaine – qui voit son corps se hérisser de ferraille suite à un étrange accident.
Le montage frénétique que vient marteler une bande-son industrielle, ne sont pas là de simples effets de style : ils incarnent l’angoisse d’une chair violemment colonisée par le métal de la ville. Une œuvre fondatrice où la fusion homme-machine devient un cauchemar biomécanique.
Annihilation, Alex Garland (2018)
Dans Annihilation, Alex Garland fait basculer le body horror dans une dimension contemplative. Pour comprendre le mal qui ronge son mari, une biologiste (Natalie Portman) rejoint une expédition suicide dans le « Miroitement », une zone mystérieuse où les lois de la nature se dérèglent. Ici, les corps ne se décomposent pas, ils fusionnent : leur ADN se mêle à la faune et la flore dans une évolution aussi sublime que terrifiante.
Une puissante allégorie de la maladie et de l’autodestruction, où l’horreur naît, non pas dans la déchéance, mais dans la beauté d’une évolution monstrueuse.
Possessor, Brandon Cronenberg (2020)
Avec Possessor, Brandon Cronenberg se pose en digne héritier de son père David. Son film met en scène une tueuse à gages (Andrea Riseborough) qui pirate l’esprit d’un homme (Christopher Abbott) pour lui faire commettre un assassinat.
Là où son père filmait la fusion de la chair et de la technologie analogique, le fils explore l’invasion de l’esprit à l’ère numérique. Le corps n’est plus le lieu de la mutation mais un simple vaisseau piraté. Une marionnette dont l’esprit originel lutte pour ne pas être effacé. Une vision froide et méthodique de la perte d’identité : que reste-t-il de nous quand notre propre corps devient notre prison ?
Titane, Julia Ducournau (2021)
Cinq ans après son percutant récit d’apprentissage cannibale Grave, Julia Ducournau continuait de faire trembler le cinéma de genre avec Titane, puissant film transgenre orchestrant la rencontre inattendue de deux corps en souffrance : celui d’Alexia (Agathe Rousselle), tueuse en série au corps-armure soudé au titane et celui de Vincent (Vincent Lindon), pompier vieillissant qui se gave de stéroïdes pour maintenir l’illusion d’une masculinité indestructible. C’est en se faisant passer pour le fils disparu de ce dernier qu’Alexia, traquée par la police, trouve refuge dans sa caserne.
Le body horror devient alors le langage d’un amour fou, illustrant la propre vision de la réalisatrice : « La monstruosité est une arme pour repousser les murs de la normativité ».
Love Lies Bleeding, Rose Glass (2024)
En deux films, deux fulgurances, Rose Glass s’est imposée comme l’une des voix les plus audacieuses du cinéma de genre contemporain. Après avoir exploré la foi dévorant la chair dans Saint Maud, elle filme dans Love Lies Bleeding une romance toxique carburant au muscle et à la rage.
Ce thriller néo-noir suit la passion électrique entre Lou (Kristen Stewart) et la bodybuildeuse Jackie (Katy O’Brian), qui sert de détonateur à une échappée sanglante. Le corps de Jackie, gonflé aux stéroïdes, devient l’incarnation monstrueuse de cette fureur. Une énergie inédite où le body horror n’est plus une fin en soi, mais le langage fiévreux et survolté des passions destructrices.
The Substance, Coralie Fargeat (2024)
Avec The Substance, Coralie Fargeat pousse la satire de l’obsession pour la jeunesse éternelle jusqu’à son point de rupture. Le film suit une star déchue (Demi Moore) qui utilise un sérum pour générer une version d’elle-même plus jeune et parfaite (Margaret Qualley).
Au gré d’un magistral bal des horreurs, la cinéaste semble prendre un malin plaisir à convoquer ses maîtres – Cronenberg, Kubrick, De Palma, Carpenter… Une façon de nous emmener en terrain connu et conquis pour mieux nous surprendre avec sa propre vision : celle d’une outrance inouïe qui, au-delà du seul brûlot féministe, semble passer au scalpel la véritable racine du mal : un capitalisme radical qui a fait de l’obsolescence du corps féminin son plus rentable fonds de commerce.