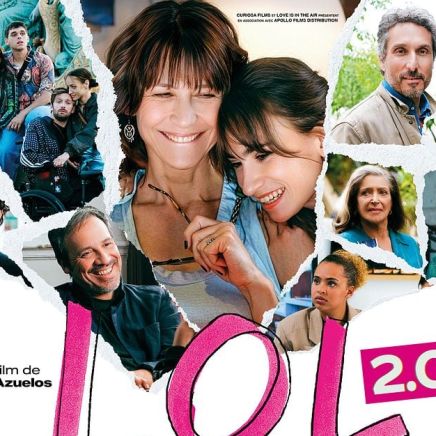Présenté à Cannes en juillet dernier, Evolution est le nouveau film-performance du cinéaste hongrois Kornél Mundruczó, une fois de plus soutenu à l’écriture par la dramaturge Kata Wéber. Malgré la grandiloquence coutumière de sa mise en scène, le réalisateur de White God (2014) et de Pieces of a Woman (2020) semble ici être arrivé à une forme de sobriété.
Adapté de la pièce éponyme de Kata Wéber montée lors de la Ruhrtriennale (Allemagne) en 2019, Evolution tente de saisir, en trois séquences distinctes, la transmission aussi bien consciente qu’indicible de la mémoire et du traumatisme de la Shoah sur trois générations successives. Plus confidentiel que les précédents longs-métrages de Kornél Mundruczó, mais non moins ambitieux, Evolution soude en un seul geste cinématographique, en un seul et même mouvement initié au cours d’une séquence d’ouverture tragiquement évocatrice, une naissance miraculée dans les camps d’extermination à la relation d’une mère au seuil de sa vie avec sa fille unique, jusqu’à une jeunesse berlinoise devant s’accommoder de cet héritage douloureux et qui ne se reconnaît pas nécessairement dans les traditions qu’on lui a transmises.
One shot
Comme à l’accoutumée, Mundruczó ouvre son film par un nouveau plan-séquence impressionnant de maîtrise, tant la caméra bascule constamment entre différents points de netteté sans que le spectateur ne perde jamais le fil de l’action. Bien que techniquement irréprochable, le dispositif semble d’emblée assommant et expérimental, d’autant que la scène en question pourrait appeler à plus de retenue ; mais le silence lourdement chargé de sens et l’horreur qui s’immisce lentement dans la scène – à l’image de ces hommes essoufflés, pénétrant dans ce que l’on devine être un lieu habité par le mal le plus radical et appréhendant progressivement l’horreur qui stagne entre ces quatre murs – portent tout le poids symbolique du premier tiers d’Evolution. La caméra de Mundruczó a indéniablement quelque chose de fantomatique dans sa manière de flotter à travers l’espace et de signifier, à travers ses mouvements incessants et son refus du repos, les plaies encore vives qui hantent les lieux. Cette manifestation organique de la caméra ne s’effacera jamais et habitera les trois parties du film comme une sorte de présence immatérielle, dont le regard scrute les personnages et raccorde les différentes temporalités.

Tourné pendant la pandémie en à peine quinze jours et dans des conditions de tournage forcément plus drastiques que le précédent film de Mundruczó hébergé par Netflix, Evolution ne déroge pas pour autant au style du cinéaste hongrois marqué par ce recours systématique au plan-séquence s’étalant sur la durée, naviguant souvent au sein d’un même espace confiné et allant progressivement vers un pic d’intensité dramatique. C’est plus particulièrement le cas des deux premiers segments du film, où l’étouffement est à son comble et où l’accumulation de charge émotionnelle est désamorcée par une forme assez littérale de décloisonnement.
Dans ce triptyque cinématographique, Mundruczó troque habilement le symbolisme poussif de son précédent long-métrage, Pieces of a Woman (2020), contre une forme de théâtralité cette fois-ci totalement assumée et décomplexée, là où Pieces of a Woman – tiré lui aussi d’une pièce de Kata Wéber, montée en 2018 à Varsovie – s’épuisait constamment à prouver aux abonnés de Netflix sa virtuosité implacable quand au fond le film entier reposait sur les épaules de ses comédiennes, Vanessa Kirby (qui reçut le prix de la meilleure interprétation à la Mostra de Venise) et Ellen Burstyn, dont la relation mère-fille fait écho à plus d’un titre à celle entre Eva (Lili Monori), enfant miraculée des camps, et de sa fille Lena (Annamária Láng), privée malgré elle d’une enfance heureuse.

Contrairement à une séquence d’ouverture dénuée de mots, où aucun mot n’est à vrai dire digne d’être prononcé, la scène entre Eva et sa fille est quant à elle portée de bout en bout par la parole, les regards, le dialogue entre les êtres et le déterrement des non-dits. Le troisième acte du film, plus impertinent et moins figé dans son dispositif, est peut-être au fond le segment le plus cinématographique du film, ne serait-ce que parce que la caméra s’autorise à suivre le fils de Lena, alors installée à Berlin, dans tous ses déplacements – Jonas, ado mal dans sa peau qui préfère d’ailleurs à son propre visage celui d’un alter ego mort-vivant, affublé de fausses plaies béantes qui dissimulent, on l’aura compris, une fêlure nettement plus intime.
Sur le fond, comme sur la forme, il n’y a pas grand-chose à reprocher au programme sensiblement didactique d’Evolution. Le dernier tiers du film interroge sans détour la question de la mémoire, des traditions, dans une métropole, Berlin, à jamais marquée par le poids du passé. En revanche le film pâtit quelque peu de sa nature théâtrale, tout comme Pieces of a Woman, quoi qu’avec moins de suffisance. Le film prend alors plutôt les contours d’un manifeste esthétique, un de ces « films-performance » que Mundruczó aurait pu lui-même tourner pour une pièce de sa compagne et projeter en fond de scène – comme c’était déjà le cas de l’éprouvante scène d’accouchement d’Une femme en pièces.

Le film témoigne de l’engagement du cinéaste à déployer les possibilités du cinéma et à compresser au maximum cette impression du « temps vécu », non seulement pour faire honneur au texte de Wéber, mais aussi afin de le faire accéder à une nouvelle dimension, de lui offrir de nouvelles couches de lecture et de décupler sa puissance d’évocation. C’est précisément là que l’on sent qu’Evolution relève plutôt de l’exercice théorique, allant jusqu’à rappeler les mêmes actrices présentes au plateau devant la caméra, comme s’il fallait affirmer la puissance du cinéma à prolonger l’effort de la pièce d’origine, à en dégager de nouvelles nuances, d’autres regards, une forme de durée, de présence et d’incarnation.
La caméra de Mundruczó est sans cesse là pour nous rappeler sa présence, son point de vue quasi omniscient. Il n’y a qu’elle qui puisse, par exemple, s’offrir une respiration et sortir par la fenêtre de l’appartement de Lena au milieu d’une conversation, comme pour montrer que le monde, malgré tout, est encore là ; c’est précisément ce réflexe du réalisateur à étayer la toute-puissance de ses outils qui, ici et là, empêche le film de d’exister pleinement par lui-même. Heureusement, la troisième partie offre plus d’amplitude et de respiration à l’ensemble et a le mérite de sortir légèrement le cinéaste de sa zone de confort.
Evolution de Kornél Mundruczó et Kata Wéber – 1h37 – avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego – en salles le 18/05/2022