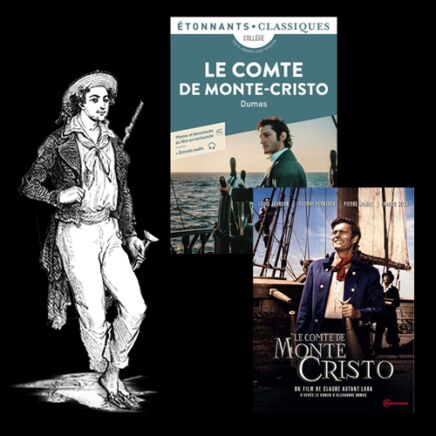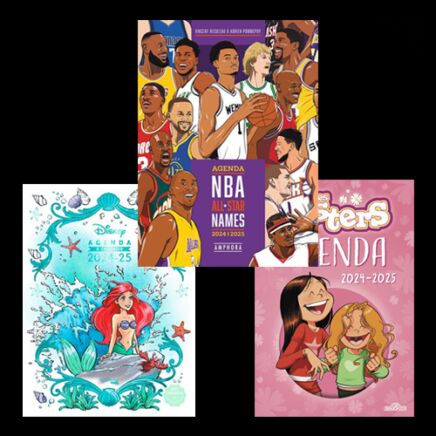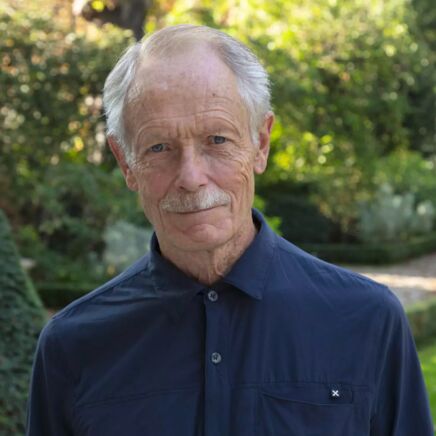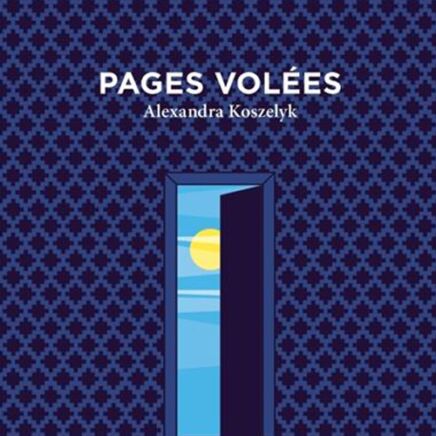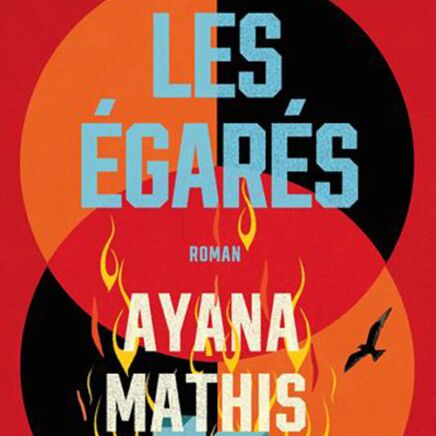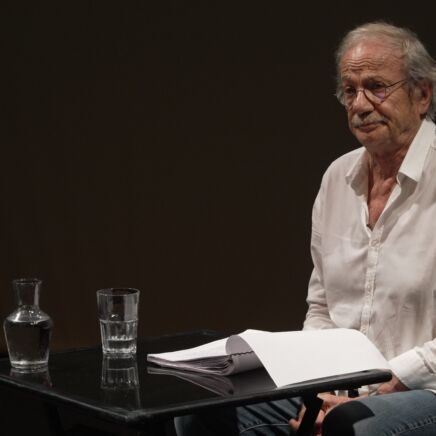Du roman noir américain au thriller nordique sanglant en passant par le cosy mystery so british ou le polar français ultra-réaliste, L’Éclaireur livre sa sélection des meilleurs classiques du genre.
Le Quatuor de Los Angeles, de James Ellroy
Comment parler polar sans évoquer « The American Dog » James Ellroy et son célèbre Quatuor de Los Angeles ? Avec cette tétralogie culte, composée du Dahlia noir (1987), du Grand nulle part (1988), de L.A Confidential (1990) et de White Jazz (1991), le romancier américain peint une fresque vénéneuse de la Cité des Anges des années 1940 et 1950. Autour de trafics en tout genre et de sordides affaires de meurtres gravitent ainsi de vieux flics corrompus, de jeunes recrues ambitieuses, des femmes envoutantes et dangereuses, des politiciens véreux, et des mafieux impitoyables. James Ellroy façonne sa propre comédie humaine – et l’infuse au houblon bien corsé. Il triture sans vergogne les phrases, les styles et les procédés narratifs, comme s’il voulait faire subir à la langue cette même violence que celle qui ronge inexorablement ses personnages. Une littérature âpre, brutale, sulfureuse. La quintessence du roman noir américain.
James Ellroy, La Quatuor de Los Angeles, t. 1, Le Dahlia noir, Rivage Poche, 560 p., 10€70.
Zulu, de Caryl Ferey
Après Haka et Utu, dyptique redoutable entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Caryl Ferey, l’ancien correspondant du Routard devenu roi du polar, nous emmène en Afrique du Sud. Zulu est un roman intense et nerveux porté par un duo de héros aussi attachants que torturés. Ali Neuman, chef de la police criminelle de Cape Town, est l’un des seuls rescapés du bantoustan de KwaZulu et porte encore en lui les stigmates de l’Apartheid. Son adjoint, Brian Epkeen est un Afrikaner paumé et porté sur la bouteille qui supporte mal les atrocités commises par les siens. Alors qu’ils enquêtent sur le meurtre d’une star du rugby, ils vont se retrouver pris au piège d’une affaire d’État qui les dépasse.
Au-delà du thriller à suspense, Zulu est aussi le tableau poignant d’un pays profondément meurtri qui panse encore ses terribles blessures. Entre les inégalités, la misère, les ravages du sida et de la drogue, entre les guerres de gangs et les machinations politicienne, Caryl Ferey tire à boulet rouge sur le mirage de la réconciliation nationale.
Caryl Ferey, Zulu, Folio Policier, 464 p., 9€20.
L’homme aux cercles bleus, de Fred Vargas

Comment oublier cette première rencontre avec Jean-Baptiste Adamsberg, ce commissaire négligé, pataud, mais doté d’une intuition sans faille ? L’homme aux cercles bleus, ce sont d’abord des présentations émouvantes avec le héros récurrent des romans de Fred Vargas. Mais c’est aussi l’une des enquêtes les plus fascinantes et les plus intrigantes de l’autrice. Dans la nuit noire, des cercles bleus sont tracés à la craie sur les trottoirs de Paris sans qu’on sache quelles sont leurs significations. Pour rajouter à l’étrange, ces dessins sont accompagnés d’une phrase énigmatique : « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ? » La rumeur enfle et les gens se passionnent pour ce rituel. Certains évoquent un sens religieux, d’autres y voient même une démarche artistique. Pour Adamsberg en revanche, il n’y a là rien de réjouissant : il pressent comme un message annonciateur de malheur et les préparatifs méticuleux d’un redoutable tueur. Avec ce premier roman, on assiste à la naissance de la patte Vargas, un polar cru, ultra-réaliste et une poésie brute qui révulse autant qu’elle envoute.
Fred Vargas, L’homme aux cercles bleus, J’ai Lu, 224 p., 6€90.
Un certain goût pour la mort, de P.D. James
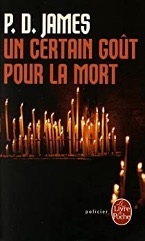
Figure des lettres britanniques anoblie par la Reine, disparue en 2014 à 94 ans , Phyllis Dorothy James a été la plus fidèle héritière d’Agatha Christie. Véritable star en Grande Bretagne, il faudra attendre Un Certain goût pour la mort, récompensé du Grand Prix de littérature policière en 1988 pour qu’elle se révèle véritablement en France. L’occasion de découvrir l’inoubliable Adam Dalgliesh, un inspecteur de Scotland Yard pas comme les autres qui deviendra son héros récurrent. Dandy so british, amateur de poésie, d’architecture et de musique classique, notre « Gentleman detective » va être confronté à une bien curieuse affaire. Dans l’Église Saint-Matthew de Paddington, sont découverts côte à côte les cadavres égorgés de Sir Paul Berowne, aristocrate et ex-député, et de Harry Mack, un sans-abri. Quel lien peuvent donc avoir ces deux hommes que tout oppose ? En tentant de répondre à cette question, Adam Dalgliesh va s’offrir une plongée troublante dans les arcanes de la politique et de l’aristocratie britannique.
Grâce à sa langue magnifique, sa finesse psychologique épatante et son humour décalé, P.D. James nappe ses romans d’une ambiance sans pareille. Un mélange surprenant de suspense et de douce inquiétude aux antipodes du polar sanguinolent. Le cosy mystery à son paroxysme.
P.D. James, Un certain goût pour la mort, Le Livre de Poche, 576 p., 8€90.
1974, de David Peace
Âmes sensibles s’abstenir. David Peace fait dans le roman noir, très noir. Avec son Quatuor du Yorkshire, hommage direct au Quatuor de Los Angeles et à James Ellroy qu’il considère comme son maître, le romancier britannique réinterprète le fait divers le plus célèbre et le plus sordide de l’histoire moderne de son pays. Au tournant des années 1970 et 1980, pendant plus de cinq ans, celui qu’on surnommait amicalement L’Éventreur du Yorkshire a terrorisé l’Angleterre en commettant pas moins de treize meurtres et sept agressions sauvages visant à chaque fois des prostituées ou des femmes qu’il jugeait dépravées. Sous le regard d’Eddie Dunford, jeune et ambitieux journaliste prêt à tout pour son moment de gloire, on va plonger dans cette affaire tête baissée et côtoyer de très près cette folie meurtrière.
Dire que la littérature de David Peace fait froid dans le dos serait un euphémisme. Sa poésie s’épanouit dans l’horreur et ses phrases n’en finissent plus quand il s’agit de décrire dans le moindre détail la cruauté la plus insoutenable. Du naturalisme gore qui donne des hauts le cœur, le pendant trash, glauque et salissant du cosy mystery d’Agatha Christie et de P.D. James. Deux salles, deux ambiances.
David Peace, 1974, Rivages Poche, 416 p., 9€15.
Meurtriers sans visage, Henning Mankell
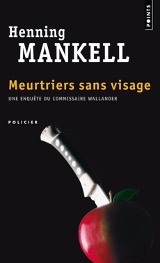
Figure de proue du polar scandinave, l’écrivain suédois Henning Mankell et son héros, le commissaire Kurt Wallander, forment un des duos les plus iconiques du genre. Meurtriers sans visage, la première enquête de sa série culte, dessine dès 1991 les contours de ces thrillers venus du froid qui inondent aujourd’hui les librairies. Wallander est le prototype du flic bourru et désabusé, un homme qui ne peut réprimer sa colère face à une vie personnelle qui s’écroule et qui se réfugie dans le travail où il brille par son intelligence. À Ystad, petite ville de Suède où il vient d’être muté, un couple est retrouvé sauvagement assassiné. Juste avant de mourir, la femme a susurré le mot « étrangers » – comme pour désigner les coupables. Alors que les locaux et les médias pointent du doigt les immigrés qui sont venus s’installer dans la région, le commissaire Wallander devine que la vérité est toute autre.
Loin des enquêtes ébouriffantes menées à 200 à l’heure entre fusillades et explosions, Henning Mankell livre un polar lancinant et inquiétant où les phrases prennent le temps de disséquer la psychologie des personnages et de recréer l’esprit des lieux. Sous sa plume, le roman policier est un genre engagé. Derrière l’enquête, se dévoile en effet une chronique corrosive de son pays, si prompt à céder aux sirènes de la xénophobie.
Henning Mankell, Meurtiers sans visage, Points, 384 p., 7€95.
La Cité des Jarres, d’Arnaldur Indridasson
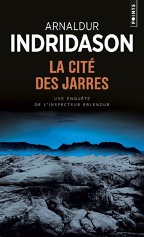
Dans la lignée du suédois Henning Mankell, le romancier Islandais Arnaldur Indridasson s’est rapidement imposé comme le grand patron du polar nordique. Son héros, l’inspecteur de la police de Reykjavik, Erlendur Sveinsson, est d’ailleurs un hommage direct à Kurt Wallander. Son cynisme, le désastre de sa vie privée, cet instinct qui ne le trompe jamais : le lecteur prend un malin plaisir à découvrir un nouveau génie grincheux et incontrôlable.
Dans La cité des jarres, il se met d’ailleurs en tête, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, de résoudre le meurtre d’une ordure, un vieil homme chez qui on a retrouvé toute une collection de photos pornographiques immondes et un cliché sordide représentant la tombe d’un enfant de quatre ans. L’étrange message laissé sur son bureau « Je suis LUI », n’arrête pas de résonner dans sa tête et son obstination va le mener bien plus loin qu’il le pense, au cœur d’une affaire vieille de quarante ans mêlant viols, assassinats et manipulations génétiques.
Arnaldur Indridason, La Cité des jarres, Points, 336 p., 7€70.
Les morsures de l’ombre, de Karine Giebel
Lorsque le commissaire Benoit Lorand s’arrête sur la route pour aider une jeune fille en panne et qu’il accepte de l’accompagner chez elle pour partager un verre, il est loin de se douter qu’il plonge tête baissée dans un piège. Il se réveillera quelques heures plus tard dans une cellule aménagée au sous-sol de la maison. Sa geôlière, impassible, lui intime l’ordre de confesser ses crimes sous peine d’atroces souffrances. Mais de quoi peut-elle bien l’accuser ?
Dans cette lugubre prison qui semble rétrécir page après page à mesure que la tension monte, Karine Giebel façonne un huis clos étouffant où le flic devient l’accusé et la victime le bourreau. Un jeu de dupes plein de rebondissements qui donne le tournis. Le premier coup de maître de l’une des reines du polar français.
Karine Giebel, Les morsures de l’ombre, Pocket, 320 p., 6€95.
Mygale, de Thierry Jonquet
Qui aurait pu croire que derrière La Piel que habito, le chef-d’œuvre de Pedro Almodovar, se cachait un roman français ? Mygale est l’illustration la plus redoutable du polar au cordeau. 200 pages dérangeantes suffisent à Thierry Jonquet pour tisser sa toile et piéger son lecteur au cœur de cette lugubre villa. 200 pages pour comprendre la relation qui unit le chirurgien Richard Lafargue et celle qui se tient toujours à ses côtés, l’énigmatique Eva. Exploration douloureuse de la soumission, de la captivité, grand roman de la vengeance, Mygale plonge loin, très loin dans les tréfonds de l’âme humaine.
Thierry Jonquet, Mygale, Gallimard, 160 p., 6€90.
Les Racines du Mal, de Maurice G. Dantec

Personnage sulfureux, souvent critiqué pour ses prises de positions réactionnaires et son étrange mysticisme, Maurice G. Dantec n’en fut pas moins un écrivain de génie et un romancier d’avant-garde. Les racines du mal, son chef d’œuvre, Grand prix de l’imaginaire en 1996, est un polar mâtiné de science-fiction, un conte futuriste sombre et unique en son genre. Andreas Schatzmann, un dangereux paranoïaque persuadé que les Aliens se sont alliés aux Nazis pour prendre le contrôle de la planète, se lance dans une croisade sanglante pour empêcher ce qu’il croit être un terrible complot mondial. Après un énième massacre, ce fou dangereux est enfin arrêté et un trio de scientifique mené par Dardanquier, inventeur d’une neuromatrice assez puissante pour simuler un cerveau humain, décide de l’étudier. Au risque de découvrir de dangereuses vérités.
Au beau milieu des années 90, alors que le monde entre dans les premières heures d’internet, Dantec explore déjà les possibilités infinies de l’intelligence artificielle pour façonner une enquête inquiétante et violente, et s’érige déjà comme une figure à part du polar, un peintre des abîmes qui dessine avec fureur les contours de ces lendemains qui déchantent.
Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, Gallimard, 768 p., 10€30.