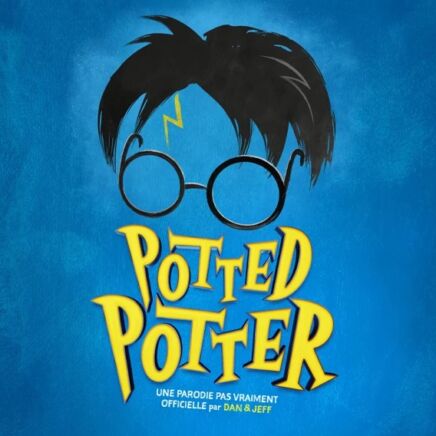Écrit et mis en scène par l’incontournable Joël Pommerat, Cendrillon, monté pour la première fois il y a maintenant plus de dix ans à Bruxelles, prend de nouveau ses quartiers au Théâtre de la Porte Saint-Martin dans une mise en scène qui, contrairement au conte qu’il déconstruit astucieusement, n’a pas pris une ride.
Cendrillon est l’une des trois relectures de contes signées du metteur en scène et auteur de théâtre français Joël Pommerat ; après Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio, sa vision très personnelle de Cendrillon avait fait sensation lors de sa création en 2011. Celle-ci revient aujourd’hui enchanter le Théâtre de la Porte Saint-Martin, pour les petits et les grands. Mais ce Cendrillon ne convient peut-être pas à toutes les tranches d’âge, car si la pièce de Pommerat semble s’adresser à tous du simple fait que le matériau qu’il attaque est encore très populaire, celle-ci est aussi très noire, acerbe, angoissante et lorgne bien plus vers la version des frères Grimm que celles de Charles Perrault et, quelques siècles plus tard, de Walt Disney. « J’ai peur, maman… », a-t-on d’ailleurs pu entendre dans le public au début de la représentation tandis que le noir s’installait dans la salle, que les silhouettes des acteurs commençaient à peine se distinguer et que les premiers mots résonnaient comme un murmure. « N’aie pas peur », a chuchoté la mère, faisant alors écho à la promesse prononcée par Sandra, incarnée sur scène par Léa Millet (qui reprend à merveille le rôle initialement assumé par Déborah Rouach), à sa mère mourante avant que celle-ci ne rende son dernier souffle.
Jolie petite histoire
S’il fait effectivement peur, c’est que ce Cendrillon est bien loin de la version édulcorée fixée par Disney ; Pommerat n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat et d’entrée de jeu, la pièce est traversée par la question du deuil, annonçant qu’elle empruntera un chemin bien plus escarpé que celui du conte de fées que l’on a entendu mille fois. Rarement aura-t-on vu une pièce saisir avec autant de justesse ce dialogue inéluctable entre l’enfance et la mort et cette prise de conscience existentielle qui, chez Cendrillon comme sans doute les autres enfants de cet âge, marque le passage vers un autre rapport au monde. À vrai dire, toute la pièce de Pommerat baigne dans une semi-obscurité : tout ce qui se passe sur scène semble éclairé de nuit, à la seule lumière d’une lampe torche. C’est à peine si l’on perçoit les traits des comédiens et des comédiennes, comme si les personnages venaient tout juste sortir de leurs moules ; ce n’est qu’en se rapprochant du dénouement que ceux-ci se fraieront peu à peu un chemin hors de l’obscurité. Un parti pris de mise en scène intriguant donc, mais d’autant plus saisissant si l’on s’attendait justement à entrer, avec ce brin de naïveté propre aux contes, dans un univers féerique, enchanté et coloré.

Or Joël Pommerat, qui se décrit volontiers comme un « écrivain de spectacles », déjoue très vite les attentes tapies au fond de cet imaginaire biberonné aux contes de fées : la pièce se déroulera entièrement dans cette nuit qui n’en est pas vraiment une, mais qui incarne bien ce lieu de l’inconscient où siègent les histoires que l’on se raconte à soi-même pour avancer – à l’instar de Sandra, surnommée « Cendrier » par sa terrible belle-mère (incarnée par la comédienne Catherine Mestoussis, dont le timbre de voix imprime durablement son personnage irascible) et ses deux filles agaçantes, convaincue qu’elle doit sans cesse penser à sa mère et se « tuer » à la tâche pour que celle-ci continue à vivre « quelque part ». C’est précisément dans ce « quelque part » que se loge la pièce de Pommerat, c’est-à-dire dans un monde blême, froid et sous-terrain, à l’image de la cave dans laquelle dort Sandra. Un monde à double entrée, en quelque sorte, d’une part le rêve et l’inconscient – toute la culpabilité de Sandra, qui la pousse à effectuer les tâches les plus ingrates et à saturer ses pensées du souvenir de sa mère, étant après tout née d’une incompréhension autour de mots qu’elle n’était certainement pas prête à entendre — d’autre part le monde des apparences et des illusions, appuyé par tous ces jeux de reflets, de lumières et de distorsions que s’autorise le metteur en scène, bien aidé par le scénographe Éric Soyer.

Au bout du conte
S’il ne renonce pas totalement à certains marqueurs du conte – la fée, la marâtre, le chausson, le prince, etc. -, Joël Pommerat les reprend habilement « à son conte » et les fait basculer dans un certain réalisme : la fée (Noémie Carcaud) énonçant à Cendrillon ses quatre vérités, une belle-mère névrosée, obsédée par ce que les autres pensent d’elle et persuadée d’être convoitée par le prince (Caroline Donnelly), un prince finalement aussi tourmenté que Sandra et également traumatisé par la perte de sa mère, dont il attend chaque jour, en vain, l’appel… L’auteur et metteur en scène de Ça ira, fin de Louis (1), qui visiblement accorde une place fondamentale à la parole dans ses créations – comme si le théâtre était avant tout le lieu d’une réconciliation quasi théraupeutique avec les mots (et les maux) – reconfigure alors avec une aise déconcertante le conte de Cendrillon et le débarrasse de tous bons sentiments greffés dans l’imaginaire collectif.
Ce faisant, Pommerat déjoue les attentes du spectateur et parvient moins à émouvoir par une avalanche d’effets qu’à travers une mise en scène poétique et évocatrice, la finesse de son écriture et la sincérité déstabilisante des personnages – y compris lors d’une reprise d’un tube de Cat Stevens (Father and Son) a priori risquée, mais brillamment tenue. À rebours d’une usine à rêves qui ne cesse d’entretenir le fantasme de ressusciter ses figures tutélaires, l’imaginaire déployé par Pommerat encourage bien au contraire à tolérer l’absence d’autrui et à accueillir cette disparition au fond de soi ; et alors d’accepter, avec joie, une destinée avec la part inévitable de tragique qu’elle recèle.
Cendrillon de Joël Pommerat – Théâtre de la Porte Saint-Martin (Paris 10e), jusqu’au 24 juillet 2022
Billetterie par ici