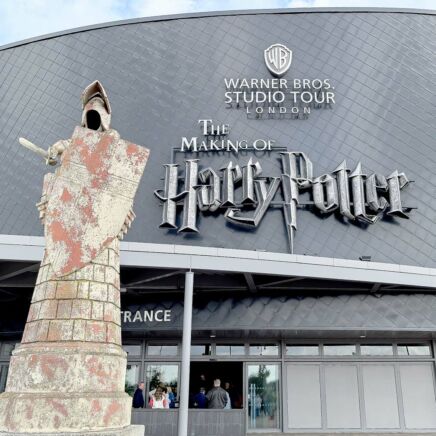Le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du futur, sort dans les salles obscures aujourd’hui, dans la foulée de sa présentation au 75e Festival de Cannes. L’occasion de revenir sur les obsessions qui habitent la filmographie du réalisateur canadien.
David Cronenberg fascine autant qu’il déroute, séduit autant qu’il repousse, passionne autant qu’il sème le doute et la discorde. Ses films ont, sous leur couche indéniablement provocatrice, une immense propension à produire de la réflexion, des discours féconds et invitent à s’engouffrer des dédales d’analyses. Les images qui s’en dégagent – l’explosion d’un crâne dans Scanners (1981), l’interpénétration d’un corps avec un plasma télévisuel dans Videodrome (1983), une embuscade sanglante dans des bains turcs dans Les Promesses de l’ombre (2007) ou une simple tâche de sang sur un canapé immaculé dans Maps to the Stars (2014) – impriment durablement l’imaginaire qu’elles rencontrent et conservent toujours quelque chose de résolument contemporain, comme si elles rattrapaient sans cesse la réalité d’un côté ou de l’autre, trouvant systématiquement une nouvelle brèche dans laquelle s’insérer.
Qu’on apprécie ou non les films de Cronenberg, les images dont ils accouchent restent en tête. Il arrive qu’un film vieillisse, pour le meilleur comme pour le pire ; le cinéma de David Cronenberg, qui n’a sans doute pas donné naissance qu’à des chefs-d’œuvre, ne vieillit pas comme les autres : il trouve toujours un écho avec le monde contemporain. C’est un cinéma qui évolue – qui mute, devrait-on dire au vu de sa filmographie – à mesure que de nouvelles interprétations en jaillissent. C’est peut-être la particularité de son cinéma : comme tout stimulus appelant à une réaction, les films de Cronenberg ne laissent jamais indifférents, car ils excitent le sens moral et provoquent des réactions pour le moins épidermiques, dans tous les sens du terme. Et provoquer une réaction, c’est sans doute tout ce qui importe à Cronenberg.
Corps transformés, morale transgressée
Il n’avait plus sorti de film depuis Maps to the Stars, qui a valu à Julianne Moore un prix d’interprétation au Festival de Cannes. Le réalisateur, né à Toronto en 1943, y prenait un malin plaisir à dépeindre un Hollywood névrosé, à bout de souffle et décadent. Dans cette usine à rêves à court de carburant, Cronenberg livrait un de ses films les plus cyniques et féroces, point culminant d’une période où le cinéaste a peu à peu mis de côté l’imagerie horrifique qui a fait sa renommée – plus de mutations visibles, de contaminations ou d’hybridation des corps, plus de plaies béantes à scruter – pour s’installer dans une esthétique chirurgicale et corrosive, comme si le réalisateur pénétrait une entaille plus profonde, moins charnelle, s’attaquant à quelque chose comme l’inconscient d’une époque, quitte à retourner, dans A Dangerous Method (2011), à la source même des théories psychanalytiques dont sont imprégnés ses films.

Après cette longue attente, qui a conduit certains à penser que Cronenberg avait tout simplement pris sa retraite après avoir exploité tout le potentiel que lui offrait le cinéma, un peu comme David Lynch en son temps – son dernier film, Inland Empire, remonte à 2006 et aux dernières nouvelles le réalisateur de Twin Peaks et Mulholland Drive n’est pas prêt de repasser derrière la caméra –, le cinéaste canadien est finalement revenu sur le devant de la scène avec un nouveau film, Les Crimes du futur, qui laisse à penser que Cronenberg n’en a pas réellement fini avec le « body horror », genre aux contours assez flous dont il est malgré lui devenu l’un des protagonistes au carrefour des années 1970-1980.
C’est à cette époque que Cronenberg fait ses gammes dans le cinéma underground canadien. Dans ses premiers longs-métrages expérimentaux et réalisés avec les moyens du bord, comme Stereo (1969) et Crimes of the Future (1970) – qui n’a pas grand-chose à voir avec le film homonyme que l’on peut découvrir aujourd’hui – le réalisateur affûte ses outils et développe les thématiques qui reviendront plus tard dans ses films plus affirmés. Viendront ensuite les films estampillés « body horror » comme Frissons (1975), Rage (1977) ou Chromosome 3 (1979) qui, bien que manquant encore de moyens et frisant allègrement avec le cinéma d’exploitation, font néanmoins parler d’eux et animent les débats.

On y repère pêle-mêle les motifs récurrents de sa filmographie : une sexualité déviante corrélée à un acte « fondateur » de contamination virale, à l’instar du parasite infectant les habitants d’un immeuble soudainement pris d’une étrange fièvre sexuelle dans Frissons, les traumatismes psychiques – Chromosome 3, où les troubles mentaux des patients prennent la forme d’excroissances et autres matières organiques –, les mutations corporelles, comme l’organe vampirique qui pousse sous l’aisselle de la protagoniste de Rage, ou plus largement l’exploration de nouvelles formes de jouissance et ce rêve d’une « nouvelle chair », comme le prophétise le personnage de Max Renn (James Woods) dans Videodrome.
Par-delà bien et mal
C’est sans doute à partir de Scanners (1980), son premier véritable succès commercial, que le cinéma de Cronenberg se pare rétrospectivement d’une couche plus intellectuelle et philosophique. La question des rapports entre le corps et la technologie, doublée d’un jeu sur la frontière de plus en plus floue entre réalité et fantasme, s’immisce progressivement dans ses films – comme Videodrome, dans lequel le personnage de Max Renn se voit pousser un lecteur VHS dans son propre abdomen, ou encore dans La Mouche (1986) avec Jeff Goldblum, qui demeure à ce jour le plus grand succès du réalisateur au box-office.
Cronenberg restera cependant toujours assez méfiant vis-à-vis des studio et ce, malgré quelques propositions alléchantes. Il déclina Le Retour du Jedi et plancha un temps sur l’adaptation de Total Recall (finalement réalisée par Paul Verhoeven). Malgré la reconnaissance, Cronenberg s’est toujours refusé à la tentation du mainstream. Ses films amorcent alors une réflexion sur de nouveaux modes possibles d’existence : à travers leurs mutations, les corps atteignent un autre niveau de réalité, s’affranchissent des valeurs morales traditionnelles, découvrent un autre rapport au monde et à soi à travers par la rencontre on ne peut plus physique entre l’humain et la machine.

Avant que la « viralité » propre à son cinéma ne prenne, au début des années 2000, un virage plus psychologique, Cronenberg n’a eu cesse d’étayer sa fascination pour ce qui transforme les êtres de l’intérieur, ne cédant jamais au gore facile et passant plutôt par la représentation d’êtres hybrides, issus ou non de l’imagination de ses personnages. Que l’on songe à La Mouche et à la transformation quasi « jouissive » de Seth Brundle en mouche géante, à Faux-semblants (1988), dans lequel Jeremy Irons incarne des jumeaux chirurgiens fantasmant un concours de beauté pour organes, au Festin nu (1991), adapté du roman phare et pourtant réputé inadaptable de William S.Burroughs – qui a eu une influence de premier ordre sur le cinéaste – ou encore à eXistenZ (1999), dans lequel le passage vers le monde virtuel suppose le raccordement à une console de jeu organique… Les personnages cronenberguiens ne sont jamais passifs et évoluent en symbiose avec ce(ux) qui se greffe(nt) sur eux.
Refoulé à l’entrée
Cet intérêt prégnant du réalisateur pour la maladie, la contamination et l’altération de l’organisme renvoie moins à une forme de désagrégation et de nihilisme qu’à un événement créateur, voire libérateur. « Chez Cronenberg, la maladie permet au corps de se transformer et de se réinventer », relève Fabien Demangeot dans l’essai qu’il a consacré au cinéaste (La Transgression selon David Cronenberg, éd. Playlist Society). Alors, pas de quoi s’étonner lorsque le cinéaste décide de mettre aux enchères – sous forme de NFT – ses propres calculs rénaux ; lorsqu’il se met en scène en train d’enlacer sa propre dépouille ; ou encore quand il affirme, dans son premier roman (Consumés, éd. Gallimard, 2016), que « la philosophie est une chirurgie ; la chirurgie une philosophie » – un credo que semble rejouer son nouveau film, dans lequel le personnage de Kristen Stewart murmure que « la chirurgie est le nouveau sexe ».

Un film comme Crash (1996) signe sans doute l’aboutissement de ce travail chirurgical de Cronenberg ; l’esthétique devient plus radicale, plus abrasive. Dans cette adaptation du roman de J.G. Ballard, qui défraya la chronique lors de sa présentation au Festival de Cannes, le corps accidenté et mutilé va jusqu’à devenir un pur objet de plaisir pour des personnages évoluant dans un monde aseptisé, où seules les surfaces métalliques des voitures et les cicatrices semblent pouvoir redonner corps au désir. « Crash marque pour Cronenberg le passage vers une forme d’abstraction onirique et mentale », constate Olivier Père, directeur cinéma d’Arte, dans le petit ouvrage consacré au film (Crash, rêves d’acier, Carlotta Films) à l’occasion de sa ressortie en 2020.
« Cronenberg parvient à créer une mythologie des corps accidentés. »
Olivier Père
Il est vrai que Crash a marqué un virage somme toute logique dans l’œuvre Cronenberg au tournant des années 2000. Celui-ci semble à première vue moins subversif, car dépouillé de la science-fiction et de la texture si particulière des éléments fantasmagoriques qui ont fait la saveur de ses précédents longs-métrages. Le cinéaste n’en demeure pas moins guidé par l’obsession d’ausculter l’intériorité de ses personnages : de Spider (2002) à Cosmopolis (2012) puis Maps to the Stars, le cinéaste continue ainsi de sonder les tréfonds de l’âme humaine. Son cinéma se fait plus théorique et clinique – allant jusqu’à rejouer la relation conflictuelle entre Jung et Freud dans A Dangerous Method –, pour ne pas dire assez pessimiste, sur la modernité.
Plus de mutations et de protubérances donc, mais la déflagration tout aussi puissante de pulsions et de névroses profondément enfouies ; après le corps humain, Cronenberg s’est attelé à radiographier le corps social et à en exhumer la violence latente comme dans History of Violence (2005), sans aucun doute l’un de ses plus grands films.

Que Cronenberg revienne aujourd’hui à un cinéma plus organique – ce que semble également indiquer The Shrouds, son prochain projet de thriller dystopique avec Vincent Cassel – est au fond moins étonnant qu’intrigant ; doit-on y voir le signe avant-coureur d’une inspiration retrouvée sur le fond comme sur la forme chez un cinéaste appelé par un horizon thématique brûlant, ou bien la tentation du confort théorique et de l’autocitation ? Car que pourront bien dire Les Crimes du futur que les précédents films de Cronenberg n’ont pas déjà dit en substance sur la dégénérescence de l’homme moderne ? On ne tardera pas à le découvrir.