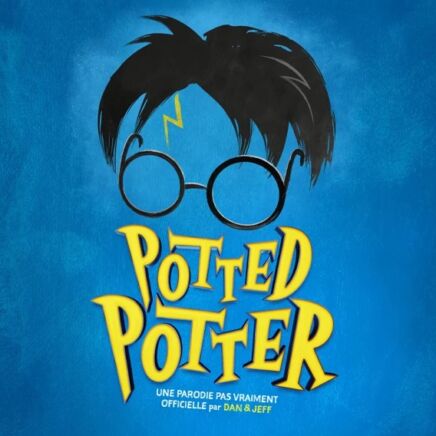Après Coming Out, son premier seul-en-scène devenu un phénomène, Mehdi Djaadi revient avec Couleur framboise, un spectacle intime, politique et profondément humain. L’humoriste et comédien y explore notamment l’infertilité masculine, la masculinité contemporaine, ainsi que la foi. À cette occasion, L’Éclaireur a rencontré l’artiste pour parler de son processus créatif autant que d’engagement.
Comment est né ce deuxième spectacle ?
Après Coming Out, dans lequel j’abordais la foi et la religion, je m’étais promis de remonter sur scène seulement si une urgence s’imposait. L’idée n’était pas de faire de ma propre thérapie sur scène, mais l’infertilité masculine m’a traversé de plein fouet et, après en avoir parlé dans une interview, j’ai reçu des centaines de témoignages. J’ai compris que tout le monde était touché, directement ou dans son entourage. À partir de ce vécu, j’ai relu ce que cela questionnait en moi et j’ai vu une matière immense pour interroger la société, bien plus large que la seule infertilité.
Vos deux spectacles abordent finalement des sujets qui semblent tabous. Est-ce une coïncidence ou une véritable intention par rapport à votre univers ?
Je ne choisis pas un sujet parce qu’il est tabou. Je viens du théâtre classique, j’ai été formé à Lausanne. Mes références, ce sont Raymond Devos, Pierre Desproges, Coluche, bien que je sois de la même génération que Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze, par exemple. Mais un artiste écoute ce qui traverse le monde. Ici, l’urgence était là. Et j’avais envie de montrer aussi qu’un artiste racisé peut investir un terrain plus théâtral, plus littéraire, pas seulement pour “faire des blagues”.
Très souvent, en tant que comédien, déjà au cinéma, il y a une frustration d’avoir toujours les mêmes rôles qui nous sont proposés. Au théâtre, on a l’impression qu’une personne racisée sur scène ne fait que de l’humour, ne fait que du stand-up. J’avais donc envie de mettre l’humour au service de quelque chose de plus théâtral, de plus écrit, de plus profond. Couleur framboise est un spectacle où l’on rit et où l’on pleure. C’est un ovni qui montre aussi que je suis un amoureux de la langue française, et dans lequel il y a de l’humour autant que des enjeux intimes.

Justement, comment trouvez-vous l’équilibre entre humour et émotion ?
Le seul-en-scène permet de proposer quelque chose qui est à mon image. J’aime la proximité avec le public, mais aussi la composition : j’incarne une trentaine de personnages, chacun avec sa musique. Avec mon coauteur et metteur en scène, Thibaut Évrard, on a mêlé punchlines presque rap, envolées poétiques et travail musical sur les mots. Notre exigence vient du théâtre, de la scène : la dramaturgie est très importante, chaque mot et chaque accent tonique comptent. On a un amour pour la langue française et sa richesse fait que l’on peut jouer avec.
Quel travail de recherche effectuez-vous pour vos personnages ? Comment éviter la caricature quand on joue avec des accents ou des archétypes ?
Par la recherche et l’intention. J’observe, je construis une histoire pour chacun et je travaille leur manière de parler. Il y a l’observation et la recherche intellectuelle. On m’a reproché de faire des accents dans mon premier spectacle, car cela pouvait être associé à de la glottophobie, alors que les personnes concernées riaient avec moi. Mais j’ai pris le problème à l’envers, car j’ai un rapport populaire à l’accent. C’est presque un langage de l’amour de se parler et d’imiter les accents de ceux qui nous entourent.
Dans Couleur framboise, je demande même au public s’il veut la version avec ou sans accent. Quand j’incarne un moine burkinabé, je commence à la frontière du cliché, puis j’entre dans une incarnation profonde. Je travaille les nuances entre les différentes régions du Burkina de façon à ce que, si le public ferme les yeux, il voie le personnage. Interdire les accents au nom du progressisme peut devenir une forme de néopaternalisme. Cela reviendrait à m’empêcher d’incarner mon père, mon oncle ou d’autres personnages racisés qui existent réellement.

Est-ce que vous avez hésité à demander l’avis du public sur l’usage des accents dans votre spectacle ?
Pas vraiment. Lors de mon précédent spectacle, l’une des personnes dont j’imitais l’accent – une amie antillaise – trouvait ça très drôle et ne s’en plaignait pas du tout. Elle avait même participé aux représentations. Cela m’a montré qu’il existe souvent un décalage entre les discours idéologiques et la réalité vécue.
Pour le nouveau spectacle, on s’est donc demandé si on devait continuer à faire les accents. Finalement, on a décidé de laisser le choix au public à chaque représentation. Je suis tout à fait prêt à jouer sans accent si la majorité le souhaite, mais j’aimerais comprendre pourquoi. Parce qu’à force de vouloir “protéger”, certains finissent par dire à des personnes comme moi – fils d’ouvriers et d’immigrés – ce qu’elles ont le droit de faire ou non, ce qui devient une forme de néopaternalisme ou de néocolonialisme. Alors que chez nous, faire des accents a toujours été quelque chose de normal et d’amusant.
« En tant qu’homme, j’aime cette idée d’être une présence discrète, silencieuse, dans un espace où nous avons parfois tendance à trop parler. »
Mehdi Djaadi
Le thème du spectacle est l’infertilité masculine, la vôtre en l’occurrence. Était-ce difficile de livrer autant d’intimité sur scène ?
J’ai un mantra quand je travaille : “Comment l’intime peut rejoindre l’universel ?” L’histoire parle d’un homme empêché de devenir père. Cela interroge la masculinité, la foi, la médecine, la paternité. Beaucoup d’hommes se posent ces questions aujourd’hui. L’infertilité est presque toujours pensée comme un “problème de femmes”. Je voulais interroger cette violence symbolique. Au début, j’ai eu peur d’être trop personnel – même ma femme a censuré des passages ! Mais les retours du public m’ont rassuré : ce spectacle parle à tout le monde.
Peut-on dire que Couleur framboise est un spectacle engagé ?
Oui, je pense qu’il est profondément politique et rassembleur, mais pas au sens militant. Mon travail consiste à poser des questions, pas à fournir des réponses toutes faites, alors qu’aujourd’hui, beaucoup de gens attendent justement des positions claires et radicales, des étiquettes. Comme je refuse ces cases, j’ai souvent l’impression de ne jamais être vraiment “à ma place”.
Mon spectacle défend au contraire la nuance : c’est un spectacle fédérateur, une ode à la vie. Pour moi, l’engagement de l’artiste se situe là : dans la réflexion, dans le fait de créer un espace où les gens pensent, rient, s’aiment. C’est déjà beaucoup. Militer explicitement, prendre parti à droite ou à gauche, ce n’est pas mon rôle – du moins pas aujourd’hui. Quand je m’engage, comme parrain d’un mois de sensibilisation, par exemple, c’est autre chose. Donc oui, le spectacle est engagé et interroge, mais il n’est pas militant au sens strict.
Justement, vous mentionnez votre rôle en tant que parrain du mois de sensibilisation à l’infertilité. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
J’ai été profondément ému. D’abord parce que le collectif BAMP a été pour moi une ressource précieuse à une période où je me posais énormément de questions et traversais des étapes difficiles. Rien que pour ce soutien-là, j’aurais accepté sans hésiter.
Mais il y a deux autres raisons essentielles. La première, c’est le fait d’être un homme. On associe encore trop souvent l’infertilité uniquement aux femmes. En acceptant d’être parrain, je voulais montrer, à titre personnel, que les hommes doivent aussi se sentir concernés et soutenir cette cause. C’est important d’envoyer ce signal : nous sommes là, nous vous soutenons.
La seconde raison concerne mon métier d’artiste. Le mois de sensibilisation ne se résume pas aux conférences, webinaires et tables rondes ; il y a aussi toute une programmation culturelle autour du sujet, avec de nombreux spectacles. Cela touchait des thèmes qui me parlent beaucoup en ce moment. Si ma visibilité ou ma présence peuvent aider, même modestement, j’en suis heureux.

J’aime d’ailleurs beaucoup le mot “parrain”. Pour moi, un parrain accompagne, soutient, sans forcément occuper la parole. Et en tant qu’homme, j’aime cette idée d’être une présence discrète, silencieuse, dans un espace où nous avons parfois tendance à trop parler. Être là, simplement, pour dire : “Je vous soutiens”, sans bruit, mais avec constance.
Qu’avez-vous appris grâce à ce spectacle que vous ne saviez pas en faisant Coming Out ?
Que l’alchimie avec Thibaut Évrard est réelle. On écrit vite, on se comprend, on se complète. On est devenus amis. Trouver un binôme comme ça, ça change tout.
Et la suite ? Un troisième spectacle ?
Pas pour l’instant. Couleur framboise démarre à peine : je veux le jouer longtemps, partout, parce qu’il fait du bien dans une période très lourde. Je travaille aussi avec d’autres artistes sur leurs spectacles, et j’ai un film, L’abandon de Vincent Garenq, qui sort l’année prochaine. Mais, pour un troisième spectacle, j’attends l’urgence.
Couleur framboise, de Mehdi Djaadi jusqu’au 11 décembre 2025 au Studio des Champs Élysées, du 7 février au 12 mars 2026 en tournée dans toute la France, ainsi qu’à la Scala, à Paris, à partir du 24 janvier 2026.