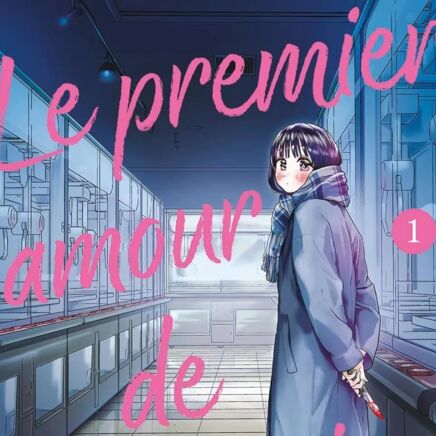Les gamers connaissent tous les déboires du jeu Cyberpunk 2077 qui, à sa sortie, a porté la déception à la hauteur des longues années d’attente et de la hype du public. Alors que CD Projekt RED n’en finit plus d’apporter des améliorations au jeu, le studio Trigger et Netflix lancent son adaptation animée, qui réalise le tour de force de rester fidèle à l’univers original tout en visant un public plus large. Une réussite.
Cyberpunk: Edgerunners est-elle une série pour gamers ? Entendons-nous bien : nul besoin de connaître le jeu pour apprécier la série animée – même si les fans de la première heure devraient frétiller davantage. Car si, d’un point de vue esthétique, Trigger apporte ses propres choix, il se montre généreux en clins d’œil et autres références qui renvoient directement au matériau d’origine. À commencer par la palette sonore, de la sonnerie des appels téléphoniques (aussi reconnaissables que celle des téléphones d’une série mythique, 24 Heures chrono) à certains titres de la bande-son du jeu, en passant par le design des véhicules et des armes, sans oublier l’apparition de certains personnages du jeu, intégrés de manière intelligente dans le récit.

Des repères pour les gamers
On ne les nommera pas pour préserver la surprise, mais il y en a une de taille, puisque l’un de ces protagonistes occupe un rôle déterminant dès son entrée en scène. Les gamers retrouveront leurs repères dans l’appartement du héros (le même que dans le jeu), mais aussi dans la ville elle-même : Night City.
Dans cette mégalopole tentaculaire et impitoyable, les grandes multinationales se livrent une guerre sans merci, au milieu des différents gangs qui y pullulent. Véritable personnage à elle seule, la cité que tout joueur a passé des dizaines d’heures à arpenter s’offre au spectateur dans toute sa démesure.

Le jeu fonctionne sur un monde ouvert que l’on découvre au gré des missions, mais, ici, le récit nous prend par la main et la visite guidée s’effectue au fil des péripéties des personnages principaux. Ils nous mènent dans divers lieux familiers, comme l’Afterlife, ce club où l’on prend commande de nouveaux contrats, la tour Arasaka, scène de théâtre idoine pour un combat final, ou encore le désert qui s’étend à l’extérieur de la ville.
Sexe, drogue et rock’n’roll
Pour le reste, aucun néophyte n’aura le sentiment d’avoir devant lui une adaptation, mais plutôt un univers cohérent, avec ses propres codes, sa propre grammaire, sa propre cosmogonie. Ce qu’on attend d’une œuvre de fiction, surtout dans le genre de la dystopie. Il ne se rendra pas compte, par exemple, que les shoots de médicaments que s’envoient les personnages pour atténuer les effets secondaires de chaque nouvelle greffe d’amélioration mécanique ou d’implant électronique dans le corps rappellent aux gamers les injections pour rehausser la jauge de vie de leur avatar. Malin. Car la grande force du jeu (malgré ses moult défauts), comme celle de la série, réside dans l’écriture de leurs scénarios respectifs. L’un résonne avec l’autre.

Dans le jeu, l’histoire est extrêmement sombre avec ses différentes fins mélancoliques et douces-amères. Du reste, elle se montre très rock’n’roll. Les chapitres de sa trame portent pour titres des chansons de l’histoire du rock, de Gimme Danger (les Stooges) à Where is my Mind (Pixies), en passant par For whom the Bell Tolls (Metallica). Lorsque vous circulez dans la ville, vous pouvez zapper, à bord de votre véhicule, sur différentes stations de radio à la programmation bien fournie et de bon aloi. Enfin, l’un des personnages principaux, campé par Keanu Reeves, est lui-même le chanteur charismatique d’un groupe de rock célèbre, Samurai. Dans la réalité, c’est le groupe Refused qui signe son répertoire.

La série, elle, s’offre les services de Franz Ferdinand pour la chanson du générique, le reste de la BO étant confié à Akira Yamaoka, célèbre pour son travail sur les jeux Silent Hill.
Résolument adulte, l’adaptation adopte cet esprit rock en servant des plans de nudité – sans jamais sombrer dans la vulgarité ou le racolage facile –, ainsi que des scènes d’action à la violence graphique explicite, dans une ambiance où le tragique se mélange à un humour bien dosé, servi par des dialogues et des personnages tous aussi charismatiques et badass les uns que les autres. Les têtes et les cages thoraciques explosent, les boyaux répandus et les yeux crevés tapissent les murs, et le tout finit en bouillie colorée.
L’esthétique du studio Trigger se démarque d’ailleurs par une large palette de teintes criardes, du jaune au rouge, en passant par toute la gamme du fluo et, comme le rythme du récit se révèle soutenu et que les bastons et autres courses-poursuites s’enchaînent à intervalles réguliers, toutes ces couleurs se mélangent dans des tourbillons à en donner le vertige. Car ça va vite, dans Cyberpunk: Edgerunners. À tel point que la série affiche un avertissement pour les personnes sujettes à l’épilepsie.
Une réussite totale, du scénario à la réalisation
Cyberpunk: Edgerunners raconte, en dix épisodes de 25 minutes chacun, l’histoire de David, enfant des rues qui compte se faire une place en devenant un Edgerunner, un mercenaire hors-la-loi, après sa rencontre avec la belle Lucy, une Netrunner (capable de pirater tout système informatique) aussi séduisante que mystérieuse. Dès la scène d’ouverture, le ton est donné. Un cyberpsycho (un homme devenu psychopathe à force de transformer son corps en abusant de la technologie) commet un massacre à l’aide d’un implant militaire expérimental. Un fait divers qui va sceller le destin de David.

Dans le jeu, on incarne V, un·e habitant·e de Night City entraîné·e dans une spirale tragique. L’intelligence de la série réside notamment dans son choix de raconter l’histoire d’un tout autre personnage, créé spécialement pour l’occasion, en utilisant les codes du jeu, de ses décors à ses styles vestimentaires, en passant par le jargon local : il faudra un petit temps d’adaptation pour intégrer des vocables comme choom, charcudoc ou encore paumard.
Si son histoire n’a rien à voir avec celle du jeu, on comprend le génie des scénaristes : exploiter le vivier de son univers en piochant dans la population de la ville un destin parmi tant d’autres. À partir de ce choix narratif, rien n’empêche les showrunners de récidiver, soit en se penchant sur l’avenir des survivants (car tous les protagonistes ne sortent pas indemnes de l’aventure), soit en mettant en scène la vie de n’importe quel autre habitant de Night City.
Le monde de la licence Cyberpunk nous montre en filigrane une éternelle lutte des classes qui passe par l’acquisition d’implants aussi coûteux que dangereux pour leur utilisateur. Chaque personnage qui lutte pour sa propre survie devient le rouage d’une histoire plus grande que la sienne. La série réussit le pari de nous attacher à l’une d’entre elles.