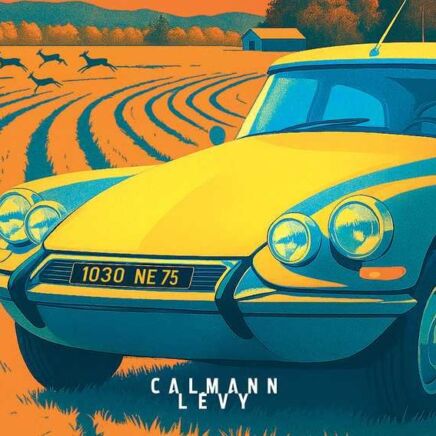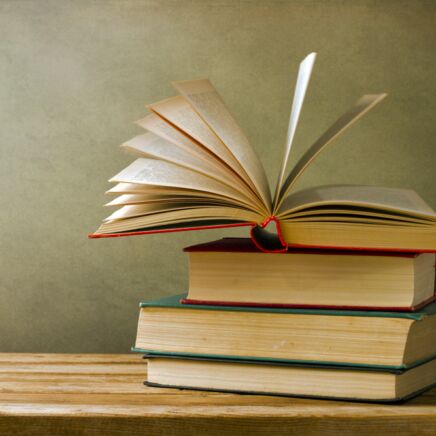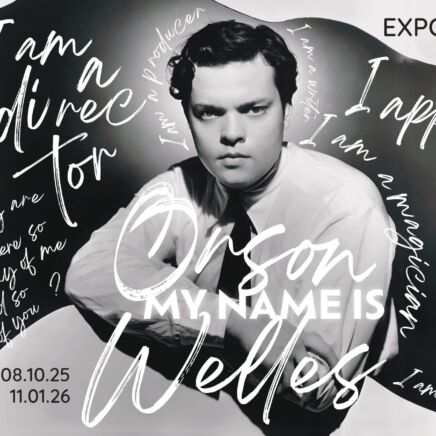Que serait la rentrée littéraire sans ses primo-romanciers ? Focus sur cinq talents émergents qui risquent de faire parler d’eux.
Dénicher les talents de demain, assister à l’éclosion de futurs grands écrivains, être à la fois témoin et acteur d’une nouvelle page littéraire : voilà un des plaisirs avoués du métier de critique. Alors, chaque rentrée littéraire, on scrute les noms encore inconnus, les profils qui détonent, jeunes premiers ou ados rebelles, à la recherche de la perle rare. Car il se passe quelque chose dans la littérature française aujourd’hui. Un bouillonnement, une effervescence, un défi adressé par la jeune génération à la vieille garde du roman.
Du haut de leurs 20 ou 30 ans, des plumes déjà pleines d’assurances, gonflées par une nouvelle forme d’engagement, entendent déstructurer et distordre la langue, dépoussiérer les genres littéraires et décloisonner la littérature pour la confronter aux autres formes artistiques, briser les carcans sexuels et déconstruire les genres, les classes sociales et les métissages pour changer les représentations. Portrait-robot de cinq romanciers et romancières qui ont réussi leur entrée dans la cour des grands.
Célestin de Meeûs, poète deviendra romancier
À la suite d’autres jeunes talents comme Simon Johannin, Marin Fouqué ou Seynabou Sonko, qui ont illuminé les précédentes rentrées littéraires, Célestin de Meeûs donne un dernier coup de masse dans la cloison fragile qui séparait encore les formes et les genres – un mur illusoire qui déclarait qu’on était soit poète, soit romancier et qu’il n’existait pas de forme hybride à inventer. Tout juste récompensé du prix Stanislas, la plus prestigieuse récompense pour un premier roman, preuve que les choses changent aussi au sein des jurys, Mythologie du .12 (comprenez calibre 12, la plus courante des munitions utilisées dans les fusils de chasse) est un objet littéraire non identifié qu’on imagine bien avoir été conçu dans un mystérieux laboratoire. Mais Célestin de Meeûs n’a rien de l’inventeur fou. Voyez plutôt un amoureux obsédé par le verbe qui s’amuse à modeler sans cesse les mots et les phrases pour les emmener dans des contrées encore inconnues.

Son roman s’étire sur seulement quelques heures, une soirée de juin. Dès la première page, un troublant jeu de miroir entre deux existences qui vacillent. Théo, un adolescent qui vient d’en finir avec le lycée, ne sait pas quel sens à donner à sa vie. Avec son pote Max, il zone dans une vieille Clio sur le parking d’un supermarché et refait le monde à coups de bières et de joints. Le docteur Rombouts, lui, ressasse en s’imbibant de whisky les erreurs impardonnables qui ont fait fuir sa famille.
On pressent que la rencontre entre ces deux êtres égarés est inévitable, qu’elle risque fort de faire des étincelles et l’on ne s’y trompe pas. Soudainement, le récit bascule, sa construction aussi, le fond épouse la forme, et le drame pointe le bout de son nez comme le symbole tragique de cette violence incontrôlable qui s’est emparée de la société. À couper le souffle.
Eliot Ruffel, enfant précoce
Le coup de bambou. Le coup de vieux surtout, quand on découvre la date de naissance d’Eliot Ruffel sur le site de son éditeur. Né en 2000. 24 ans et déjà un premier roman comme un uppercut dans cette rentrée littéraire. Dans un texte court, fulgurant, le natif de Saint-Étienne, tout juste diplômé du prestigieux master de création littéraire du Havre, tord le cou avec talent au récit d’apprentissage, poncif des poncifs romanesques. On ressort de ce texte unique en son genre avec des images plein la tête. Car, pour raconter le passage à l’âge adulte de deux adolescents désœuvrés, Eliot Ruffel, également photographe et vidéaste, fait le pari des regards et des instantanés plutôt que celui des grandes aventures picaresques.
View this post on Instagram
Max et Lou boivent des bières en contemplant la mer, transforment le spleen en terrain de jeu, arpentent une ville portuaire de Normandie, sous une chaleur de plomb, à la recherche d’une façon d’être au monde et d’être entre eux. À la manière d’un David Lopez, à qui l’on doit Vivance, le jeune romancier fait de l’ennui un improbable terreau littéraire. Il ne se passe pas grand-chose dans Après ça, mais les plans s’enchaînent et marquent durablement le lecteur. Le premier romancier de la Gen Z est né et il chante la complainte douce-amère d’une génération désenchantée.
Virginia Tangvald écume les souvenirs
« Le Barbe bleue des mers » – en référence au conte populaire, dont la version la plus célèbre est celle de Charles Perrault, cette histoire tragique où un homme aux allures d’ogre épouse puis tue plusieurs femmes en prétextant un interdit violé –, voilà un surnom qui vous pose un homme. Cet homme, c’est Peter Tangvald, un navigateur norvégien qui s’est fait un nom à coups d’exploits et de traversées. Mais, comme beaucoup de ces trompe-la-mort, l’aventurier n’a jamais su s’arrêter. Dans son sillage gisent les cadavres de celles qui ont bien voulu l’accompagner.
Quand le livre commence, en juillet 1991, Peter Tangvald vient de disparaître dans un naufrage funeste avec sa fille, une victime de plus. Virginia, son autre fille qui ne l’a pas connu, l’autrice et narratrice de cette histoire, décide, en apprenant la nouvelle, de percer à jour les secrets de cet homme mystérieux et rentre en contact avec l’unique survivant du drame, son demi-frère Thomas, héritier tragique de son père qui, des années plus tard, mourra lui aussi en mer.
On embarque avec elle dans une folle enquête sur les traces d’un navigateur qui a fait de la mer son unique horizon ; on partage le combat de cette fille bien décidée à mettre des mots sur sa filiation. Un livre bouleversant qui pourfend les illusions dangereuses de la liberté. Qui, à force d’être brandie à tort et à travers comme un bouclier, n’est plus un idéal, mais une malédiction.
Ruben Barrouk, un silence assourdissant
Aux côtés de Zineb El Mekouar (qui nous a offert un des romans du printemps, le très réussi Souviens-toi des abeilles), d’Abdellah Taïa (Le Bastion des larmes) ou encore d’Abigail Assor (La Nuit de David) – tous deux présents en majesté dans cette rentrée littéraire –, Ruben Barrouk incarne toute la vitalité de la littérature marocaine, incessante pourvoyeuse de jeunes talents, dans Tout le bruit du Guéliz, nommé au prix Goncourt 2024. Si, à la différence des trois autres, il est né en France, son premier roman nous ramène dans le pays de ses origines, sur les traces de sa grand-mère, juive séfarade installée à Marrakech.
Depuis quelque temps, cette dernière est tourmentée jour et nuit par un bruit sourd et incessant. Inquiets, Ruben Barrouk et sa mère font le voyage pour comprendre le mal qui la ronge, mais, sur place, ils n’entendent rien. Aucun signe de « l’odieux tortionnaire ». On découvre plutôt une femme haute en couleur, gardienne d’une tradition en train de disparaître, dialoguant avec les morts autant qu’avec les vivants. Ce ne sont que les bruits des souvenirs et les appels des fantômes qui assaillent Paulette. Et le narrateur de se laisser embarquer dans un pèlerinage intime sur les traces de la mémoire juive marocaine, au-devant d’un pays qui, en galopant à tout crin vers la modernité, met à mal son identité.
Alice Develey, le poids des mots
C’est toujours avec appréhension qu’on ouvre le livre d’un confrère ou d’une consœur. On ne sait jamais ce qu’on va y trouver, on se refuse à jouer le jeu des connivences ou des amabilités ; parfois, même, on se cache derrière des silences gênés. Alors, quel soulagement quand on tombe sur un livre bouleversant comme celui d’Alice Develey ! Parce qu’on peut célébrer le talent d’une écrivaine sans aucune espèce d’arrière-pensée. Si Tombée du ciel frappe en plein cœur, c’est peut-être justement parce que son autrice ne triche pas avec le lecteur. Elle se met à nu pour raconter une adolescence douloureuse passée à combattre l’anorexie.
« Tombée du ciel » sort ce jeudi 22 août ! pic.twitter.com/IWZFUnrjO8
— Alice Develey (@AliceDeveley) August 22, 2024
Le livre raconte l’histoire d’Alice, une adolescente de 14 ans, internée du jour au lendemain dans un service de pédopsychiatrie. Une enfant attachée à son matelas, gavée à l’aide d’un tuyau qu’on lui a introduit dans le corps sans aucune forme de préparation et qui se débat pour ne pas sombrer dans la folie. Alice Develey n’écrit pas sur elle, mais à partir d’elle pour conjurer un traumatisme et offrir une épaule à celles et ceux qui sont rongés par ce mal pernicieux. Avec une poésie déchirante et brutale, elle lance un appel pour que cessent ces traitements forcés d’une violence rare. Un incontournable de cette rentrée littéraire !