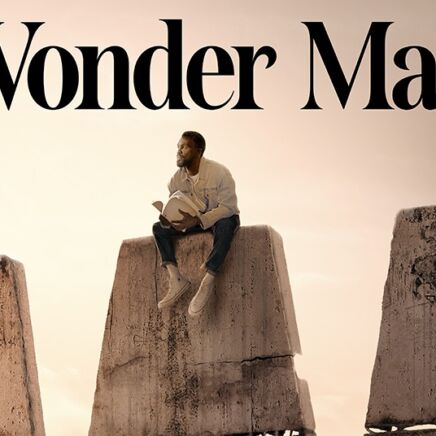Courteney Cox est de retour dans le genre horrifique. Déjà à l’affiche du nouveau Scream, la star de Friends incarne une mère de famille en crise dans Shining Vale. Une série entre horreur et comédie, qui interroge l’épanouissement des femmes du XXIe siècle.
« Les femmes sont environ deux fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de dépression. Elles sont aussi deux fois plus susceptibles d’être possédées par un démon… » C’est par ces mots, typographiés à l’écran, que commence Shining Vale. Les symptômes des deux « pathologies » sont en tout cas très similaires, et l’autodiagnostic de Patricia “Pat” Phelps s’en retrouve dans le flou.
Quand cette écrivaine de romans érotiques en mal d’inspiration trompe son mari Terry avec un homme à tout faire, le couple décide de quitter son appartement de Brooklyn, accompagné de ses deux ados, Gaynor et Jake. Leur destination : un vieux manoir victorien de Shining Vale, banlieue lisse et bien sous tous rapports du Connecticut. Là, le ménage espère se donner une seconde chance. Mais ce projet de nouveau départ va être mis à mal par les esprits qui hantent les lieux, et que Pat est la seule à voir… Ou peut-être à imaginer ?
Possession versus maladie mentale
Parce que tout le problème (et l’intérêt de la série) est là : impossible de savoir si Patricia est effectivement tourmentée par des esprits errants ou simplement par le sien, en proie à la maladie mentale. En chemin vers sa nouvelle demeure (les plans de la route tortueuse vue depuis le ciel sont d’ailleurs un clin d’œil bien vu au film Shining de Stanley Kubrick, qui a sans doute aussi inspiré le nom de la série), la quinquagénaire est prise de visions inexplicables. Elle entrevoit d’abord la petite Daisy, une enfant joueuse, avant d’apercevoir Rosemary (référence peut-être loin d’être anodine, cette fois, à Rosemary’s Baby, le film horrifique de Roman Polanski), archétype charismatique de la femme au foyer américaine des années 1950.
Mais il n’y a pas que les apparitions. Pat entend aussi des airs de musique rétro et des bruits de pas, les lumières clignotent autour d’elle, des ombres l’assaillent… Des événements effrayants que le reste de la famille semble ignorer. Patricia, autrice atteinte du syndrome de la page blanche, doit faire face à l’ultimatum de son éditrice : soit elle écrit, soit elle devra rembourser l’avance sur salaire qui lui a été faite. Au pied du mur, elle fait un pacte avec le fantôme de Rosemary, lui intimant de l’utiliser pour travailler à sa place. Bingo : en quelques heures, elle écrit des dizaines de pages.

Un changement brutal que son mari met sur le compte de l’imagination. Car Terry est loin d’être convaincu par les preuves que lui apporte Pat sur ses rencontres surnaturelles. C’est là que les réalisateurs, Jeff Astrof et Sharon Horgan, jouent de façon jubilatoire avec le public, en multipliant les indices contraires. Un crâne humain est trouvé par Jake dans la forêt jouxtant la maison. Mais, à l’inverse, chaque apparition a une explication logique et rationnelle, chaque bruit étrange provient d’un boulon rouillé, et chaque preuve recueillie par Patricia n’est visible que par elle-même.
Si le doute plane, c’est aussi parce que les symptômes de la supposée possession de Pat (somnambulisme, amnésie, hallucinations) sont également les effets secondaires des nombreux médicaments qui lui sont prescrits. Et que la mère de famille consomme à outrance, grâce aux prescriptions sans limites d’un psychologue incompétent. Parce qu’effectivement, en pleine crise de la cinquantaine, Patricia est frappée de plein fouet par la dépression.
Sous les apparences de la famille parfaite de banlieue chic
La dépression, ou peut-être pire… Dans presque chaque épisode, un jeu de miroir est subtilement glissé dans la mise en scène, sous-entendant que Patricia est peut-être plus malade qu’on ne le pense. Souvent, le reflet du personnage devient le protagoniste, ou se démultiplie dans plusieurs glaces, comme un écho. Elle en vient même à se briser elle-même, en cassant l’écran de son ordinateur qui lui renvoie son image. En proie à un délire paranoïaque à la limite de la schizophrénie, Patricia ne sait plus qui elle est.
Ancienne alcoolique, élevée par une mère psychotique, cette femme est en fait terrifiée par l’idée d’hériter des pathologies que sa mère a développées à son âge. Un passé bien caché, même à ses propres enfants. En fait, chaque membre de ce foyer a une part secrète qu’il ou elle essaie de dissimuler. Pat, donc, mais aussi Gaynor, qui réprime sa sexualité débordante derrière une façade de parfaite jeune catholique pour s’intégrer au groupe, Jake, qui camoufle sa timidité en se terrant derrière son casque de réalité virtuelle, ou Terry, qui tente de faire bonne figure face à l’infidélité de sa femme.

Cette part secrète en chacun d’eux fait écho aux mystères du manoir dans lequel ils emménagent, notamment au sous-sol très fifties, dont l’entrée est cachée dans un placard. En fait, la demeure est à l’image de la famille : resplendissante au premier abord, elle est ravagée dans ses recoins les plus profonds. La sonnette cassée, au son inquiétant mais hilarant, dissone d’ailleurs tout autant que les relations familiales des personnages. Mais de l’extérieur, les fausses notes ne s’entendent pas. Dans leur quête d’apparences irréprochables (« On va être tellement normaux que tu ne nous reconnaîtras pas », glisse même Terry à Pat), les parents se perdent dans un délire hilarant de couple parfait tout droit sorti des années 1950. Terry coupe beaucoup, BEAUCOUP de bois, et Patricia devient une mère exemplaire, toujours aux fourneaux et tirée à quatre épingles. Et comme dans leur couple, ils se retrouvent emprisonnés dans cette inquiétante maison.
Quand les femmes s’émancipent de leurs identités préétablies
Celle qui a aussi été emprisonnée dans cette demeure, selon ses dires, c’est Rosemary. Enfermée dans son rôle de femme au foyer, son destin semble tragique. La seule décision qu’elle confie avoir prise librement, c’est celle de mettre fin à sa vie.
Récurrent, le thème de la maladie mentale est abordé sur un ton décomplexé et humoristique rafraîchissant. Les comportements d’autosabotage de Patricia, dans son couple comme dans sa vie professionnelle, sont décrits de façon légère, sans que leur gravité ne soit niée. C’est le cas quand elle oublie avoir modifié le PowerPoint de présentation de son mari, contraint de montrer des obscénités à un groupe de prêtres.
Une légèreté appuyée par une narration vive – les repères chronologiques (jours de la semaine, indications de temps) sont plaqués au nez du public de façon régulière, rythmant les courts épisodes – et par une mise en scène reprenant les codes de l’horreur, sans être vraiment effrayante – le but n’est clairement pas là. Le point de vue de la caméra est en effet plus drôle que terrifiant : l’angle de vision devient celui d’un fantôme qui virevolte dans les couloirs ou celui d’une caméra de surveillance à la Paranormal Activity quand on observe le lit conjugal de nuit et les pérégrinations d’une Patricia somnambule, en vitesse accélérée.

Le scénario est en tout cas porté par une Courteney Cox survitaminée et très amusante dans ce rôle de femme étouffée, qui tente de faire de son mieux sur tous les plans. En vain. Couple vacillant, carrière au point mort, progéniture dénuée de respect et de reconnaissance… Les choses échappent au contrôle de Pat, qui aimerait pourtant tout gérer aussi parfaitement que Rosemary. Mais celle qu’elle prend pour sa muse se révèle moins irréprochable que prévu, et totalement démoniaque.
Certes, le personnage de Patricia ne vit plus dans les années 1950, mais il prouve que la pression est toujours aussi forte pour les femmes. L’esprit diabolique appelé Rosemary, ayant pris possession de Patricia, est en fait l’allégorie du fardeau de la perfection, collé encore et toujours aux femmes, qu’importe leur époque.
Shining Vale, depuis le 6 mars 2022 sur Starzplay.