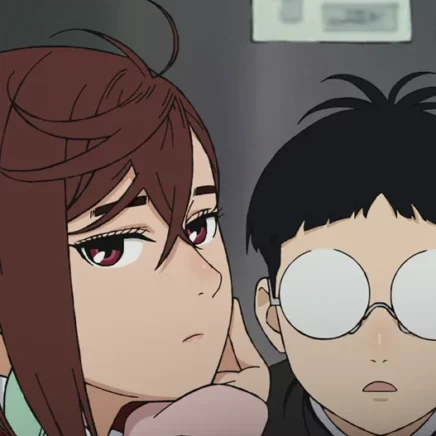Netflix dévoile ce 15 janvier une série d’animation japonaise originale qui mêle romance, art et choc des cultures dans l’Angleterre d’avant-guerre. Séduisante par son cadre et ses intentions, elle laisse toutefois apparaître les limites d’une écriture très codifiée.
Pensée comme une œuvre originale et non comme l’adaptation d’un manga à succès, Le prisme de l’amour marque le retour de la romance historique dans l’animation japonaise. Créée par la mangaka Yōko Kamio (à l’on doit la saga Hana Yori Dango), épaulée au scénario par Saki Fujii, la série se déploie sur 20 épisodes, tous mis en ligne sur Netflix ce 15 janvier. Les trois premiers installent un récit d’apprentissage classique, séduisant par son cadre, mais trop contraint par des archétypes du genre.
École d’art ou promesse d’émancipation ?
Le récit s’ouvre sur l’arrivée de Lili Ichijoin à l’Académie des beaux-arts de Londres. Envoyée par ses parents dans l’Angleterre de l’avant-guerre, la jeune Japonaise dispose de six mois pour faire ses preuves avant d’être rappelée au pays et promise au mariage.

L’école affirme placer femmes et hommes, aristocrates et roturiers, sur un pied d’égalité. Une promesse séduisante, historiquement inexacte, assumée comme un parti pris narratif pour actualiser le propos. Ce décalage installe une tension intéressante, que la série préfère toutefois suggérer plutôt qu’aborder frontalement, faisant de l’institution un décor symbolique plus qu’un véritable espace politique.
Lili, héroïne du récit initiatique
Lili Ichijoin est une héroïne lumineuse, studieuse et déterminée. Toujours enthousiaste, elle découvre l’Occident avec un regard émerveillé, tout en faisant l’expérience d’un décalage culturel. Elle s’engage dans un parcours initiatique balisé, guidé par une seule volonté : devenir la meilleure pour échapper au destin que sa famille lui a assigné. Si le personnage se révèle attachant, son écriture demeure très convenue, frôlant parfois la caricature des protagonistes de shōjo promises à une romance annoncée.

En contrepoint, Kit Church incarne une figure tout aussi identifiable : celle du génie solitaire, taciturne et en retrait. Élève le plus talentueux de l’école, il impose une présence fascinante. Leur rencontre, d’abord fortuite, puis teintée d’une fausse opposition, installe une rivalité appelée à glisser vers le sentimental. Le contraste fonctionne, mais s’appuie sur des mécanismes narratifs largement éprouvés.
L’art du malentendu
Le jeu sur le choc des cultures constitue sans doute l’un des ressorts les plus stimulants de la série. En confrontant le Japon et l’Angleterre, l’anime trouve une manière singulière de nourrir les interactions entre les personnages. Dorothy Brown, camarade exubérante de Lili, cristallise cette fascination teintée de clichés, imaginant tour à tour la jeune Japonaise en samouraï, en ninja ou en experte de shuriken.

Ces écarts irriguent aussi la romance, multipliant les malentendus, les quiproquos et les décalages, tout en ouvrant sur des différences de rapport au corps, à la nourriture ou aux normes sociales. Si la difficulté de s’intégrer dans une nouvelle société est en partie simplifiée – notamment par l’effacement de la barrière linguistique –, ce lissage contribue avant tout à la fluidité du récit.
Une animation appliquée, sans prise de risque
La production est assurée par WIT Studio, sous la direction de Kazuto Nakazawa. Pourtant, on est loin ici de l’animation spectaculaire qui a fait la réputation du studio avec L’Attaque des Titans ou Vinland Saga. Le rendu se rapproche davantage d’une efficacité sage, parfois comparable à Spy x Family.

Quelques séquences laissent entrevoir un potentiel visuel plus ambitieux, notamment dans la mise en scène de la peinture. Les décors de l’Angleterre du début du XXe siècle sont dans l’ensemble réussis, avec cette impression d’un Londres revisité à travers un prisme japonais. L’académie évoque parfois un Poudlard animé. Les personnages, en revanche, affichent des visages souvent trop lisses, pauvres en détails et en variations expressives.
Une série trop prudente
Ces trois premiers épisodes posent les bases d’un récit plutôt plaisant, porté par un cadre original. La mécanique fonctionne, la romance s’installe et l’univers gagne rapidement en lisibilité. Mais cette efficacité tient aussi à une prudence narrative et visuelle qui limite la portée de l’ensemble.
Face à des œuvres comme Blue Period ou Look Back, bien plus audacieuses dans leur manière d’interroger la création artistique, la série surprend peu et peine à s’affranchir de ses modèles. Reste à voir si la suite saura densifier son propos, assombrir ses enjeux et faire de l’art autre chose qu’un élégant décor romantique.