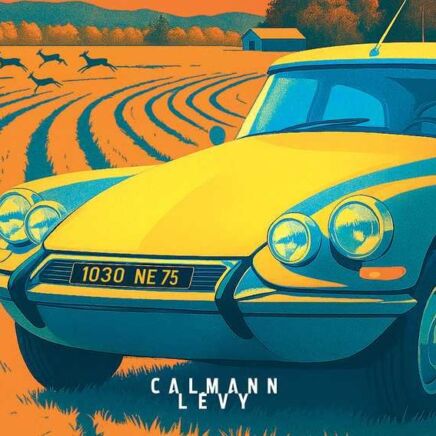La légende raconte que pour finaliser sa mue, un écrivain doit tuer le père. La preuve avec quatre romans éblouissants de la rentrée littéraire.
Au cœur d’une rentrée littéraire qui a fait de la famille, de la lignée, de l’héritage et de la transmission, des traumas et des omissions, les questions brûlantes de notre temps, on voit fleurir les sagas familiales et les récits intimes qui traversent les générations. Certaines œuvres, comme La maison vide de Laurent Mauvignier, choisissent comme point de fuite la grand-mère, femme qui, souvent, charrie les malheurs de son temps. D’autres s’attachent, plus proche d’eux, à renouer avec leur mère, comme Emmanuel Carrère dans Kolkhoze ou Jakuta Alikavazovic dans Au grand jamais. Et puis il y a celles et ceux qui, fidèles à une tradition littéraire séculaire, essaient tant bien que mal de sonder les cœurs impénétrables de leur père, figure tutélaire complexe faite de silence, suscitant la crainte autant que l’admiration. Voyage aux racines de la filiation.
| Anne Berest, Finistère
On se souvient comme si c’était hier de la déflagration La carte postale, livre déchirant sur les traces d’une carte déposée par un anonyme dans la boîte aux lettres d’Anne Berest sur laquelle étaient inscrits les prénoms des grands-parents de sa mère, sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. L’enquête familiale menée tambour battant par la romancière avait remporté le Grand Prix des lectrices du magazine Elle et le Renaudot des lycéens. Trois ans après cette plongée en apnée dans les méandres de sa lignée maternelle et de ses origines juives, Anne Berest poursuit sa quête généalogique avec un drôle de jeu de miroirs.
Dans Finistère, elle retrace le parcours, de la Bretagne aux bancs de Polytechnique, de trois générations d’hommes engagés dans les luttes sociales de leur temps. Ceux-là mêmes qui constituent la branche paternelle de sa famille. De la France de l’entre-deux-guerres aux années 1980, elle remonte le temps. D’abord, son arrière-grand-père Eugène, fondateur d’une coopérative agricole et mobilisé pour la cause paysanne ; puis son grand-père, Eugène aussi, intellectuel réfugié à Paris pour étudier le grec qui s’engagera, lui, dans la littérature, déjouant sans cesse les attentes ; et enfin son propre père, Pierre, jeune homme turbulent qui prit parti pour le mouvement trotskiste avant de choisir la voie scientifique et de consacrer sa vie à la recherche en mécanique analytique.
« Toute ma vie, j’ai regardé mon père comme un mystère », annonce Anne Berest. Raconter sa vie, mais aussi celle de ses aïeuls, est pour elle un moyen de recoller les morceaux d’une relation faite de malentendus, de déceptions, parfois de colère. Son livre est une radioscopie tendre et touchante du lien mystérieux qui unit une fille à son père.
| Anthony Passeron, Jacky
Rares sont les romanciers pouvant prétendre avoir inventé une manière de raconter les histoires qui n’appartienne qu’à eux. Dans la lignée des Enfants endormis, qui nous avait tant éblouis, où il entremêlait le drame mis sous silence de son oncle Désiré, mort du sida à la fin des années 1980 et l’histoire de la lutte contre l’épidémie, Anthony Passeron continue à creuser ce sillon génial, alternant récit intime et enquête sociologique.
Cette fois, il ausculte les cicatrices de sa propre enfance, notamment le départ soudain de son père. Celui-là même qui les initia avec son frère à la grande innovation du tournant des années 1990 : le jeu vidéo. La souffrance d’une famille qui se disloque, les affres d’une jeunesse qui s’ennuie d’être sans cesse interrompue par les parties endiablées de Space Invaders ou de Zelda, les portraits des pionniers du 10e art… Un « roman d’apprentissage en trois consoles » virevoltant.
| Vanessa Schneider, La peau dure
Après la déflagration Tu t’appelais Maria Schneider (2018), consacré à sa cousine, actrice du Dernier tango à Paris, abusée par la folie créatrice de Bernardo Bertolucci et de l’ogre Marlon Brando, Vanessa Schneider s’attaque à une autre icône familiale, complexe et tourmentée : son père, Michel Schneider. Qui se cache derrière l’imposant haut fonctionnaire, derrière la grande figure littéraire ?
Avec la juste distance, celle de la grand-reporter, mais aussi la tendresse, la fougue, parfois la colère de la romancière qui dévoile une part de sa propre vie, elle reconstitue le puzzle d’une existence symbolisant à elle seule une génération d’hommes furieusement libres, des jouisseurs qui furent aussi des modèles destructeurs.
| Catherine Girard, In Violentia Veritas
Il y a huit ans, Philippe Jaenada remportait le Femina avec La serpe, roman qui démêlait un fait divers retentissant, l’affaire Henri Girard. En 1941, celui qui allait devenir, sous le pseudonyme Georges Arnaud, l’auteur du Salaire de la peur, est accusé du meurtre de son père, de sa tante et de la bonne dans le château familial d’Escoire. Après un procès houleux, il est acquitté. Fort de son enquête, Philippe Jaenada avait lui aussi tranché en faveur de son innocence.
Aujourd’hui, c’est la propre « fille de l’assassin » qui prend la plume pour exposer une tout autre version, avec un argument de poids : des aveux adressés lorsqu’elle avait 14 ans. Mais, loin du true crime haletant, Catherine Girard écrit avec la flamme de celle qui se réapproprie son histoire familiale. Elle façonne un roman noir sur la violence et les traumas qui traversent les générations, d’où émane une drôle de lumière – l’amour inconditionnel d’une enfant pour son père.