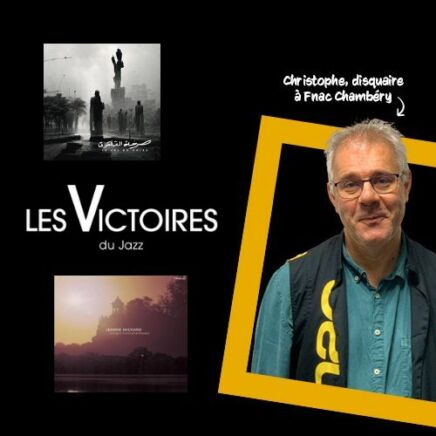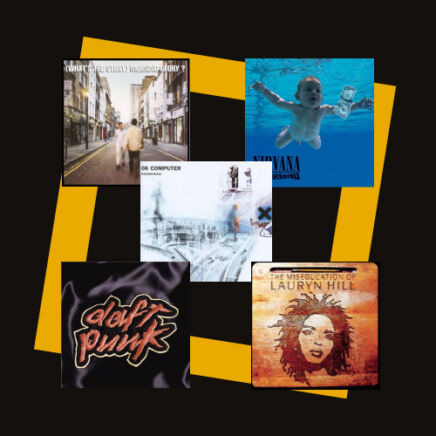L’excellente collection Jazz Is Dead commercialise un album de Tony Allen le 7 juillet 2023. Ami de Fela, il a ensuite mené une carrière solo remarquable. Avant son décès en avril 2020, nous avions discuté avec lui au sujet de sa carrière. Redécouvrez notre entretien avec celui qui a aussi accompagné Ray Lema, Damon Albarn et Manu DiBango, entre autres.
Ce 18eme volet de la collection Jazz Is Dead est consacré à Tony Allen, un des maitres de la batterie tout genre confondu. Il contient des sessions de studio datant de 2018, enregistrées avec l’élite des musiciens jazz californiens. Une façon de déguster encore son jeu, trois ans après son départ.
Huit titres explosifs qui rappellent l’énorme impact du batteur sur cet instrument. L’album rappelle également à quel point funk, soul et afro-beat sont imbriqués les uns dans les autres. Don’t Believe The Dancers est enraciné dans le jazz-funk des 70’s, genres qui lui étaient aussi chers qu’à son ami Fela. C’est la rencontre entre highlife et soul qui accouchera de l’afro-beat. Guitare, cuivres, claviers psychédéliques, percussions sont au service de compositions qui montrent à quel point ce musicien nigérian était génial et révolutionnaire. Un album indispensable.

J’ai rencontré Tony Allen à quelques reprises. La première fois, c’était lors d’un showcase à la FNAC de Cergy, en 2004. Puis, nous avons eu l’occasion de discuter un peu à d’autres occasions. La dernière avait lieu en 2019. A l’occasion de la sortie de cet album posthume dans la collection Jazz in Dead, voici un condensé de ces entretiens.
Christophe Augros : Vous considérez-vous comme un arrangeur ou comme un batteur ?
Tony Allen : Je suis les deux, pas plus l’un que l’autre. Même si je passe mon temps à écrire, je joue également beaucoup. Si j’ai un invité sur mon album, alors ma casquette d’arrangeur prend le dessus mais je suis les deux, arrangeur et batteur.
C.A. : Comment vous est venue l’idée du « highlife »?
T.A. : Cette musique existait déjà, c’est une musique traditionnelle dans toute l’Afrique de l’Ouest. Mais, avec Fela, nous avons apporté un plus, surtout au niveau rythmique. Nous l’avons fait évoluer parce que nous avons tout joué et avec une multitude de personnes. Nous avons appris la musique avec cet état d’esprit, savoir tout jouer.
C.A. : Vous avez effectivement tout joué, funk, rock, afro-beat… Où trouvez-vous cette capacité d’adaptation ?
T.A. : Je m’ennuie vite. Je me lasse de tout et assez rapidement. A chaque fois que l’ennui me prend, je cherche une musique de remplacement. Je ne peux m’empêcher de chercher. Pour cela, je rencontre beaucoup de monde, je voyage régulièrement. Avec Fela, nous avons fait de l’Afro-beat un rythme unique, bien installé. Alors maintenant, tout dépend du nombre de personnes qui vont se reconnaître dans cette musique, dans ce concept. Et puis je ne veux pas m’enfermer dans un seul genre. 90% des musiques d’aujourd’hui ont une base afro-beat alors j’explore autre chose, comme l’électronique.
C.A. : Pour vous qui avez connu l’oppression politique et la discrimination, est-ce que la musique est une arme ?
T.A. : Oui, absolument. La musique est une façon de combattre la discrimination. Si chacun respectait l’autre et prenait en compte la philosophie de l’autre… Si on écoutait un peu plus autrui et si l’on cherchait un peu plus à apprendre de l’autre, alors tout irait mieux. La musique peut changer ça, toutes ces frustrations. Et le monde politique devrait prendre exemple mais ils n’écoutent personne… Mais je ne veux pas en parler davantage.
C.A. : Il y a quelques années, les grandes majors du disque s’étaient installées au Niger puis elles sont parties. Ne pensez-vous pas que votre pays a manqué un grand rendez-vous pour son avenir artistique ?
T.A. : Oh ! En fait elles étaient déjà là depuis bien longtemps mais elles sont parties avec l’arrivée des militaires et leur politique de m*****. Je ne crois pas que le pays en ait souffert, ni moi. D’ailleurs, je n’ai jamais souffert de la politique en général. Je ne suis pas un réfugié, j’ai choisi de vivre en France et je retourne régulièrement dans mon pays. J’ai même été invité par le centre culturel Français du Niger. Je suis comme un ambassadeur.
C.A. : Quels souvenirs gardez-vous de la période passée avec Fela ?
T.A. : C’était une grande période, la plus grande. Il n’y a personne comme lui, je ne vois plus d’individu de cette trempe. Il était la vie, c’est une institution. Être avec lui, c’était se sentir plus fort grâce à des choses qui ne s’apprennent pas dans les écoles comme l’idéologie, la conception de la vie. On ne vous enseigne pas ça, vous l’apprenez avec la vie. Il m’a apporté énormément.
C.A. : Où êtes-vous le plus à l’aise pour créer ?
T.A. : En France ! J’y vis depuis vingt ans. Il y a de grandes facilités pour travailler dans ce pays. J’écris tout chez moi puis je rentre en studio avec mes musiciens, souvent au « studio Bleu » ou au « studio plus ».
C.A. : Quel est votre avis sur l’industrie du disque ?
T.A. : Ça devient fou, complètement fou ! Les mieux adaptés survivent dans un tel contexte. C’est comme dans la chanson Survival Of The Fittest . Moi, je fais ce dont j’ai rêvé pendant des années… je joue, c’est tout. J’utilise les nouvelles technologies. De toute façon, on ne peut rien contre le développement alors il faut savoir suivre et bouger avec le progrès. J’écoute toutes les musiques et je choisis celles que j’apprécie. C’est la meilleure façon de survivre : vivre avec son temps !
À lire aussi