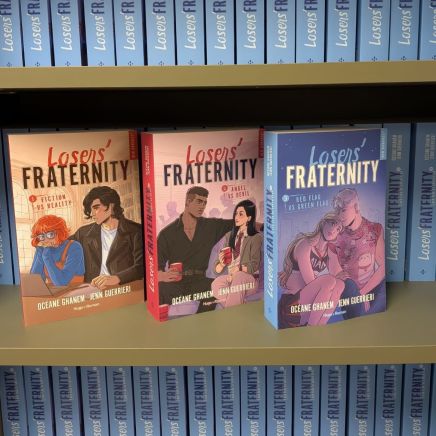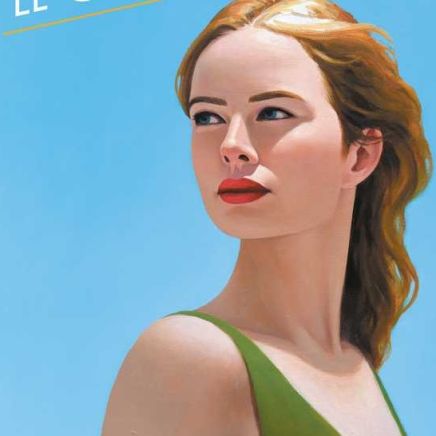À l’occasion du mois de la BD, L’Éclaireur a pu échanger avec Titiou Lecoq, marraine de l’événement et autrice de l’essai Les grandes oubliées, et Mansoureh Kamari, autrice de Ces lignes qui tracent mon corps. Rencontre croisée.
La Fnac célèbre le mois de la BD. Marraine de l’événement, Titiou Lecoq, autrice de l’essai graphique Les grandes oubliées (L’Iconoclaste), a rencontré Mansoureh Kamari, autrice de la bande dessinée Ces lignes qui tracent mon corps (Casterman). L’une détricote un récit historique qui a effacé les femmes. L’autre raconte la trajectoire d’une femme qui grandit en Iran et qui s’émancipe des lois patriarcales. Ensemble, elles posent une même question : « Qui raconte l’histoire ? » Aujourd’hui, les autrices s’emparent de la bande dessinée pour se réapproprier leur récit et faire entendre leurs voix.
Pourquoi avoir choisi de raconter ces histoires en bande dessinée ?
Mansoureh Kamari : Pour ce récit, qui est à cheval entre mes souvenirs de jeunesse en Iran et ma vie actuelle d’artiste en France, c’était très important pour moi de me dessiner. Le gros avantage du médium de la bande dessinée est de pouvoir raconter mon histoire, avec mes propres mains, mes propres traits.
Titiou Lecoq : Les grandes oubliées est à l’origine un essai paru en 2021. Un essai d’histoire peut vite décourager certains lecteurs, même si je l’ai voulu hyper accessible. La dessinatrice Marie Dubois, avec qui j’ai véritablement co-scénarisé la BD, a vraiment apporté un humour visuel. C’était important pour moi de ne pas faire une BD documentaire trop figée. Son dessin est parvenu à raconter quelque chose en plus du texte. Mon but est de rendre cette histoire de femmes accessible pour qu’on soit le plus nombreux possible à s’en emparer. Il faut que ça sorte des cercles universitaires et le médium dessiné permet ça. La BD va toucher un autre public… peut-être même des hommes, qui sait ! [Rires]
Mansoureh, votre BD Ces lignes qui tracent mon corps pose la question du regard. Celui que la société pose sur nous, sur notre corps, mais aussi celui que l’on pose sur soi. Le fait d’être à la fois modèle, dessinatrice et scénariste vous a-t-il permis de vous réapproprier votre identité ?
M. K. : En Iran, le corps des femmes subit beaucoup de contraintes. Le titre de la BD a un double sens. Il fait référence aux lignes qui entouraient mon corps de femme, de cette domination qui était comme collée à moi et qui me limitait. Mais, en essayant de me débarrasser de mon passé sombre par le dessin, je trouve un moyen d’émancipation et ma propre identité.
La bande dessinée de Mansoureh Kamari est autobiographique et elle se met en scène dans le récit. Titiou, dans Les grandes oubliées, vous êtes également représentée. Votre personnage rythme l’histoire et guide les lecteurs dans cette histoire encore méconnue des femmes. Pourquoi ce choix narratif ?
T. L. : C’était déjà la structure initiale de l’essai. Partir des cours d’histoire que j’ai eus à l’école lorsque j’étais élève. Ce qu’on enseignait à l’époque, dans les années 1980, était représentatif du niveau de connaissances. Mais qu’est-ce qu’on a appris depuis ? Par exemple, nous n’avons plus du tout la même vision de la préhistoire qu’à l’époque et on sait désormais que les femmes n’étaient pas cantonnées à s’occuper des enfants en restant dans les grottes. Elles étaient très actives. C’est le cas à toutes les époques.
Ce procédé narratif, qui se veut personnel, fonctionne bien parce que nous avons tous eu les mêmes manuels scolaires entre les mains. Ce qui m’a pris beaucoup de temps, ce sont moins les recherches que de trouver le bon fil pour raconter cette histoire. Le but de cette BD, c’est de faire résonner une culture scolaire commune et de faire connaître l’état d’avancée des recherches sur l’histoire des femmes.
Dans Les grandes oubliées, Titiou remonte aux origines de la domination masculine et dissèque la façon dont ces croyances ont régi nos sociétés et nos lois. Elle met aussi en lumière des femmes qui ont permis de faire changer les choses. Qu’est-ce que cela vous évoque, Mansoureh, vous qui avez grandi en Iran, là où la domination masculine reste très ancrée dans les lois ?
M. K. : Il est important de faire la distinction entre la société iranienne et les lois en Iran. Ce que je raconte dans la BD se déroule dans la période de ma jeunesse en Iran, jusqu’à mes 20 ans. Cela fait donc plus de 20 ans que je n’y vis plus. Aujourd’hui, la situation a énormément évolué, mais les lois restent discriminatoires pour les femmes. Une nouvelle génération est là et se bat contre les restrictions qui contraignent les femmes.
Titiou, au fil des pages des Grandes oubliées, on prend conscience de l’invisibilisation de nombreuses figures féminines. Or, l’histoire regorge de femmes audacieuses et visionnaires, et ce, à toutes les époques et dans tous les pays. Votre ambition est-elle d’en finir avec l’idée reçue des femmes passives dans l’histoire ?
T. L. : Je ne voulais pas faire des portraits de femmes effacées par l’histoire. Le but est de montrer que les femmes, en tant que classe sociale, ont été exclues de ces récits. L’histoire qui est enseignée à l’école est celle de la moitié de la population. Chaque grand événement historique est raconté par le prisme masculin.
Or, notre histoire est mixte. Lorsque j’interrogeais mes professeurs sur cette absence de femmes, on me répondait qu’elles étaient cantonnées au foyer et à l’éducation des enfants. Mais c’est totalement faux ! Les historiennes ont même donné un nom à ça : le “mythe de la femme empêchée”. Le concept même de femme au foyer est très occidental et très récent, il date de la fin du XIXe siècle. La réalité historique, c’est que les femmes ont toujours été motrices des luttes politiques. Et elles le sont toujours. On le voit bien aujourd’hui encore avec le mouvement “Femme, Vie, Liberté !” en Iran.
Vos deux albums s’inscrivent dans une mouvance éditoriale qui fait enfin la part belle aux bandes dessinées féministes. Que ce soit des biographies de femmes méconnues, des essais féministes ou des histoires intimes, en quoi ce genre de récits s’allie-t-il bien avec le médium de la bande dessinée ?
M. K. : Le dessin est un langage direct. Il permet, même s’il n’existe a pas de traduction, d’avoir une relation avec les lecteurs. Le dessin n’a pas de frontières. Il m’a permis de raconter mon histoire sans avoir les mots parfaits.
T. L. : Sur cette augmentation des BD féministes, notamment celles écrites et dessinées par des femmes, il y a quelque chose de très politique sur le fait d’être à la fois sujet et objet artistique. Dans l’histoire de l’art, on a tellement eu l’habitude de voir les femmes en tant qu’objets, coincées dans le rôle de muse. Le choix de se dessiner et de récupérer sa narration montre que quelque chose change dans les pratiques. J’ai choisi d’écrire mon essai Le couple et l’argent (L’Iconoclaste, 2022) à la première personne et de parler de moi. C’est l’un des effets de #MeToo, ce besoin d’être à la fois l’objet et le sujet de la création.
Y a-t-il des bandes dessinées qui vous ont marquées sur le sujet du féminisme, des femmes, du rapport au corps ou encore des récits d’émancipation ?
M. K. : J’ai gardé en tête Éclore (Casterman, 2024) d’Aude Mermilliod. Elle avait une expérience qui l’a marquée dans son corps et elle a osé la raconter pour s’en débarrasser. C’est un récit remarquable.
T. L. : J’ai envie de citer des Américaines. D’abord, tous les Alison Bechdel. Quand j’en parle, les gens connaissent souvent le test de Bechdel, mais ne l’ont pas lue, alors que c’est vraiment brillant. J’avais aussi beaucoup aimé Les imbuvables ou comment j’ai arrêté de boire (L’Agrume, 2023) de Julia Wertz. Elle a ce truc où elle arrive à la fois à me faire hurler de rire et à me bouleverser lorsqu’elle raconte la solitude. Et c’est garanti zéro male gaze !