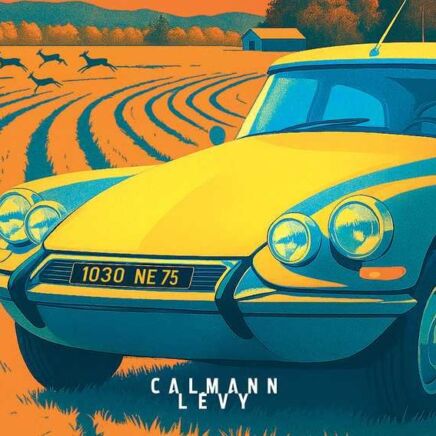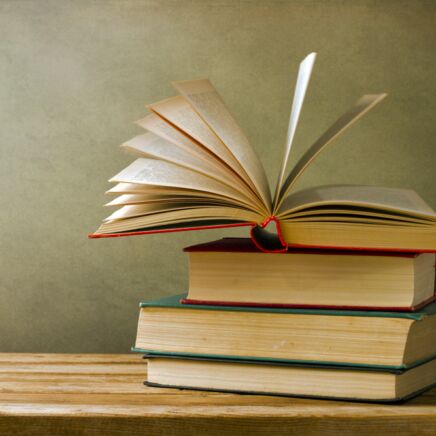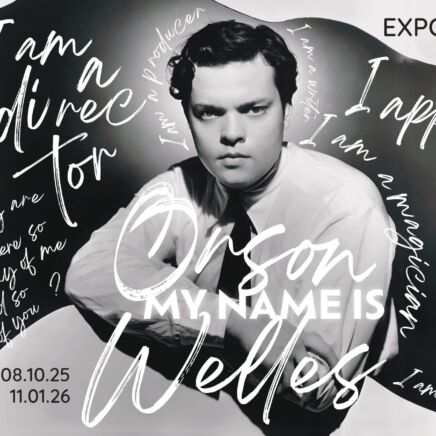En pleine période de grands prix venant consacrer les meilleurs romans de la rentrée littéraire, on vous propose de changer d’air. Place aux biographies et aux mémoires, une autre façon de croquer les vies et raconter les histoires.
| Un certain Julio Iglesias, d’Ignacio Peyro
1986. Dans son jet privé, Julio Iglesias, marcel, toison apparente, paire d’Aviator vissée sur le nez, s’apprête à déguster un seau de KFC avec une tortilla et un verre de château Lafite-Rothschild. La photo légendaire qui orne la couverture du livre d’Ignacio Peyro dit tout de la figure excentrique, grotesque et géniale qu’il entend nous croquer.
Avec un incroyable souffle littéraire, le journaliste retrace le destin chahuté de l’incarnation la plus flamboyante du latin lover, celui qui reste à ce jour l’artiste hispanophone ayant vendu le plus d’albums à travers le monde (300 millions d’exemplaires).
« Il a été l’Espagnol le plus connu du XXe siècle après Dalí et Picasso. »
Sa première carrière de footballeur comme gardien du Real Madrid, au cours de laquelle il arrête un jour le penalty de la légende du club, Alfredo di Stefano ; l’accident de voiture dramatique, après une nuit de fête, qui le paralyse pendant un an et demi ; l’enlèvement de son père par un commando de l’ETA ; l’irrésistible ascension d’un crooner à l’énergie hors norme ; sa résidence luxueuse d’Indian Creek où il recevait le gratin de la jet-set ; les innombrables femmes de sa vie, dont Isabel Preysler, « la perle de Manille », qui le quitte avec perte et fracas pour le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa ; son rôle méconnu, mais décisif, dans les tractations politiques internationales de l’époque entre Reagan, Mitterrand et Jose Maria Aznar…
Le show Iglesias tient toute ses promesses avec, au menu, du glamour, des femmes, un public en transe qui contraste avec le mépris des élites, une gabegie financière, des déclarations douteuses, mais surtout un décor privilégié, une société espagnole en pleine mutation, quittant les rivages du franquisme pour embrasser la Movida.
| Esther Williams, une sirène à Hollywood, d’Esther Williams
Mise à part la publicité culte d’Evian dans les années 2000, dans laquelle des dizaines de bébés se trémoussaient dans une piscine sur des chorégraphies exécutées à la perfection, les « aquamusicals », ces films où la comédie musicale rencontre la natation synchronisée, n’ont guère connu de succès autre part qu’aux États-Unis. Pas étonnant, donc, si vous ne connaissez pas Esther Williams, la sirène d’Hollywood, star des années 1940 et 1950, dont les éditions Séguier publient aujourd’hui les mémoires. Avec une franchise déconcertante et des révélations stupéfiantes, celle qui disparut en 2013, à 91 ans, nous livre les souvenirs d’une vie chahutée, passée à dénoncer l’emprise des hommes sur la machine à rêves.
Grand espoir de la natation américaine, recordwoman du 100 mètres en 1939, elle voit ses espoirs olympiques brisés par la Seconde Guerre mondiale et s’offre une nouvelle vie à Hollywood, où elle est engagée par MGM pour des numéros de ballets aquatiques et des comédies musicales. Du grand bassin à la plongée au milieu des requins, voilà la championne propulsée dans un monde crasseux et décadent, où les paillettes ne sont que de la poudre aux yeux.
« Pour la presse, j’étais la parfaite fée du logis, la reine glamour d’Hollywood et un sex-symbol en maillot de bain – cela fait beaucoup pour une seule femme. Tout cela alors que je travaillais douze heures par jour à créer de petits rêves sur pellicule en barbotant dans la piscine géante de la MGM. »
L’insistance des producteurs, les fantasmes des réalisateurs, la folie perverse des acteurs symbolisée par une scène glaçante où Johnny « Tarzan » Weissmuller lui court après, le sexe à la main, en faisant des cris de singe : rien n’a été épargné à Esther Williams. Après une trentaine de films, dont La première sirène (1952) et La chérie de Jupiter (1955), elle fait ses adieux au cinéma dès 1961 pour monter… sa marque de maillots de bain.
| Huysmans vivant, d’Agnès Michaux
Cela fait 67 ans, depuis la parution en 1958 de La vie de J.-K. Huysmans, signé par l’universitaire anglais Robert Baldick que l’on n’avait pas consacré un livre au grand écrivain du XIXe siècle, l’une des figures les plus fascinantes de notre littérature. Agnès Michaux répare aujourd’hui cet affront avec brio. Une grande biographie se dévore comme un roman. C’est le cas de ce Huysmans vivant.
Dans cette reconstitution historique, elle fait revivre avec érudition et minutie une époque, le XIXe siècle finissant, et un lieu, le Paris littéraire et artistique bouillonnant. Avec un plaisir non dissimulé, elle offre une tribune à sa langue foutraque et furieuse. Avec le souffle d’une adepte qui veut restituer toute la force du génie, elle donne chair à un écrivain longtemps caricaturé, qui semble bénéficier aujourd’hui d’un retour en grâce. Joris-Karl Huysmans (1848-1907), l’auteur d’À rebours et de Là-bas, était, certes, un personnage déroutant, provocateur, décadent, sataniste même par moments, mais il était surtout un écrivain d’avant-garde, bâtissant des ponts entre le naturalisme de Zola et le surréalisme qui allait advenir, rassemblant après sa mort des héritiers aussi diamétralement opposés que Paul Valery et Michel Houellebecq.
| La part sauvage, de Marc Weitzmann
Tout juste récompensé du prix Femina dans la catégorie essai, La part sauvage n’est pas un exercice biographique comme les autres. Si sa photo trône en majesté sur la couverture, n’attendez pas un déroulé classique de la vie de Philip Roth (1933-2018). Journaliste, ancien rédacteur en chef de la rubrique littéraire aux Inrocks, Marc Weitzmann fait plutôt dans le portrait baroque, racontant l’homme et l’écrivain à la lumière de l’amitié qu’il a partagée avec lui pendant près de 20 ans, après une interview réalisée en 1999.
Méditation sur la littérature et sa puissance évocatrice, parfois divinatoire, ce texte dense, foisonnant, invite à une relecture du chaos contemporain et du naufrage américain à travers les œuvres du romancier, de La tâche (2002) au Complot contre l’Amérique (2006). Une plongée vertigineuse dans l’esprit d’un monstre sacré au nihilisme désabusé. Un hommage puissant à sa « boussole éthique et littéraire ».
| Pasolini – mourir par les idées, de Roberto Carnero
Le 2 novembre 1975, on retrouvait sur la plage d’Ostie, à quelques encablures de Rome, le corps de Pier Paolo Pasolini atrocement mutilé. Une mort violente qui fait immédiatement de l’intellectuel engagé et de l’artiste d’avant-garde un martyr tué pour ses idées. Cinquante ans plus tard, il est même devenu une icône comparable à Rimbaud, et Roberto Carnero s’attèle à l’ambitieuse tâche de capturer son génie dans un livre.
On parcourt une vie marquée tout entière du sceau de l’engagement politique : son enfance écrasée par les idéaux fascistes de son père, la mort de son frère dans la Résistance, son engagement furtif avec le communisme avant la rupture brutale, sa haine viscérale des idéaux bourgeois, sa fureur contre le monde entier. On redécouvre le réalisateur d’avant-garde qui bouscule notre rapport au réel et fracasse sans ménagement notre boussole morale dans des films devenus cultes comme Accattone (1961), la trilogie L’Évangile selon Saint-Mathieu, Œdipe Roi (1967), Médée (1970), Théorème (1968) et, bien sûr, le sulfureux Salò ou les 120 journées de Sodome (1975). Surtout, on mesure la force du romancier et la puissance évocatrice du poète, auteur de chefs-d’œuvre visionnaires comme Pétrole, publié à titre posthume.