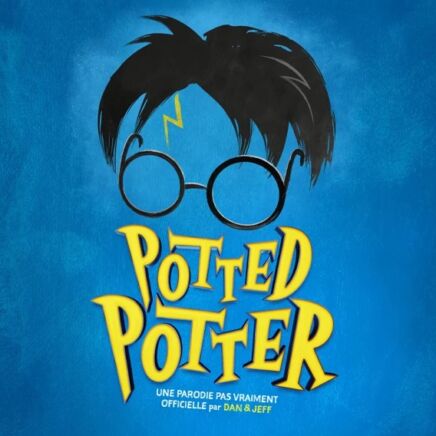Nouveau chroniqueur hebdomadaire chez Quotidien, Louis Cattelat est aujourd’hui l’une des figures montantes du stand-up grâce à son spectacle Arecibo. Humour noir, amour du cinéma et fascination pour l’espace…L’Éclaireur a rencontré l’humoriste afin de parler de ses diverses passions.
Comment vivez-vous cette rentrée ? Vous êtes-vous fixé des objectifs ?
Je ne réfléchis pas à ma vie en termes d’objectifs. Par exemple, le stand-up n’était pas du tout mon but, ce n’était pas prévu. Je ne suis pas en train de parcourir un chemin que je m’étais tracé. Mon objectif, c’est d’arriver à faire que mon envie de base, qui était le scénario, continue d’exister. Aujourd’hui, le stand-up prend une part importante, avec la tournée, les salles parisiennes, la chronique hebdomadaire chez Quotidien…
Il faut quand même que j’arrive à trouver la plasticité cérébrale pour me remettre dans mes scénarios et rester attaché à un projet sur le temps long. C’est ce qui est le plus dur avec le scénario, parce qu’il faut des mois pour que les choses se financent. Il faut garder la flamme. L’objectif de rentrée c’est d’avoir plusieurs casseroles sur le feu – et de dormir.

Est-il plus facile d’écrire un scénario ou un spectacle de stand-up ?
C’est très différent. Je pense que c’est plus facile d’écrire un stand-up. Pourquoi ? Parce que personne ne me donne son avis sur mes textes. Confier ton texte de stand-up, c’est confier ton enfant à quelqu’un qui doit vraiment comprendre comment fonctionne ton humour. Et je n’ai pas encore trouvé cette personne.
Le stand-up est quand même plus facile, parce que je peux l’écrire dix minutes avant de monter sur scène. Et dix minutes après, je le joue, ça existe. Alors que le scénario, le chemin est très long pour que ça arrive à exister un jour.
Quand tu es dans une salle, tu fais une blague, tu entends si la blague est comprise ou pas. Alors que le scénario implique énormément de questions pour essayer de défendre un propos ou un langage cinématographique afin que le public comprenne. Avec le stand-up, c’est moi qui parle. Si je dois apporter des précisions parce que j’ai entendu qu’il y avait un malaise, tout de suite, je peux rattraper le chemin. Je pense que le scénario est quand même plus difficile, car je me mets beaucoup la pression.
Vos scénarios ressemblent-ils à votre spectacle ?
Il y en a deux sur trois qui parlent essentiellement d’écologie. Ce n’est pas vraiment un thème du spectacle, ou seulement de façon vague. Le premier est un film très noir, très nocturne, avec un pic d’humour au milieu. Il y a deux minutes qui sont censées être drôles et, après, on replonge dans le noir. Avec le deuxième, on est vraiment dans de l’humour noir frontal, qui me ressemble et que je joue sur scène. Enfin, le troisième ne parle pas d’écologie, mais de communication. Là, on retrouve la maraude d’Arecibo. [Rires]
On vous présente souvent comme une “étoile montante du stand-up”. Ce statut vous met-il la pression ?
Ça me fait plaisir, mais ça ne me met pas de pression. Je suis prudent sur les épiphénomènes. C’est facile d’être une étoile montante, c’est facile de ne plus l’être. Je prends ça comme un compliment, mais ça ne change rien à ma façon de travailler.
Avez-vous eu un processus d’écriture particulier sur ce spectacle ? Quel a été le point de départ ?
Pour Arecibo, je me devais d’avoir une colonne vertébrale, celle de la communication. J’ai une grande thématique et je pense que c’est quelque chose de très scolaire. C’est vraiment une démonstration dans laquelle j’essaie de multiplier les exemples pour appuyer mon propos et le nuancer.
J’ai une note sur mon téléphone : quand une idée me vient, je la note. Ensuite, quand j’ai eu ma structure de spectacle, j’ai développé cela en plusieurs parties, je faisais beaucoup de Lego. J’ai beaucoup changé l’ordre. Jouer toutes les semaines m’a permis de tester les combinaisons. Là, je pense que j’en ai trouvé une qui fonctionne.
Après, il y a deux choses. Soit j’ai une idée spontanée, je l’étire, je cherche l’humour et je vois où la ranger dans la structure ; soit je sens une faiblesse et je me demande : qu’est-ce que j’ai vécu qui pourrait combler ce manque-là ?
Le fait d’avoir changé l’ordre du spectacle a-t-il ajouté un certain challenge ?
Au début, je croyais qu’on n’avait le droit de faire les blagues qu’une seule fois. Comme je jouais dans des comedy clubs, je me disais : “Si des gens reviennent, ils vont être déçus d’entendre la même chose.” Donc j’écrivais énormément. Je ne pouvais pas rejouer deux fois la même chose. C’est un très bon exercice, mais on fatigue un peu, à force.
Quand j’ai joué le spectacle au Théâtre du Marais, au bout des 12 représentations, j’en étais lassé. Puis, j’ai enchaîné avec la Nouvelle Seine, je voulais y apporter du sang neuf. Sauf qu’aujourd’hui, j’ai compris qu’il ne faut pas tout le temps modifier son texte. En le jouant plus de 50 fois, j’ai enfin atteint le plaisir de ne pas toucher son texte. Il fallait que je passe par là. Maintenant, la seule chose qui change, ce sont les gens qui viennent me voir. Chaque soir, j’ai hâte de savoir qui je vais avoir en face de moi. Beaucoup d’artistes confirmés m’ont dit au début qu’il ne fallait pas trop modifier le spectacle, mais plutôt le changer dans du détail, faire ce travail d’orfèvreries. C’est un bon conseil.
Quels autres conseils avez-vous reçus ?
On m’a dit de faire beaucoup de plateaux. Je dois avouer que je ne le respecte pas vraiment… [Rires] J’en ai fait un peu au Québec, lors d’un festival, et ça m’a donné envie de recommencer. Mais à Paris, je n’en fais pas beaucoup. Pourtant, ceux qui le font disent que c’est bon pour la confiance en soi, car, même quand tu bides, c’est formateur. Mais pour bider, il faut accepter de jouer souvent. Ça permet aussi de tester des blagues. Ça me parle moins. Je ne teste pas trop. Pour l’instant, j’ai la chance que ça fonctionne à peu près.
J’ai quand même eu un excès de confiance une fois, dans une émission télé. Je me suis dit : “Tiens, je vais tester un texte.” Mauvaise idée. C’était un public assez froid, pas spécialement stand-up, et pas très nombreux. J’ai fait un sketch avec pour postulat : “Être possédé par un démon, c’est une expérience de colocation à moindres frais.” Sur le papier, ça peut se défendre, mais pour un texte jamais rodé, c’était beaucoup trop brut. Et là, je me suis dit : “OK, peut-être qu’il faut quand même aller roder tes blagues avant…” [Rires]
Votre spectacle est sobre dans sa mise en scène. Pourquoi ce choix ?
De manière générale, le stand-up, ce n’est pas Starmania. Je pense que ça doit être un héritage personnel : je suis toujours un peu réticent à l’usage d’artifices dans un spectacle d’humour. Je suis rarement client des accessoires, de la musique, des bruitages.
Comme j’estime être le premier spectateur de mon spectacle, j’ai fait quelque chose qui me correspond. C’est donc naturellement épuré. Tout doit disparaître, de Hannah Einbinder, m’a beaucoup marqué. Elle est habillée en noir, il n’y a rien sur scène, mais elle utilise un peu la lumière et les rideaux pour faire des blagues. Ça reste très sobre et je trouve ça marrant. Et puis, cette sobriété permet aussi de mettre l’accent sur le texte, le rythme, les punchlines. Comme ça, les gens se concentrent vraiment dessus. C’est ce qui me plaît : ça fuse tout au long du spectacle.
« J’aime mettre mon humour au service de thèmes que j’ai envie de porter dans l’espace public, comme l’écologie ou le cinéma. »
Louis Cattelat
Et comment vous sentez-vous sur scène ? Est-ce que ça vous a aidé à surmonter quelque chose ?
Il est évident que je n’ai plus aucun problème avec la prise de parole en public ! Ça, c’est acquis. Si quelqu’un a besoin de moi pour faire un discours, je peux le faire sans souci. [Rires] Mais est-ce que ça m’a bouleversé intimement ? Non. Je ne peux pas dire que la scène m’a aidé à vaincre une timidité, par exemple. La timidité reste, mais elle est variable. Je peux jouer devant 2 000 personnes sans problème… et me sentir timide dans un simple cours de danse. On est plein de paradoxes et la scène ne guérit pas tout.
La vérité, c’est que le ressenti dépend entièrement de la salle. Si la salle passe un bon moment, je passe un bon moment. Si elle ne passe pas un bon moment, je ne passe pas un bon moment non plus. On n’est pas hermétique : on entend les non-rires, on entend le silence. Donc, comment je me sens sur scène ? Ça dépend. C’est ce qu’on remet en jeu tous les soirs. Être sur scène, c’est toujours une expérience à deux énergies : celle du public et la mienne.
Jouez-vous souvent avec les silences dans votre spectacle ?
Oui. Il y a des moments où je laisse volontairement des pauses. Je découpe ma phrase en petits tronçons, avec de grands silences entre deux. Et ça, ça les fait beaucoup rire.
Mais attention : si c’est une soirée qui se passe moins bien, je ne vais pas m’amuser à laisser des silences, parce qu’ils sont déjà là ! Là, tu t’ajustes en direct. Sur scène, on est poreux : si le public se sent bien, je me sens bien. Si ça rit moins, je le ressens immédiatement. Et croyez-moi, ça arrive. J’ai fait ma rentrée à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, un dimanche à 18 h, dans un gymnase. Pas vraiment un public conquis. Ça rigolait, mais il fallait aller les chercher. Et moi, c’était ma reprise après les vacances, donc j’étais un peu rouillé, avec quelques trous de texte… Bref, ce n’était pas stratosphérique.
Et puis, une autre fois, dans un comedy club à Paris, j’ai enchaîné sept minutes de silence total. Un naufrage. Le Titanic. Le public n’avait pas compris que j’étais homosexuel. Donc, quand je faisais des blagues de cul, ils se demandaient : “Attends, mais où est la femme ?” J’ai cru qu’ils ne saisissaient pas, alors je suis passé à des blagues d’humour noir. Mais, comme ils ne m’avaient pas trouvé drôle avant, ils se sont dit que j’étais juste méchant. Du coup, j’ai lancé toutes mes meilleures blagues et je les voyais mourir, une par une, par terre. Pouf ! À la fin, j’ai dit : “Bon, je vais m’arrêter là, ce sera mieux pour tout le monde”, et je suis parti. C’était horrible.
Mais c’est une bonne piqûre de rappel. Les comedy clubs, c’est formateur, parce que les gens ne viennent pas spécialement pour toi. Si tu arrives à les faire rire, tu sais que tes blagues fonctionnent vraiment, au-delà de ton cercle d’habitués. Et puis bider, ça fait partie du métier. Un petit bide par trimestre, je pense que c’est sain.
« À chaque grand stress collectif, l’humanité lève les yeux vers le ciel. »
Louis Cattelat
Votre spectacle repose sur de l’humour noir. Comment le maniez-vous ?
C’est une certaine subtilité. Quand je parle d’humour noir, notamment des blagues de sexe, ce n’est pas frontal-frontal. Il faut toujours une seconde pour que les gens comprennent la blague – et, sur scène, j’ai l’impression que la culpabilité est partagée : la blague naît un peu dans le cerveau des gens. Si elle passe, c’est qu’ils ont eux-mêmes ce petit fond tordu qui y a pensé un moment.
Les rires que j’entends sont un peu des rires coupables : des rires qui disent “Mince, vous m’avez fait penser ça.” Parfois, ça grince aux articulations, on sent que les gens ne rient pas franchement, mais peut-être qu’au fond ils sont d’accord avec ce que tu dis. J’ai cette idée très sincère : au discours d’enterrement, ce n’est pas parce qu’on est en deuil qu’on n’a plus d’esprit critique. Tu peux très bien penser “Je m’ennuie” pendant un discours de mariage – c’est la même mécanique, juste plus blasphématoire dans un contexte tragique.

Pour moi, la vraie limite, ce n’est pas tant le thème que la qualité du texte. Un texte long et mal écrit va ennuyer tout le monde, même s’il traite de sujets horribles. Dans le spectacle, souvent, les gens n’osent pas rire ouvertement, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne comprennent pas ou ne partagent pas l’idée.
Par exemple, j’ai une blague où je dis que “jJai envie de mourir dans les flammes parce que je vais être incinéré et que donc j’aurai été précuit”. “Précuit”, c’est du jargon de cuisine : ça transforme la réalité atroce de mourir dans les flammes en jeu de mots. C’est noir, mais ce n’est pas frontal – ça passe par un autre mot, par un décalage. Et c’est souvent là que l’humour noir tient : dans le détour, pas dans l’attaque frontale.
Où placez-vous votre curseur, finalement ?
Franchement, je n’en sais rien. Le curseur dépend toujours du contexte et de la sensibilité de chacun. Par exemple, j’ai une blague sur Gaspard Ulliel : des gens du cinéma m’ont dit qu’il fallait l’enlever parce que ça les touchait trop personnellement. Moi, je ne l’ai pas retirée, parce qu’elle me fait rire, même si elle est dure. J’aime bien cette phrase de Ricky Gervais : “Ce n’est pas parce que tu es offensé que tu as raison.” Être offensé, ça arrive, et dans ce cas, tu ne rigoles pas, c’est tout. La meilleure sanction pour une blague qui ne passe pas, c’est le silence. Si elle ne fait rire personne, elle meurt d’elle-même.
Après, il y a aussi une dimension personnelle. J’ai déjà dit à des amis en plein deuil de ne pas venir me voir trop tôt, parce que certaines blagues pouvaient être difficiles à entendre. Et puis, il y a le contexte social : selon les époques, certains sujets deviennent plus ou moins praticables. On avance toujours sur ce fil-là.
« C’est ce que je trouve fascinant dans l’espace et dans les aliens : ce que ça dit de nous, de notre rapport à l’altérité, à nos peurs, à nos rêves. »
Louis Cattelat
On retrouve aussi cet humour noir dans vos nouvelles chroniques dans Quotidien…
J’écris mes chroniques avec ma coautrice. Pour la première, je trouvais qu’on avait un super texte : solide, répété, prêt. J’étais plus stressé à la diffusion qu’à l’enregistrement. Le plateau n’est pas si grand et toute l’équipe m’a bien accueilli. J’avais confiance.
C’est un exercice particulier : très codifié, avec beaucoup de contraintes de temps et de format, et des invités qui viennent pour de la promo, donc plus ou moins enclins à rire. Mais j’adore ça. Écrire vite, dans un cadre précis, c’est stimulant. Et cette première chronique s’est étonnamment bien passée.
Arecibo fait référence au message du même nom envoyé en 1974 à d’éventuelles existences extraterrestres et sert le propos du spectacle sur la communication. D’où vous vient cette passion pour l’espace ?
Je suis tombé dedans en prépa, vers 2014, en découvrant Galilée et Kepler. Ce qui m’a frappé, c’est l’idée des grandes blessures narcissiques de l’humanité : apprendre qu’on n’était pas le centre de l’univers, par exemple. L’espace, c’est passionnant à plein d’endroits. C’est un réservoir de rêveries, d’infini, de liberté. On l’a vu pendant le confinement : les ventes de télescopes ont explosé, comme dans les années 1950-1960 avec l’essor des ovnis. À chaque grand stress collectif, l’humanité lève les yeux vers le ciel.
Ce qui est intéressant, c’est que les extraterrestres reflètent toujours nos angoisses du moment. Dans les années 1960, en pleine guerre froide, on les imaginait froids, gris, menaçants : des Russes déguisés. Dans les années 2010, avec la crise écologique, ils viennent pomper nos ressources et diviser les peuples. L’alien, c’est toujours une projection de nous-mêmes : le “boss final” de l’étranger.
Un livre a aussi changé mon regard : L’univers à portée de main de Christophe Galfard. J’y ai découvert une poésie scientifique incroyable, la beauté brute de la formation des galaxies, indépendante de nous. Contrairement à une œuvre d’art qu’on peut juger, une galaxie se fiche de notre avis. C’est une beauté qui existe en soi, et ça m’a bouleversé.
Et puis il y a toutes les histoires d’enlèvements extraterrestres, qui en disent long sur la société. Le couple Hill, dans les années 1960 aux États-Unis, a raconté avoir été “abducté”. C’était un couple mixte et certains chercheurs ont vu dans cette histoire une façon de rendre leur couple acceptable médiatiquement, à une époque raciste, en parlant d’aliens plutôt que de couleur de peau. D’autres pensent qu’ils ont peut-être caché un traumatisme bien réel derrière ce récit. Dans tous les cas, ça interroge : pourquoi eux ? Pourquoi pas d’autres ?
C’est ce que je trouve fascinant dans l’espace et dans les aliens : ce que ça dit de nous, de notre rapport à l’altérité, à nos peurs, à nos rêves. C’est un sujet inépuisable, et c’est pour ça que j’y reviens sans cesse, sur scène comme dans mes scénarios.
Vous parlez avec une telle passion de l’espace. Peut-on dire qu’Arecibo est votre œuvre la plus personnelle à ce jour ?
Je ne sais pas. La toute première version du spectacle était sans doute encore plus personnelle, parce que j’y avais mis énormément d’astronomie. [Rires] Mais je me suis vite rendu compte que je perdais les trois quarts de la salle dès que je disais “année-lumière”. Les gens trouvaient ça intéressant… mais ça devenait une conférence. J’ai dû raboter presque toutes les blagues scientifiques, à mon grand désarroi. Mon objectif, aujourd’hui, c’est de réussir à en remettre, mais sans perdre le public.
Je ne suis pas non plus très client d’un stand-up entièrement autocentré. La vague Paul Mirabel ou Blanche Gardin m’a beaucoup marqué, mais je pense en être revenu. Forcément, il y aura toujours ma patte, ma façon de voir le monde, mais j’aime mettre mon humour au service de thèmes que j’ai envie de porter dans l’espace public, comme l’écologie ou le cinéma. Le prochain spectacle sera sans doute encore moins centré sur moi.
Après, il y a toujours une part de personnel. Le public ne veut pas seulement assister à une conférence, il aime sentir le lien avec l’artiste. Il faut trouver un équilibre. Et puis, chaque œuvre se fait en réaction à la précédente. Peut-être que la prochaine sera plus intime, ou au contraire plus éloignée de moi.
Je l’ai vu aussi avec mes courts-métrages : mes tout premiers étaient les plus personnels, parce que je n’avais pas d’argent, donc aucune contrainte. Dès qu’il y a de l’argent, ça devient plus formaté. Le stand-up, comme ça ne coûte pas cher, me permet de garder cette liberté. Mais je n’ai jamais eu la volonté consciente de faire “mon œuvre personnelle”. Ce qui me fait rire, ce sont mes travers, mes galères, le fait de me trouver médiocre… Mais je n’ai pas envie de passer une heure chaque soir à expliquer aux gens à quel point je suis nul. Donc, forcément, je vais aussi chercher ailleurs. [Rires]
Pour finir, quel est votre dernier coup de cœur culturel ?
J’aimerais recommander un film qui sera, je l’espère, plus visible en salle : En première ligne. Ce n’est pas du tout un film drôle, mais il m’a bouleversé. C’est l’histoire d’une infirmière dans un hôpital public, avec Leonie Benesch dans le rôle principal.
Le film montre à quel point les métiers de santé sont sous pression, à quel point c’est dur – et, en même temps, il met en lumière la gentillesse, l’entraide, la patience, toutes ces valeurs qui tiennent encore debout dans les interstices. C’est beau à pleurer. À la projection, tout le monde était en larmes. Mais tu pleures pour de bonnes raisons : pas de désespoir, plutôt parce que tu retrouves foi en l’humanité.
Arecibo de Louis Cattelat, en tournée dans toute la France du 30 octobre 2025 au 26 novembre 2026 et à la Maison des Métallos, à Paris, du 31 octobre 2025 au 15 janvier 2026.