
[Rentrée littéraire] Avec un roman fascinant et dérangeant, Otessa Moshfegh continue à tisser son étrange toile littéraire et réitère son invitation à se mettre en retrait du monde pour embrasser le pouvoir de l’imaginaire.
En cette période de résolutions, de meilleurs vœux et d’aspiration au bonheur, Otessa Moshfegh vient une nouvelle fois jouer les troubles fêtes. Génie désinvolte et cynique, grande peintre de l’intranquillité, apôtre de la solitude et de l’effacement, son œuvre instille le malaise et donne un grand coup de botte à cette idée saugrenue que la littérature nous voudrait du bien. Un Xanax, un Moshfegh et au lit.
Une plume lucide et cruelle
À tout juste 40 ans et en trois livres seulement, la romancière new-yorkaise, d’origine iranienne par son père et croate par sa mère, s’est déjà forgée une jolie réputation dans le milieu littéraire. Cheffe de file d’une nouvelle génération d’écrivaines américaines, elle forme avec Emma Cline, autrice de l’obsédant The Girls et Rachel Kushner, écrivaine destroy du Mars Club, un groupe aussi virtuose que féroce, un Brat Pack féminin décapant. Comme un symbole, Bret Easton Ellis chante d’ailleurs partout ses louanges et la considère comme son héritière. Elle partage avec lui cette cruelle lucidité qui fait voir en gros plan tous les travers de l’époque, cette plume acérée pour raconter la folie des Hommes et un mauvais esprit élevé au rang d’art. Elle incarne surtout, comme lui en son temps, la voix d’une génération. Si l’auteur de Moins que zéro parlait au nom d’une génération X écrasé par le poids d’une société absurde forgée par des baby-boomers inconscients, Otessa Moshfegh est quant à elle la porte-parole des millénials, ces enfants des années 80 et 90 pris en étau entre la prospérité destructrice du monde d’avant et l’angoisse existentielle du monde d’après.
Que ce soit dans Eileen, couronné du Pen Award, l’équivalent du Goncourt du premier roman américain, dans Mon année de repos et de détente, texte fou et dérangeant devenu l’hymne d’une humanité confinée et larvée sur son canapé ou dans La mort entre ses mains, son dernier roman qui vient tout juste de paraître, elle façonne des héroïnes tourmentées et instables, qui s’effacent du monde, des femmes qui se débattent avec leurs démons et flirtent avec la folie. Une métaphore cruelle et impitoyable de nos sociétés gangrénées…
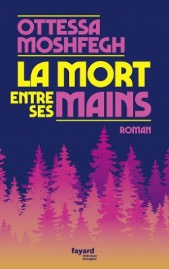
L’appel de la forêt
À la mort de son mari, Vesta Gul, une septuagénaire, s’est réfugiée dans une maison au fond des bois avec son chien Charlie. Loin de la civilisation, elle tente de se reconstruire et de trouver un nouveau sens à sa vie. Cette échappatoire, elle va la trouver lors d’une énième errance matinale, alors qu’elle découvre au cœur de la forêt un étrange message gravé au pied d’un arbre : « Elle s’appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici son cadavre. » Pourtant, aucun indice aux alentours, aucune trace d’un quelconque crime. Mais pour Vesta, c’est trop tard, le mal est fait. Complètement obsédée par cette victime invisible, elle se jette à corps perdu dans cette quête inattendue et se mue en justicière des causes perdues. Enivrée par cette enquête, elle en vient même à fantasmer la vie de la jeune Magda. Comme un écrivain à l’ouvrage qui dessine ses personnages, elle imagine cette vie brisée, elle donne un nom et un visage à son entourage et même à son bourreau.
Mais plus elle déroule le fil de cette existence fictionnelle, plus son comportement intrigue, inquiète ; et plus un doute s’installe dans la tête du lecteur. À quel genre de femme a-t-on vraiment affaire ? Peut-on se fier aux dires de la narratrice ? On replonge dans les secrets d’un mariage destructeur, où régnait la violence et l’infidélité. L’emprise aussi, celle qu’avait sur elle un mari manipulateur. Sur sa table de nuit, on découvre une boîte d’anxiolytiques, un traitement qu’elle a cessé de suivre… On remarque aussi, distillées par-ci par-là, des phrases étranges : elle prétend qu’on conspire contre elle, qu’on vole les graines qu’elle plante dans son jardin. Surtout, elle se met à sentir en elle la présence de Magda, à murmurer avec elle. Entre paranoïa et possession, le roman oscille vers l’étrange. Et puis il y a cette « Murder Party » qui bat son plein chez les voisins – comme si, au fond, tout cela n’était qu’un jeu…
Ni polar, ni conte fantastique, La mort entre ses mains est d’abord le portrait dérangeant d’une femme qui perd pied. Au seuil de la vie et la mort, entre illusion et réalité, elle se débat comme elle peut. Mais ce roman est surtout une formidable ode au pouvoir guérisseur de la littérature. Plutôt qu’un cri de désespoir, Otessa Moshfegh adresse un appel flamboyant à réenchanter le monde grâce à l’imaginaire. Vesta n’est pas folle : elle a juste trouvé un refuge loin des tumultes de ce monde. Peu importe, alors, l’enquête et la véracité des faits tant que le récit qu’elle façonne dans sa tête et les fables qu’elle se raconte forment une belle histoire.
La mort entre ses mains, d’Otessa Moshfegh, Fayard, 252 p. 20 €. En librairie depuis le 05/01/2022.




















