
[Rentrée littéraire] Victor Dumiot a publié cet été son premier roman, Acide. Quelques mois après sa parution et le retentissement de cette histoire captivante,L’Éclaireur a rencontré l’auteur.
20h30. Victor Dumiot, 27 ans et, quoi qu’il en dise, écrivain, me rejoint dans un restaurant du 5e arrondissement où il habite. C’est là que le personnage de son premier roman Acide (édition Bouquins), a été défiguré par cet acide qui a tout, ici, du sérum de vérité. Pendant deux heures, alors que les assiettes se vident, on parle de monstres, de viols, de victimes, de visages qui fondent et de couteaux qui passent de main en main.
On parle de cette histoire qui n’en finit pas de s’écrire chez les lecteur·rice·s qui l’ont lue. Son livre a de l’ambition, une ambition dévorante : réactiver par une dialyse toxique – comprendre des phrases méthodiquement ciselées – une littérature du dérangement, du fil qui casse, de l’écharde.
Le récit plonge d’emblée dans le monologue intérieur de Camille, fille de bonne famille, sur les rails d’une réussite prévisible, pour nous dire le deuil de son visage fondu, de son futur, et sa colère, son immense colère possiblement assassine. Et puis, noir sur noir, s’y ajoute le récit de « l’homme », Julien, otaku isolé et dérangé, ancien harcelé perclus de honte et ne ressentant rien. Lorsqu’il tombe sur la vidéo de l’agression de Camille et qu’il ne peut plus s’en détacher, on comprend la collision inévitable.
« Moi, ma colère, je la voyais comme au fond d'un cratère, d'un cratère très profond,
duquel elle jaillissait en torrent, coulait, s'échappait et dévastait tout sur son passage,
elle poussait en moi, cassait mes dernières portes, mes dernières retenues, mes
dernières digues, elle noyait ma raison. Je me laissais dissoudre. »
Se réclamant d’Elfriede Jelinek comme de Hubert Selby Junior, Victor Dumiot a donc le goût du fer chauffé à blanc. Honnêteté radicale ou léger sadisme un peu poseur ? Interview crash, test, donc, pour vérifier si le livre mérite bien le désagréable ravissement des lésions qu’il occasionne.
Comment êtes-vous venu à l’écriture ?
J’ai grandi bègue. J’ai longtemps été très frustré de ne pas pouvoir articuler ma pensée, de ne pas pouvoir raconter mes histoires, de ne pas pouvoir participer à ces histoires collectives qu’on se raconte entre amis. L’écriture a été, beaucoup plus que la lecture, le seul moyen de me nourrir de récits et de raconter les histoires que j’aurais aimé raconter aux autres. J’ai été un enfant battu, frappé, harcelé. Il y avait une forme de revanche, aussi, sur les autres, sur des mots inarticulés, la création d’un monde intérieur plus sécurisant pour moi : je pouvais être le héros que j’aurais toujours voulu être, le garçon populaire.
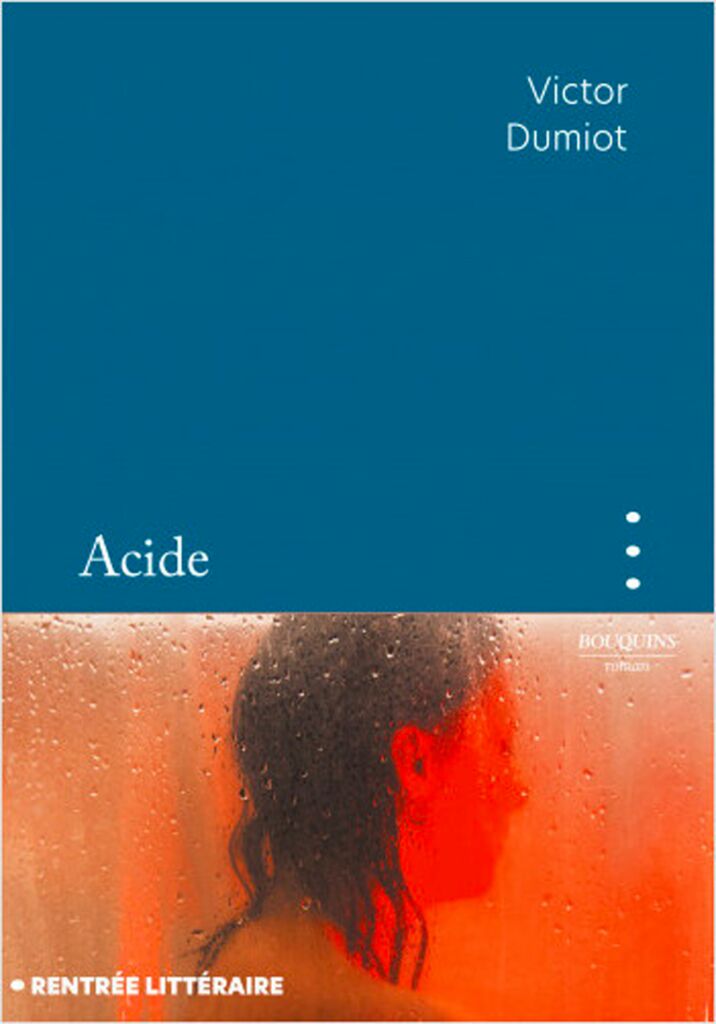
Comment ce projet si particulier est-il né ?
Le roman est né pour une raison accidentelle. J’ai été contacté par une grande maison d’édition parce qu’on avait lu des nouvelles, des critiques, et j’ai eu le sentiment qu’il fallait que j’arrive avec un manuscrit. J’avais deux semaines pour trouver un texte présentable. Et j’avais simplement cette nouvelle, qui s’appelait au départ Le Masque de l’autre, dans laquelle Camille et Julien étaient présents. Mais cette nouvelle était mauvaise, vraiment mauvaise. Pas présentable.
C’est quoi une mauvaise nouvelle ?
C’est une nouvelle qui ne va pas au fond des choses, qui les touche avec une forme de prudence, encore plus avec une histoire aussi sulfureuse, un peu inquiétante, un peu casse-gueule. Il ne fallait pas rester à mi-chemin pour écrire cette histoire. J’ai réécrit cette nouvelle en roman, pendant deux semaines, de manière complètement hallucinée, à toutes les heures du jour, de la nuit, ivre, pas ivre. Tout le temps, vraiment tout le temps. Et ça a donné ce manuscrit qui a été accepté par les éditions Bouquins. Ça a été un moment assez étrange. Puis le manuscrit a été accepté par d’autres maisons et donc j’ai pu choisir. C’est un vrai luxe.
« Il y avait une forme de revanche, aussi, sur les autres, sur des mots inarticulés, la création d’un monde intérieur plus sécurisant pour moi : je pouvais être le héros que j’aurais toujours voulu être, le garçon populaire. »
Victor Dumiot
Quel est le point de départ du récit ?
Le point de départ de cette nouvelle, où effectivement il n’y avait que Camille, c’était de réfléchir à la condition de la victime. Qu’est-ce que c’est qu’une victime ? Qu’est-ce que ça fait d’être victime et comment on sort de cette condition-là ? Surtout quand on a été victime et qu’on est jugé comme une victime. Je voulais explorer cette position très marginalisante, discriminante en réalité, ne serait-ce que par la compassion ou la pitié que les gens peuvent avoir pour toi. Ne serait-ce que par le jugement des autres, des phrases toutes simples telles que “C’est terrible ce qui lui est arrivé”. Être toujours jugé à l’aune de l’agression, des agressions que l’on a pu subir est quelque chose d’insupportable. Et donc je voulais partir d’un cas extrême : celui d’une victime qui ne pourrait pas sortir, parce qu’elle est défigurée à l’acide, de sa condition.
Vous avez particulièrement travaillé sur la description de cette défiguration. Cela donne un texte très physique, organique, très détaillé. Quel a été le travail de recherche ?
Il y a eu dans un premier temps, de manière naïve, une exploration de la douleur, sans aucune
recherche ; juste comprendre par l’écriture ce que pouvait provoquer un jet d’acide sur le
visage. Donc se mettre en situation : j’ai eu des phases d’écriture très dures, dont je suis sorti
dans un état de cataclysme intérieur. Je me sentais moi-même détruit. J’avais besoin de me
mettre dans le même état que Camille dans le métro lorsqu’elle reçoit ce jet.
« Le monstre, c’est ça : c’est la part inquiétante qui se maintient dans l’ombre. Le monstre, c’est celui que l’on a rejeté, parce qu’il est laid, parce que ses appétits sont dangereux, parce qu’il est dissemblable. »
Victor Dumiot
Après ce brouillon, ces jets d’écriture, la recherche est venue. J’ai compris la particularité de l’acide. Contrairement au feu, l’acide ne brûle pas, mais produit des lésions. Il y a quelque chose de l’ordre de la dévoration, d’irréversible. C’est cette notion d’irréversibilité de l’acte, de l’agression qui m’intéressait. La lecture de ces thèses de médecine m’a permis de découvrir tout un vocabulaire, des sensations, de voir comment le corps médical pouvait prendre en charge ces corps victimes d’une telle agression.
Mon travail a été de trouver un équilibre entre une langue intérieure, poétique, et cette langue médicale qui permettait de traduire plus froidement une agression très viscérale, par des mots plus objectifs, mais qui sont aussi plus angoissants : une membrane cytoplasmique, moi, ça me fait très peur ! Je n’ai pas exactement envie de savoir ce que c’est, et encore moins de savoir ce que ça fait quand elle éclate. Mais ce sont des images… Donc ce fut une exploration de ces images-là.
Votre livre est vendu comme un livre désagréable et vos personnages sont présentés comme monstrueux. Comment définir un monstre aujourd’hui ?
C’est un peu de ma faute. J’ai présenté mes personnages comme deux monstres. Mon parti pris c’était de prendre au piège le lecteur et de lui faire croire qu’il allait lire le récit d’une agression, et d’une femme victime d’une agression. Or, très rapidement, Camille révèle une personnalité très hargneuse. Elle est pleine de colère, de haine. Elle a envie de détruire. Une fois qu’elle se considère elle-même comme ayant été exclue de l’humanité, puisqu’elle est rendue monstrueuse, elle est “enlaidie” comme elle le dit ; elle se sent libre, elle se sent déchargée, par intermittence, de toute morale et elle va explorer cette part méchante qu’elle porte en elle. C’est aussi un personnage très superficiel, sans que cela soit péjoratif, qui a longtemps eu pour seul objectif de se plaire au travers du maquillage.
En fait, ce personnage est le personnage le plus humain possible. Camille pourrait être mon
double. C’est une femme de ma génération, de 27 ans, en 2023. Ce qui la rend monstrueuse, c’est
l’agression et c’est son statut de victime, pas l’inverse. Et c’est pour ça que je voulais la rapprocher de Julien. Julien qui, lui, en apparence, a davantage l’air d’un monstre. C’est un personnage assez
répugnant, violent, qui plonge dans un processus d’autodestruction. Il plonge vers Camille et on ne sait pas pourquoi. Je voulais montrer que la place de la victime, en marge, ressemble en fait à la place du monstre tel qu’on le conçoit, c’est-à-dire la matérialisation de tout ce que notre humanité rejette. Tous les vices, toute la dimension inquiétante de la nature humaine. Le monstre, c’est ça : c’est la part inquiétante qui se maintient dans l’ombre. Le monstre, c’est celui que l’on a rejeté, parce qu’il est laid, parce que ses appétits sont dangereux, parce qu’il est dissemblable.
En réalité, le monstre me fait beaucoup de peine, et longtemps je me suis moi-même considéré comme un monstre, parce que j’avais entendu à l’école que j’étais d’une “laideur monstrueuse” ; c’est un individu solitaire, qui est poussé dans cette marge, qui est coincé dans cette marge. Est-ce qu’il est monstrueux parce qu’il est coincé dans cette ombre ou est-ce qu’il est intrinsèquement monstrueux ? C’est ce que ce texte questionne.
C’est une définition très burtonienne…
Oui, Tim Burton est le grand philosophe du monstrueux.
À lire aussi
On sent une hésitation à la fin du livre entre cette définition humaniste et celle d’Hubert Selby Junior, l’un de vos auteurs de référence, dans le sombre Démon. Dans quelle mesure avez-vous hésité dans la construction de cette fin ?
C’est toujours compliqué de conclure une histoire. Pour moi, une histoire ne se finit jamais. Il y avait une autre fin au départ, beaucoup plus fermée. Qui laissait peu de place à l’ambiguïté. Qui réduisait le roman à ce que je voulais éviter : apporter une réponse réconfortante au lecteur. Je voulais vraiment que le lecteur ne dispose pas des moyens de se rassurer, de se dire qu’il a traversé ce moment désagréable, mais qu’il a enfin le fin mot de cette histoire. En fait, non ! La fin est soustraite. Elle se dessine ensuite dans l’imagination du lecteur…
« Dans mon roman, il y a une étude des rapports genrés, des violences patriarcales, notamment parce que la défiguration est un “traitement” qui est réservé aux femmes. »
Victor Dumiot
La fin que vous avez imaginée interroge. Les victimes sont-elles condamnées à devenir coupables ?
C’est une question centrale du livre : comment rend-on une victime à son humanité ? Je ne prétends pas écrire pour toutes les victimes ou apporter une réponse à cette question. La fin restaure en fait un rapport de force duquel Camille a été exclue. Elle a subi sa suppression identitaire, elle a subi sa défiguration, mais elle parvient à instaurer un nouveau rapport de force. Cela dit, ce n’est pas parce qu’on est dans un rapport de force, voire de domination, qu’on est nécessairement coupable. L’histoire de Camille et Julien n’est pas achevée, elle se poursuit, là, actuellement, pendant que nous échangeons.
Dans les rapports de force politiques, idéologiques d’aujourd’hui ?
Bien sûr, parce que Julien représente de manière allégorique la banalité du mal contemporain. La banalité, qui ne devrait pas en être une, du mal du mâle contemporain. Dans mon roman, il y a une étude des rapports genrés, des violences patriarcales, notamment parce que la défiguration est un “traitement” qui est réservé aux femmes. Qu’est-ce qu’on cherche à supprimer chez la femme quand on lui dérobe son visage et pourquoi l’on considère que la défiguration serait plus extrême pour une femme que pour un homme ? Qu’est-ce que cela révèle de notre façon de considérer les femmes en société ? Il y a une phrase dans le livre qui résume cela : “Elle sait depuis toujours que l’homme est une misère.”
Quelles ont été vos références pour ce livre ? Vous évoquez beaucoup Jelinek comme influence maîtresse.
Jelinek, c’est un mystère, parce que c’est une autrice que j’ai découverte tardivement, comme tous les auteurs que je lis. Jusqu’à 14 ans, je n’ai rien lu et ensuite je n’ai lu que du thriller comme Chattam et Grangé, et de la philo. Mes parents voulaient absolument que je lise, je venais d’un milieu assez populaire. Je ne regardais que des films. Puis, un jour, je suis tombé sur L’Œil de Caine de Patrick Bauwen (2008).
Je l’ai lu en une journée et là, le monde s’est ouvert. Le livre est aussi construit comme un thriller, sauf la fin, qui revient à la littérature. Elfriede Jelinek m’a aussi influencé par l’intransigeance de son regard : il n’y a pas de point limite, de pudeur à avoir quand on aborde un sujet. C’est ce qui différencie d’ailleurs un roman d’une littérature de témoignage. Oui, on peut raconter son viol, mais on perd quelque chose qui est fondamental, c’est-à-dire la littérature.
Certains passages du livre sont sous tension. Sont-ils liés à des expériences personnelles ?
Par touches, il y a des choses de moi. La scène de harcèlement, être forcé de boire de la boue, c’est quelque chose que j’ai vécu. Chez Camille aussi, dans le rapport qu’elle entretient avec son parcours, et sa réussite – elle a dit au revoir à sa famille qu’elle considère comme des ploucs. Elle a bien conscience que tout s’arrête pour elle. Elle va passer pour une débile. C’est un risque.
Il y a un viol dans votre récit. Quelle est sa place par rapport à la logique du récit ?
Il y a une première raison, c’est que Camille a longtemps été mise à distance de toute la violence des hommes qu’elle a subie, des hommes et des femmes, comme cette scène avec sa professeure de philosophie qui lui dit : “Mais pourquoi est-ce que tu te maquilles dans la classe ?” Camille lui explique alors que le seul endroit où elle peut se maquiller et être en sécurité, c’est au lycée. Je dis “mise à distance”, parce que les violences sexuelles en société, pour éviter qu’elles ne provoquent le scandale, sont généralement banalisées.
La loi du silence, c’est la peur du coup d’éclat, des conséquences de ce coup d’éclat. Dans mon roman, ce viol est relu par Camille comme une espèce d’agression primordiale, l’avant-acide. Mon roman, je l’ai conçu comme une autopsie de la violence, des violences, depuis l’image pornographique jusqu’à la défiguration, qui est pire qu’un meurtre. C’est un meurtre qui te laisse en vie.
Comment avez-vous abordé l’écriture de cette scène ?
Je l’ai imaginé. Mais, en fait, je voulais avoir le viol le plus anonyme possible. Le plus banal. C’est d’ailleurs ainsi que se comprend la réaction de
Camille : elle ne sait pas si c’est un viol, elle se sent sale et puis elle observe la réaction de ses amis
qui est un peu… En fait, c’est de cette manière-là que se déroulent la plupart des viols.
Bon, c’est aussi très lié à notre propre regard sur la victime. Il est tellement difficile d’entretenir des relations avec une victime, d’accepter que l’agression ait eu lieu, qu’il est plus simple de la tourner en dérision. D’en faire un non-événement. Il serait très rassurant pour chacun, pour des parents, pour des amis, pour des proches, que l’événement n’ait pas eu lieu. Chez Camille, il y a ça. Évidemment, ce temps qu’elle a à l’hôpital est un temps introspectif, c’est un trajet pour elle, elle se remémore ce que “son ancien moi” a pu se dire et elle se demande : “J’ai laissé passer ça ? Pourquoi j’ai laissé passer ça ?”
Comment se définit-on aujourd’hui comme écrivain ?
C’est un piège. Être écrivain, ça ne veut pas dire grand-chose. J’ai besoin de me dire que ça ne veut
pas dire grand-chose. Le danger est celui de la représentation de soi. Je suis très rassuré et heureux de pouvoir me définir comme écrivain, mais je ne le fais jamais. J’écris, je veux écrire, je poursuis
l’écriture.
La place de l’écrivain à notre époque est problématique, parce que les gens ne lisent plus et puis parce que ce “statut” qui nous fait passer trois heures sur une phrase est vu comme improductif, une sorte de luxe. Cette position est aussi matériellement très compliquée. J’ai détesté Acide pendant longtemps, jusqu’à ce que je le réécrive assez pour enfin l’assumer. Je considère que c’est un cadavre, maintenant qu’il est publié.
La réception de votre livre a changé sa perception. Le retour des lecteurs a-t-il modifié votre intuition de départ ?
Complètement. J’étais sans cesse dans une hésitation. À force de travailler ce livre, je ne savais plus exactement ce qu’il racontait. Et effectivement, sa réception très positive, malgré son aspect dérangeant, et la façon dont certains lecteurs se sont emparés du récit m’ont tranquillisé et ont redéfini les enjeux de ce texte. Surtout, ce qui me passionne c’est de voir à quel point Camille peut susciter de l’empathie chez certains et pas chez d’autres, de même pour Julien. Et donc de voir que ce pari-là est réussi même si l’attachement du lecteur à ces personnages est compliqué. Il y a d’Acide une lecture très différente pour chaque lecteur… Et donc une expérience véritable qui se fait.





















