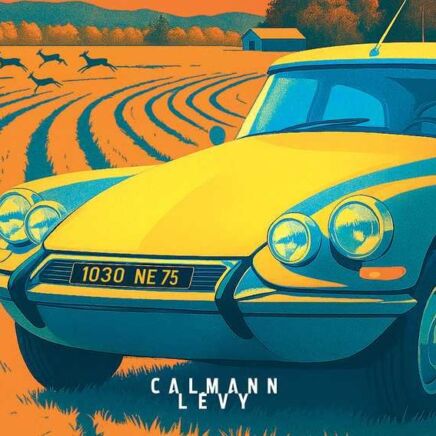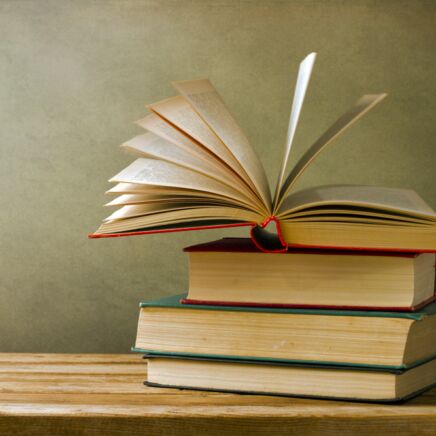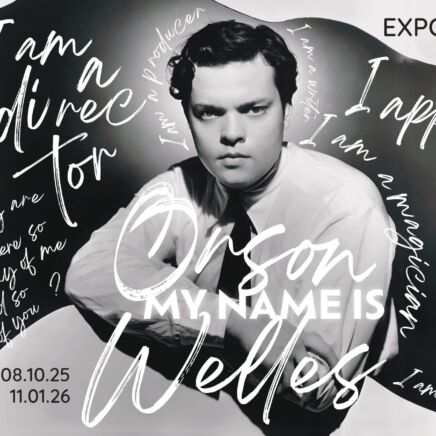Portés par leur génie increvable, les trois dessinateurs signent cet automne les trois albums les plus marquants de l’année et s’affirment encore et toujours comme les patrons de la BD française.
La peau dure comme le cuir, le trait fier, éternellement beau et agile, les mots justes, encore et toujours, qui enchantent et qui charment… Rochette, Tardi et Sfar : les « papys de la BD » font de la résistance. Oubliez le raz de marée du manga japonais et ses représentants français comme Reno Lemaire et Tony Valente ; oubliez les héritiers prometteurs des déglingos de Métal hurlant, Mathieu Bablet, Run ou Ugo Bienvenu ; même les nouvelles stars du milieu, Riad Sattouf et Bastien Vivès, ne peuvent rivaliser. Nos trois lascars continuent de survoler les débats et illuminent cette fin d’année littéraires avec des œuvres à part, points d’exclamation sublimes et déchirants apposés à des carrières qui on l’espère, ne sauraient avoir de fin.
Les sommets de Rochette
Une chose est sure, Rochette sait ménager ses effets. Perché dans les hauteurs alpines, loin de la civilisation, l’ermite anarchiste du neuvième art a façonné un nouvel album qu’il décrit lui-même comme l’aboutissement de sa carrière, son « mont Everest ». Pour un homme qui vit avec la passion de l’alpinisme chevillée au corps, la sortie a le mérite d’être claire. Et comment lui donner tort, La Dernière Reine est une œuvre qui fera date, la conclusion magistrale de sa seconde vie de dessinateur. Créateur au début des années 1980 du Transperceneige, série de science-fiction postapocalyptique devenue culte et popularisée par le film de Boog Joon Ho en 2013, Rochette a en effet connu une cruelle traversée du désert dans les années 1990 et 2000, avant de s’offrir une revanche grandiose en réinventant totalement son œuvre ces dernières années.
Inspiré par la douce ivresse des cimes, il se fait désormais le chantre des monts enneigés, un poète protecteur de la nature et de l’animalité. Dans Ailefroide : altitude 3954, paru en 2018, il se prêtait à un touchant exercice autobiographique et retraçait une enfance obsédée par l’alpinisme et par une carrière de guide de haute montagne. Puis, en 2019, dans Le Loup – bientôt adapté au cinéma par Marc du Pontavice –, il mettait en scène un duel épique entre un loup et un berger dans le massif des Écrins.
Cette fois, il se rêve en romancier du XXe siècle et raconte sa première histoire d’amour, une romance bouleversante entre Édouard Roux, une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, et Jeanne Sauvage, une sculptrice animalière. Entre le Paris des Années folles et les montagnes du Vercors, Rochette façonne une bouleversante ode à la vie qui nous replonge même dans la Préhistoire. Avec ce trait unique qui tend parfois vers l’abstraction, avec un découpage quasi cinématographique qui alterne entre plans serrés et grands angles, il nous envoûte et nous émeut aux larmes. La légende raconte même qu’au moment de conclure son œuvre, Rochette a été victime d’une hémorragie nasale l’obligeant à être évacué en urgence vers l’hôpital le plus proche. Seuls vestiges de cette mésaventure, deux gouttes de sang visible sur la dernière planche de l’album. Comme les symboles d’un artiste qui donne sa vie pour son art.
La Dernière Reine, de Jean-Marc Rochette, Casterman, 240 p., 30 €.
Les Adieux d’Adèle
« Ainsi s’achèvent pour toujours les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec. Gare aux faussaires qui seraient tenté(e)s d’y donner suite. » Fidèle à lui-même, à ses principes, toujours avec ce côté bougon et moqueur qui le rend drôle et attachant, Jacques Tardi n’hésite pas à critiquer la mode des séries qui passent de main en main et qui semblent ne pas vouloir de fin. Mettre un point final à une histoire culte, qu’on a patiemment forgée, qu’on a passionnément aimée, sans se précipiter ou – pire – se renier. Voilà sans doute la tâche la plus ardue d’un créateur.
C’est à ce périlleux exercice que se prête aujourd’hui le monstre sacré de la BD avec le dixième tome des aventures de son héroïne Adèle Blanc-Sec, son alter ego de papier. Quarante-cinq ans après Adèle et la Bête, paru en 1976, Le Bébé des Buttes-Chaumont vient clore avec brio une saga entrée au panthéon littéraire.

Alors que les habitants de la capitale souffrent d’un mal mystérieux propagé par l’élixir du docteur Vertuchou, Adèle Blanc-Sec doit démêler une bien étrange affaire. Des clones qui lui ressemblent comme deux gouttes d’eau se transforment en bombe humaine et se font sauter aux côtés des membres du gouvernement. Qui cherche à lui faire porter le chapeau ?
Dans ce jubilé aussi savoureux qu’émouvant, on retrouve tout ce qui fait le sel de la littérature de Tardi. Dans la veine des romans feuilletons du XIXe siècle, notamment Les Mystères de Paris d’Eugène Sue, le dessinateur poursuit son histoire d’amour avec la capitale et nous entraîne dans ses méandres, à la rencontre de personnages hauts en couleur, à la gouaille inimitable. Avec Tardi, bavard n’est pas un gros mot, bien au contraire. Les dialogues sont denses, mais portés par une verve et un humour reconnaissables entre mille. L’auteur multiplie les clins d’œil aux épisodes du passé, jusqu’à l’apothéose final dans le Muséum d’histoire naturelle, là où tout a commencé. La boucle est bouclée et on se retient de pleurer.
Adèle Blanc-Sec – Le Bébé des Buttes-Chaumont, de Jacques Tardi, Casterman, 64 p., 14,50 €.
Préparez-vous pour la bagarre
« Il faut vous battre monsieur ! » Au printemps 2020, alors que Joann Sfar est entre la vie et la mort sur son lit d’hôpital, atteint d’une forme grave de Covid, son médecin le prépare au combat à venir contre la maladie. Après plusieurs semaines de convalescence, ces quelques mots résonnent encore et toujours dans la tête du dessinateur et convoquent une adolescence où la virilité et la bagarre étaient les valeurs cardinales de l’éducation paternelle.
Né dans une famille juive, fils d’un avocat fort en gueule autant qu’en épaule, qui a pour fière doctrine de ne jamais céder devant qui que ce soit, Joann Sfar tente de se glisser dans le moule, suit des cours de Kung-Fu, de Krav Maga, il est même embauché au service de sécurité de la synagogue familiale. Mais, chaque fois qu’il tente de prouver sa valeur en combat singulier, les choses échouent lamentablement.

Plutôt habitué aux albums courts, qu’il décline en série, Joann Sfar, avec La Synagogue, se risque avec brio à un one shot dense et autobiographique. Avec son humour irrésistible, mais surtout avec une tendresse qui touche en plein cœur, il se livre comme rarement sur son adolescence niçoise et son histoire familiale.
À travers son parcours personnel, il s’empare à nouveaux des grandes thématiques qui infusent son œuvre, comme le rapport aux origines, la religion, l’extrémisme, mais aussi la violence immuable dont sont victimes les juifs. Il raconte surtout ce moment singulier où un fils s’écarte des traces de son père pour trouver sa propre voie. Sa force à lui s’imposera loin des tatamis, sur une feuille à dessin, un cahier et un crayon à la main.
La Synagogue, de Joann Sfar, Dargaud, 208 p., 25,50 €.