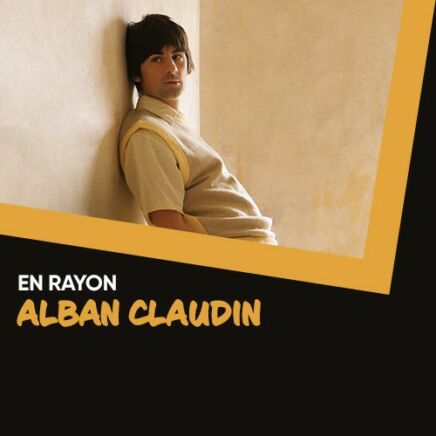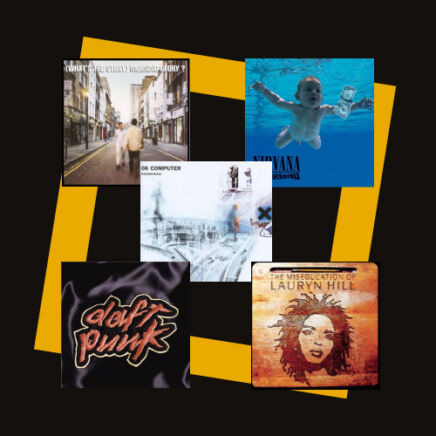Créateur du « Soldat Rose », auteur, parolier, concepteur de clip… Pierre-Dominique Burgaud est aussi le complice d’Alain Chamfort depuis des années. De la publicité à la musique, il nous relate son parcours, ses collaborations, son rapport à l’écriture.
Vous avez travaillé dans la publicité. Quel était votre métier ?
Dans la publicité, j’étais ce qu’on appelle « un créatif », plus précisément un concepteur-rédacteur. C’est la personne qui écrit les slogans (pour les affiches) ou qui conçoit les films (pour la télé) en binôme avec un directeur artistique. Le concepteur-directeur est plus axé sur les mots, le directeur artistique sur les visuels, la réalisation.
Pourquoi avoir quitté ce milieu ?
J’étais très heureux dans ce métier, à la croisée de l’écriture, la photographie, le cinéma. Mais déjà l’obsession du temps qui passe (qu’on retrouvera plus tard dans mes chansons) était là. Je sentais qu’au fond la vie pourrait filer comme ça, en un claquement de doigt, à écrire des messages publicitaires, et qu’un jour je me réveillerais à 60 ans, peut-être dans une jolie maison, mais en me disant : « Qu’est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu ne t’es pas laissé endormir par ce confort, cette facilité, cette vacuité ? ».
J’avais l’impression que le langage publicitaire était épuisé. Les raccourcis, les slogans, les jeux de mots, l’impact qui prend le pas sur la justesse. Sur ce point, je me suis complètement trompé : le style publicitaire a depuis gagné le journalisme (plus un article sans jeu de mots, plus ou moins réussi) et, plus embêtant, le monde politique et ses fameuses « punchlines ».
Ce désir de changer de métier était dans un coin de ma tête, flottant. Le jour où on m’a appelé pour écrire les paroles d’un film musical (Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty), je me suis laissé porter par cet appel d’air. Dans la maison de disques qui s’occupait des chansons du film, j’ai rencontré Marie Nowak, une éditrice, qui a cru en ma capacité à écrire des chansons. Elle m’a présenté Louis Chedid. C’est ainsi qu’est né Le Soldat Rose dont le succès m’a permis de me consacrer totalement à cette activité.
Votre expérience passée dans ce milieu influence-t-elle votre métier d’auteur, parolier aujourd’hui ?
Sans aucun doute. Le plus important pour moi est le fait d’avoir apprivoisé la peur de la page blanche. Dans la publicité, vous cherchez des idées à longueur de journée, idées qui sont souvent refusées par le client, alors vous recommencez. Inlassablement. Cette gymnastique m’a permis de ne jamais être bloqué, paralysé par une feuille vierge : je trouve toujours quelque chose à écrire. Souvent ce n’est pas bien, mais j’avance, je continue, quand bien même à la fin de la journée je fiche tout à la poubelle. On finit toujours par croiser un mot, une association de mots, une rime, qui nous emmène quelque part. Je suis très décomplexé par le fait d’écrire des phrases. Je ne me juge pas en cours de travail, seulement à la fin.
Le sens de la formule hérité de la publicité est probablement un atout également. Même si aujourd’hui je pense que c’est un faux ami. Paradoxalement, j’essaie de me débarrasser de tous mes réflexes publicitaires. Dans la publicité, on est souvent un « faiseur ». On fait un film à la façon de. On parodie. On décale (ce qui est exactement ce que j’ai fait pour le clip d’Alain Chamfort avec les panneaux à la Dylan). Dans la chanson, j’essaie de ne pas avoir recours à ces fils si visibles, de ne pas être systématique, de ne pas trop « construire ». En caricaturant, si un publicitaire avait écrit Foule Sentimentale d’Alain Souchon, il aurait fait toute la chanson autour de « on nous Claudia Schiffer, on nous Paul-Loup Sulitzer », en enchaînant tous les noms en « ère » représentatifs de la société de consommation : il aurait eu « son truc », son effet, ça lui suffisait. Ça aurait peut-être même fait une chanson pas si mal. Souchon, lui, se contente d’en faire deux lignes, il ne tire pas sur le fil, il trouve une nouvelle idée (ou rime) intéressante à chaque couplet : il en fait une chanson extraordinaire.
Je suis aujourd’hui très admiratif de ces chansons, dont je ne vois pas les fils. Des mots de Benjamin Biolay, de Jean Fauque, de Bertrand Belin, de Camille, de Philippe Djian pour Stephan Eicher, où soudain passent des fulgurances venant d’on ne sait où. Quelque chose qui ressemble à de la pure inspiration.
Vous êtes le principal auteur du dernier album d’Alain Chamfort. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre qui remonte à presque 20 ans.
J’étais à ce moment encore dans la publicité. Alain venait d’être licencié par sa maison de disques, comme beaucoup d’artistes – et non-artistes – à l’époque. Il avait envie d’un clip qui puisse attirer l’attention (on ne parlait pas encore de buzz à l’époque !) sur sa situation, sa nouvelle chanson, sachant que son ex-label n’investirait pas pour promouvoir le titre !
Il en a parlé à un de nos amis communs, qui lui a dit : je connais un publicitaire qui peut peut-être t’aider. C’était moi. J’ai écrit une dizaine de clips autour de la chanson, Alain a choisi celui-là. Le succès de la vidéo, qui a remporté la Victoire de la musique, nous a confortés sur le bien-fondé de cette collaboration. J’ai ensuite enchaîné quelques idées de ce type pour lui, dont le concert impromptu dans le kiosque des Jardins du Luxembourg. J’écrivais déjà des chansons, mais dans mon coin, sans oser les montrer. Notre amitié s’est construite peu à peu, à mesure des conversations, au fil des années.
Vous avez, depuis, travaillé sur de nombreux projets avec lui. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre collaboration avec Alain Chamfort ?
Je suis fasciné par sa capacité à repérer quelque chose d’intéressant et à ne pas l’abîmer. Je m’explique. Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, un bon texte. Encore faut-il quelqu’un qui l’accepte dans son entièreté, sans le lisser, sans en enlever la substance. C’est rare. Prenons le clip des Beaux yeux de Laure par exemple : nombre d’artistes l’auraient refusé parce que ce n’est pas bon pour l’image de dire qu’on a été viré. Ou bien l’auraient accepté en demandant de retirer le panneau qui dit qu’il est libre pour les anniversaires et les baptêmes, ou celui où il affirme qu’il est propre et bien élevé. Alain n’a pas touché une phrase, pas une.
De la même façon, sa facilité à accepter le texte des Microsillons, qui parle de ses rides, relève de cette même force. De ne pas changer une phrase un peu plus dure comme « la poussière, les rayures, tout est sur la figure ». Une fois de plus, il a accepté l’idée, il y va à fond, il fait confiance.
Au quotidien, j’aime bien la douceur de notre relation. Nos timidités respectives. Sa pudeur quand il me joue un morceau pour la première fois et qu’il a peur que je ne l’aime pas. Pudeur que j’ai en miroir quand je lui présente un texte. Et puis son intégrité, son obsession de faire quelque chose qui lui plaît, sans aucun calcul radiophonique, commercial. L’exigence qu’il a envers lui-même. Sa force de conviction alors qu’il peut paraître si fragile.
Comment cette complicité s’est-elle créée entre vous ?
La complicité est venue avec les années, avec l’amitié. Nous avons des personnalités assez proches, assez féminines. On partage la même discrétion. Les retours positifs qui ont accompagné la plupart de nos projets communs ont dû également participer à nous rapprocher encore plus. On s’épanouit plus par beau temps que sous la tempête. Nous avons assez rapidement eu une petite routine : une fois par semaine, il passe chez moi en milieu d’après-midi, on écoute les nouvelles chansons françaises qui sortent, on en parle. On aime, on n’aime pas. Puis quand arrive la fin de l’après-midi, on va dans un petit café à côté. On continue nos échanges autour d’un verre, deux, on se désinhibe un peu, on parle de plein de sujets différents, l’actualité, on est interrompus par les gens qui le reconnaissent et viennent lui dire un mot, qui parfois s’installent, ça fait partie de ce qu’on aime à ce moment-là, ça nous amène ailleurs, vers d’autres conversations que l’on n’aurait pas forcément eues tous les deux. C’est de ces situations, purement récréatives, que viennent les thèmes de la plupart des chansons que j’écris pour lui ensuite.
Comment se passe l’écriture d’une chanson pour lui ?
Alain préfère composer les musiques avant. Il trouve que ça lui permet d’être plus exigeant musicalement, de ne pas se reposer sur le sens. Il me joue ou m’envoie une chanson sans mots, les mots étant remplacés par des « la la la » qui me permettent de comprendre quelle est la mélodie, le nombre de pieds qu’il faut. C’est un piano-voix qu’il enregistre sur son téléphone, ou que j’enregistre sur le mien s’il me le joue en direct.
À partir de là, je cherche des « vrais mots » pour remplacer les « la la la ». Alain ne me donne jamais de thème, mais notre proximité, les heures et les heures de discussions sur tout et rien que nous avons à longueur de temps me permettent de savoir quels sont les sujets qui l’intéressent, les questionnements qui l’habitent. Quand j’ai l’impression d’avoir trouvé quelque chose, je lui envoie par mail mon texte, pour lui laisser le temps de le digérer, de l’essayer éventuellement. Et puis il me fait son retour, de vive voix. Parfois il aime, parfois il aime mais il trouve que ça ne va pas bien avec sa musique, parfois il aime mais il trouve que ce n’est pas pour lui, parfois il n’aime pas. Il m’en parle toujours avec beaucoup de franchise, et de respect.
Quand il aime, il se met au piano et le chante, toujours en enregistrant sur son téléphone. On regarde ce qui « ne sonne pas bien », les améliorations qu’on peut y apporter. De mon côté, les jours suivants, j’essaie de repérer les faiblesses ou les facilités qu’on pourrait remplacer.
Je n’essaie jamais de convaincre Alain qu’un texte est bien. Il m’arrive de lui demander « tu es sûr, tu ne veux pas qu’on l’essaye ?« . Et il a toujours l’élégance de l’essayer, le chanter au piano. Mais s’il ne le sent pas, je n’insiste pas. Je n’ai pas envie de lui forcer la main. Je doute d’ailleurs que j’y arriverais !
On vous connaît pour être le père du Soldat Rose mais vous avez aussi écrit pour divers artistes. Comment débutent ces collaborations ?
Il n’y a pas vraiment de règles. Parfois les artistes s’adressent directement à moi, parfois les directeurs artistiques des maisons de disques me disent qu’ils travaillent sur un album pour un artiste et me demandent d’écrire une chanson, parfois c’est moi qui envoie directement un texte à un artiste qui ne m’a rien demandé. Je n’ai pas vraiment de timidité pour ça (c’est par mail !) et surtout je ne me vexe pas quand on me refuse un texte. Cela fait partie du jeu. Un texte peut être réussi et ne pas correspondre à ce que veut dire la personne à qui vous l’avez envoyé. Il peut être raté aussi ! Et ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut juste dire que vous avez raté un texte ! Et j’en rate à longueur de journée mais ils n’arrivent pas jusqu’à vos oreilles (parfois si !).
Et vous êtes également concepteur de clips ?
Un scénariste si vous voulez. J’écris le clip mais quelqu’un d’autre le réalise. C’est un peu un retour vers mon ancien métier de la publicité : essayer de trouver une histoire, une image qui a de l’impact. Cela me distrait d’exercer ma créativité ailleurs qu’en chanson. Cela m’aère.
Le clip de La Grâce, que j’ai écrit et qu’a réalisé François Goetghebeur, illustre un peu ce que peut amener un clip à une chanson : les images de tous ces grands artistes qui ont accompagné notre vie ont apporté une émotion qui n’était pas dans la chanson « seule ». D’un seul coup, tout le monde se projette dans la chanson, pas seulement les créateurs. Pas seulement les gens qui aiment Alain Chamfort. Et puis derrière les paillettes et les lumières, on se rend compte du travail, du doute. Au fond, ce n’est pas plus facile d’écrire une chanson quand on est Francis Cabrel que quand on est un étudiant avec sa guitare dans sa chambre : c’est la même feuille blanche, tout le temps, en dépit du succès, du confort matériel éventuel, de la vue sur les vignes ou pas. On recommence chaque fois à zéro.
Grand Prix de la Chanson Française de la Sacem, Grand Prix de la chanson de l’année pour Tout est pop… Qu’avez-vous ressenti en recevant ces prix ?
Je ne vais pas jouer l’indifférent : avoir la reconnaissance de mes pairs, ou d’une partie de mes pairs, est important. Ça me rassure, ça m’encourage. Ça me fait plaisir aussi parce que ça prouve aux compositeurs/interprètes qui m’ont fait confiance (ce qui m’émeut toujours) qu’ils ont eu raison de m’accorder cette confiance. Je travaille la plupart du temps avec des compositeurs/interprètes qui ont déjà du succès, souvent des bonnes critiques. Ma peur est que d’un seul coup, en travaillant avec moi, ça se passe moins bien. De « tâcher » un peu leur carrière en quelque sorte, qu’ils gardent un mauvais souvenir de notre collaboration.
Ceci étant dit, je ne suis pas dupe. Le prix de la meilleure chanson ne veut pas dire que vous avez écrit la meilleure chanson. Tout comme le prix du créateur – ou une Victoire de la musique – ne veut pas dire que vous êtes le « meilleur » sur une année. La chanson, ce n’est pas aussi mathématique qu’une finale du 100 mètres. Cela veut dire que votre travail a été remarqué parmi les quelques bons travaux de l’année, ce qui est déjà appréciable, mais le prix serait tombé sur quelqu’un d’autre, cela aurait été tout aussi légitime. Les finalistes m’intéressent autant que le vainqueur. Ça m’arrange, parce que je perds plus souvent que je gagne.
Quel est le plus beau compliment qu’on pourrait vous faire ?
Me dire qu’on aime ma chanson. Il ne peut pas m’arriver beaucoup mieux. Si en plus c’est un artiste que j’aime, un de mes héros, qui me le dit ou l’écrit, c’est un bonheur d’enfant, intense.
Sur la longueur, si je pouvais avoir « une patte », un style propre en dépit du fait que je me mets au service d’interprètes différents, ce serait une jolie réussite. Mais je n’y travaille pas consciemment. Pour être honnête, je fais ce que je peux. On verra ce qu’il en reste.
Quels sont vos projets, ceux dont on peut officiellement parler ?
Je travaille depuis quelques mois avec Laurent Voulzy sur un projet musical qu’il développe autour de Jeanne d’Arc. Laurent est passionné par cette époque, par cette femme, très érudit sur le sujet. Alain Souchon a écrit quelques chansons également. Franck Ferrand travaille sur le livret. C’est un projet de longue haleine, mais entouré de tellement de douceurs, d’artistes que j’admire tellement, que j’espère presque que ça ne se terminera jamais (il y a un producteur qui ne va pas être content en lisant cette phrase !).
Avec Alain Chamfort à la composition, nous avons écrit une chanson pour le prochain album d’Eddy Mitchell. Cela me fait plaisir de pouvoir mettre un minuscule bout d’orteil sur le chemin de ce grand artiste, d’autant plus qu’il est la plupart du temps son propre auteur ; la probabilité que ça arrive était donc minime.
Nous sommes en cours de finalisation de nouvelles chansons avec Pascal Obispo. Je ne sais pas exactement dans quel cadre elles vont sortir. En travaillant sur son dernier album, Le Beau qui pleut, nous avons été amenés à écrire un grand nombre de chansons. Certaines n’étaient pas dans le thème ou le ton de l’album, mais elles nous plaisaient et vont sûrement trouver leur place quelque part.
Je suis également en début d’écriture de chansons pour un grand acteur français au succès international, qui va chanter pour la première fois sur scène. Je ne peux pas encore dire son nom donc j’imagine que ça ne rentre pas dans le cadre de votre « officiellement » !
La Fnac, pour vous, cela représente quoi ?
À chacun sa Fnac. La mienne, c’est la Fnac Saint Lazare. C’est la plus proche de mon domicile. Quand je sors respirer un peu, en semaine, elle fait partie de ma promenade. Je m’attarde un peu dans les disques français, à la librairie, beaucoup de temps passé aussi dans le département Beaux Livres. Chaque fois que j’entends quelqu’un que j’aime bien parler d’un livre, d’un disque, je note le titre sur mon téléphone. Et quand j’arrive dans les rayons, je sors mon téléphone et j’essaie de trouver la référence en question. C’est ma petite routine.